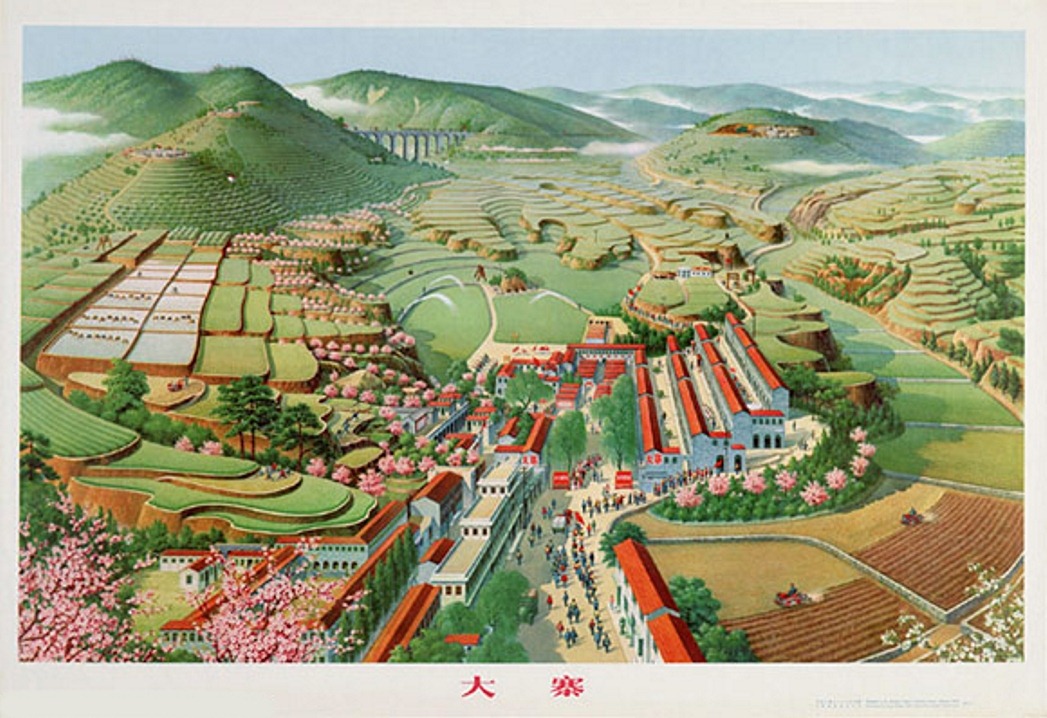L'architecture peut-elle être "révolutionnaire" ?
Une société révolutionnaire peut-elle produire une architecture qualifiée de révolutionnaire ? Quelle est la portée du terme « révolutionnaire » lorsque celui-ci s'applique à l'architecture, avec ses implications idéologiques, fonctionnelles, esthétiques, son contenu, etc.. Peut-on appliquer valablement un tel terme à une forme détachée de son contenu idéologique ? Comment s'exprime le contenu idéologique de la nouvelle société dans l'architecture qui la représente, c'est-à-dire, comment cette architecture est-elle révolutionnaire ? Peut-on parler d'une révolution architecturale en termes de forme-espace-technique- fonction, qui ait une incidence sur la transformation de la société ? En définitive, a-t-on le droit de postuler des formes, des structures ou des espaces « révolutionnaires » en dehors d'une fonction sociale révolutionnaire qui les précède et les motive ?
Roberto
SEGRE
Signification
de l'architecture cubaine
dans
le monde contemporain
Revue
Espaces et Sociétés | n° 1, 1970
HUMANISME,
ARCHITECTURE
ET
TIERS MONDE.
L'architecture,
ou plus exactement la pratique architecturale (1), constitue un des
niveaux de la praxis sociale globale. Ce n'est pas le lieu, ici, de
postuler une hiérarchisation des niveaux, mais d'indiquer
l'importance qu'elle revêt au sein de notre milieu physique.
L'architecture
— conçue de nos jours comme environmental design (2) — constitue
le cadre et la manifestation de notre vie sociale, depuis la cellule
individuelle minimum, jusqu'à l'ensemble du territoire, que la main
de l'homme a transformé. Si la forme construite et l'espace
habitable constituent la réalité essentielle de l'architecture,
celle-ci se rattache de façon indissoluble aux exigences
fonctionnelles et esthétiques de l'homme en tant qu'être social.
L'abstraction implicite qui identifie Homme et Architecture, en
dehors de toute particularité sociale, caractérise la théorie
architecturale qui s'inspire de la philosophie idéaliste. En accord
avec l'affirmation d'une essence universelle de l'homme (3), on
proclame l'existence de valeurs éternelles, immuables — tout
particulièrement dans le domaine esthétique et dans celui de la
signification —, valeurs qui seraient demeurées semblables à
elles-mêmes tout au long du procès historique. Ce sont ces valeurs
qui font apparaître le contenu « humaniste » de l'architecture —
terme utilisé par Geoffrey Scott en 1914 (4) — et qui tout au long
du xxe siècle n'a cessé d'être proclamé par les tendances les
plus diverses (5). L'architecture rationaliste, dans la période qui
va de 1920 à 1930, s'avère humaniste dans sa volonté d'assurer les
conditions d'existence minimum indispensables à l'homme de la
société industrielle ; il en va de même du courant qualifié de «
post-rationaliste » des années cinquante, dans son désir
d'atténuer la sécheresse technique antérieure (6). Humaniste,
l'architecture « organique » l'est aussi dans son souci du milieu
et des facteurs psychologiques (F.L. Wright), comme d'ailleurs son
interprétation européenne, le « néo-empirisme Scandinave ». Les
expériences utopiques actuelles, fondées sur les conquêtes
techniques, qui créent un nouveau cadre de vie humain (s'opposant au
cadre de vie naturel) ou reposent sur la récupération du passé
(des périodes où il existait un équilibre entre l'homme et le
milieu ambiant), afin de libérer la société de son actuelle
aliénation dans la technique, peuvent aussi être qualifiées d' «
humanistes » ; il en va de même pour l'orientation prise par
l'architecture dans les pays socialistes européens (7).