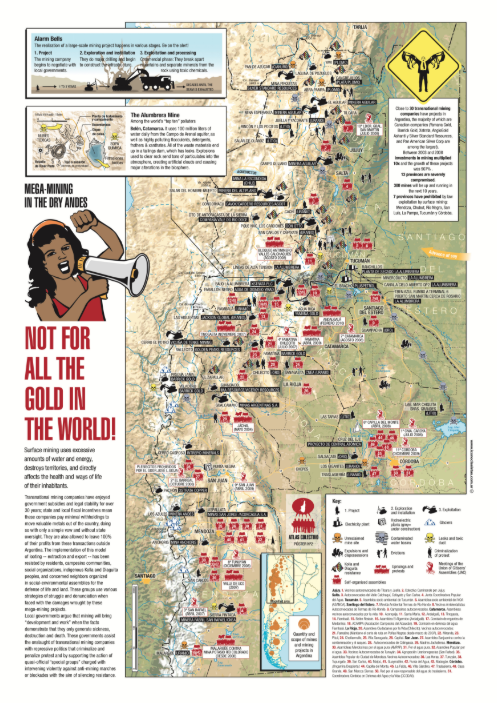Photo : © Hans van den Bogaard
« Qu’est-ce que le néolibéralisme ?
Un programme de destruction des structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur.»
Pierre Bourdieu
L’essence du néolibéralisme
1998
Amsterdam,
la belle capitale rebelle du royaume des Pays-Bas est devenue sage et
soumise.
L’on peut juger, sans paraître excessif, que l’héritage
de quatre décennies de glorieuses luttes urbaine et écologique, pour le droit au
logement et au squat – entre autres luttes -, ce précieux héritage
a été balayé en une dizaine d’années...
...faute de résistance,
les quartiers centraux d’Amsterdam, là où la résistance est née,
encerclant le vieux centre historique, sont à présent embourgeoisés ou
en passe de l’être totalement, les plus pittoresques sont à la
merci et sous la pression d’un tourisme de masse tout aussi
destructeur que pouvaient l’être jadis les bulldozers (avec ses
conséquences sur la mutation du commerce, la pression hôtelière
sur le logement, maisons de ville transformées en Bed &
Breakfast, programmes d’hôtel des investisseurs, exacerbé par les
offres d’Airbnb, saturation des espaces publics et nuisances dues à
la surconsommation des lieux, etc.), tandis que les plus grands
squats de jadis, dont les anciennes friches portuaires squattées, là
où soufflait le vent libertaire, ont été évacués pour faire
place, souvent, à des équipements ludico-touristiques, ou
touristico-artistiques, aux côtés de nouveaux sièges sociaux de
multinationales, objets spectaculaires tentant de capturer
l'attention mondiale, symbolisant la nouvelle IAMsterdam.
C'est-à-dire l'embourgeoisement de la ville et la grande pénurie de
logement abordable, la destruction littérale du parc de logements
sociaux mis en vente, la spéculation forcenée et la hausse
véritablement vertigineuse de l’immobilier, les privatisations à
outrance des services publics, les programmes d'éviction des
indésirables, marginaux, délinquants et squatters, entre autres
abominations urbaines ; tout ceci ne suscite aucune réaction
d’opposition telle qu’elle s’exprimait jadis : la police, sans
doute elle aussi nostalgique, n’a plus aucune tête subversive sur
laquelle abattre sa matraque ; la contestation n’est même pas
muselée, elle n’existe plus, sauf parfois, en réaction contre une
nouvelle loi par trop libérale (notamment celle concernant
l’université), à l’occasion d’un mouvement des mouvements,
tel Occupy, mais sans lendemain sérieux, lutte inorganisée et
inorganique. Certes, la pratique du squat perdure, tant bien que mal
après la loi de 2010 l’interdisant et la pénalisant, mais comme
la contestation, elle tient plus de l’anecdote marginale
individualiste que du grand discours libertaire collectif, occupe
illégalement l’espace artistique plutôt que l’espace social.
Si
cette contradiction éclaire le malaise d’une jeunesse amorphe, par
rapport aux décennies précédentes, et au-delà la démobilisation
de « l’intelligentsia de masse », elle laisse dans l’obscurité
le problème de savoir pourquoi la jeunesse révoltée formant des
mouvements protestataires et rebelles est progressivement rentrée
dans les rangs, alors que les contradictions fondamentales de la
société néerlandaise, dans les domaines urbain et architectural,
entre autres, s’aggravent. Ce fut d’ailleurs une question
récurrente dans les débats contradictoires des intellectuels
progressistes aux Pays-Bas : Pourquoi un tel spectaculaire et non
moins rapide revirement ?
Amsterdam
30 april 1980 | émeute couronnement de la reine Beatrix
© Hans van Dijk