USA | Sun City Arizona
Photograph by James P. Blair
Photograph by James P. Blair
Marco
d'Eramo
From
Minnesota to Arizona
Du
Minnesota à l'Arizona
Le
rêve américain d'une ville sans ville.
2007
2007
MINNESOTA
: LE MALL QUI A AVALÉ L'AMÉRIQUE
Au
coeur d'un paysage plat comme une table de billard, avec une
température avoisinant les – 20° C., les Twin Cities de
Minneapolis et de Saint Paul semblent une destination touristique
pour le moins improbable en plein mois de janvier. Et pourtant, au
plus dur de l'hiver glacial de la Snow Belt, elles attirent encore
plus de 100.000 touristes par jour, 3 millions par mois, qui font
parfois le voyage depuis le Japon ou la Corée. Ils ne viennent pas
pour le fleuve Mississipi, ni pour le joli centre-ville de St Paul,
conservatrice et germanique, ni, sur l'autre rive du fleuve, pour le
dynamisme de Minneapolis, social-démocrate et scandinave, la patrie
de Prince. Ils viennent pour une étrange entité plantée au milieu
de nulle part, à une quinzaine de kilomètres des deux
centres-villes, dans la banlieue de Bloomington, stratégiquement
située à proximité de l'aéroport international, auquel elle est
désormais reliée par une ligne de métro.
De
loin, le Malll of America (MoA) est un immense bloc de béton gris
entouré de vastes parkings. On pourrait le prendre pour une usine
de construction automobile ou une prison d'Etat. En réalité, c'est
l'authentique übermall, le triomphe de l'âge de la
consommation bourgeoise commencé au 19e siècle avec les passages
parisiens de Benjamin et le Bon Marché de Zola. Bien qu'il soit plus
le plus grand mall des Usa (le titre est actuellement disputé
par deux monstruosités, à Schaumberg dans la banlieue de Chicago,
et à King of Prussia, dans la banlieue de Philadelphie), il conserve
l'aura qui lui est attaché pour avoir atteint le premier un nouveau
stade de la fétichisation de la marchandise. La MoA reste unique en
tant que synthèse et paradigme de tous les malls, monument
inégalé de la culture urbaine bien que – pour nombre de ses
critiques – déjà désuet moins de 15 ans après son inauguration
pendant l'été 1992, au point que le Wall Street jounal l'a défini
comme un “dinosaure”.
Même
dans un pays saturé d'espaces commerciaux gigantesques la MoA reste
une expérience saisissante. Les quatre autres grands magasins
(Nordstrom, Mary's, Sears et Bloomingdale's) qui encadrent le mall
sont reliées par des “avenues” sur quatre étages d'une longueur
totale de 5 kilomètres, le long desquelles les visiteurs peuvent
choisir entre 525 magasins et boutiques, mais aussi 18 restaurants,
27 fast-foods et un cinéma multiplexe de 14 écrans. Ces avenues (ou
couloirs) délimitent un espace central de 28.000 m² sous un vaste
toit transparent qui – selon les dépliants – constitue le plus
grand parc à thème couvert dans le monde, avec un aquarium, un
Dinosaur Walk Museum, un immense parc Lego et des montagnes russes.
Comme
tout mall, le MoA est loin du vieux centre ville, puisqu'il a
besoin de terrains bon marché pour ses immenses parkings. Le mall
est le produit de la civilisation de l'automobile et il constitue une
composante essentielle de la culture suburbaine. Il est aussi le
produit de la peur qui ronge les américains – comme tous les
autres citoyens des démocraties parlementaires – gavés par les
mass-médias à l'obsession de la sécurité. Le fantasme des gangs
urbains et – à première vue – l'un des mobiles les plus
importants de la construction des malls : obsédés par la
délinquance, barricadés chez eux la nuit, angoissés par le mythe
de la métropole criminogène et violente, les Américains ont pensé
trouver dans le mall, à partir des années 1970, cette oasis
de tranquillité où ils peuvent se promener la nuit tombée et
laisser leur femme faire du shopping seule, sans se faire agresser.
(Ce n'est pas par hasard si le nom de “mall” vient de
l'avenue bordée d'arbres qui longe Buckingham Palace sur le côté
nord de Saint Jame's Park, où les londoniens se promènent à pied
ou à cheval depuis la fin du 17e siècle pour y faire du shopping).
Tout
dans le mall est destiné à rassurer. Les ascenseurs aux
parois de verre sont conçus pour éviter le “viol en ascenseur”,
topus mythique de la culture américaine. Dans le mall,
les parkings ont des plafonds surélevés et sont éclairés pendant
la journée pour conjurer l'autre grande légende métropolitaine :
l'agression dans le parking. La police privée, parfois à cheval
dans les couloirs, coopère avec le commissariat local de la police
publique, auquelle elle est reliée par radio. Les caméras de
vidéosurveillance vérifient que les adolescents font bien ce qu'ils
sont censés faire – dépenser tout ce qu'ils ont en poche (la
dépense moyenne est de 68,1 $ par visiteur [2]) – et rien d'autre.
Mike Davis a forgé l'expression efficace de “Panopticon Mall [3]”
pour décrire cette institution où le consommateur est constamment
visible (et contrôlable), aux toilettes comme dans les cabines
d'essayage, selon le modèle d'exposition continue à la surveillance
imaginée au début du 19e siècle par Jeremy Bentham pour sa prison
“panoptique” rendue célèbre par Michel Foucault dans Surveiller
et punir.
Mais
comme nous le verrons également dans le cas des villes privées,
l'obsession sécuritaire n'est qu'un facteur parmi d'autres qui ont
contribué à la naissance et au succès des malls. La
principale raison, c'est que, contrairement aux anciens centres
commerciaux qui ne remplissaient qu'une des fonctions traditionnelles
des centres-villes – la fonction commerciale – le mall
aspire à les remplir toutes : lie de loisir (cinéma théâtre),
de socialisation (restaurants, boîtes de nuit, bars), de promenade
(le long des allées couvertes et chauffées). Les malls les
plus importants abritent un ou deux grands hôtels. Dans les allées
couvertes du mall, on croise même des gens qui font leur
jogging au petit matin, avant l'ouverture des magasins. Le mall
fonctionne à la fois comme une avenue et comme une place. On assiste
ici à un processus qui s'est répété souvent au cours de la
modernité : une configuration préexistante, spontanée, est
détruite avant d'être reconstruite artificiellement une fois que le
manque de ce qui a été détruit ou vidé se fait sentir assez
fortement. Au 19e siècle, les rivières qui traversaient les villes
furent enterrées parce qu'on y déversait trop de déchets toxiques,
trop de purins nauséabonds. Mais par la suite, pour reconstituer un
semblant de nature [4] à la place des cours d''eau désormais
enterrés, on commença à creuser des rivières et des lacs
artificiels dans les parcs urbains comme Central Park, le Bois de
Boulogne ou Hyde Park. L'exemple le plus spectaculaire est celui des
Buttes Chaumont à Paris, qui était une décharge d'ordures en
1860 ; en à peine trois ans, les paysagistes du baron Haussmann
transformèrent cette zone malfamée « en une sorte de Suisse
romantique, avec des corniches, ses bois, sa cascade haute d'une
trentaine de mètres, sa rivière, ses lacs, sa gorge enjambée par
un pont et ses rochers. [5] »
Les
promoteurs immobiliers américains ont souvent recours au même
procédé. Pour construire des banlieues à bas coût, ils
aplanissent d'immenses étendues sur lesquelles ils appliquent une
grille de pavillons monofamiliaux et de routes rectilignes qui se
coupent à angle droit : le terrain plat et la structure à
angle droit sont les eux principaux facteurs de sérialité, et donc
d'économies sur les coûts de construction [6]. Mais si par la suite
ces banlieues se gentrifient, le paysage est à nouveau transformé
artificiellement, on reconstitue des petites collines, on creuse des
dépressions, et la monotonie de la grille rectiligne est rompue par
l'introduction de courbes, de petites côtes, de descentes et de
virages : dans le jargon des agents immobiliers, on parle alors
d'introduire des « amenities » (agréments), de faire un
« landscape upgrade » (amélioration du paysage – par
exemple en plantant des arbustes, ceux-là mêmes qui avaient été
arrachés systématiquement au cours de la phase précédente) – ou
encore de créer un « sofscape » (par opposition à
« hardscape », la partie inanimée du paysage urbain)
[7]. Naturellement, cette nature restaurée est à la nature
originelle ce qu'un terrain de golf est à une prairie.
Dans
les cas des malls, le procédé est le même : on recrée
les deux fonctions de l'avenue, de la place et du centre-ville après
que les rues, places et centres des villes ont été dévitalisés.
L'évacuation des rues en tant que « domaine de la sphère
publique » a été menée à terme au 20e siècle, mais elle
avait déjà commencé au 19e siècle, lorsque la route du village a
été supllantée par l'avenue ou le boulevard de la ville. « La
rue du village, écrit Franco Moretti, était certes mille fois plus
pauvre en stimuli que la rue urbaine. Mais en revanche, presque toute
la vie se déroulait dans la rue. » De son côté, la ville a
bien « valorisé la rue comme élément de communication, mais
elle l'a vidée drastiquement comme lieu d'expérience sociale. En
réalité, la grande nouveauté de la vie urbaine n'a pas consisté à
mettre les gens dans la rue, mais à les ratisser et à les enfermer
dans les bureaux et les maisons. Elle n'a pas consisté en une
intensification de la dimension publique, mais en l'invention de la
dimension privée. [8] »
Au
cours de ce processus, actions et activités sont évacuées de la
rue, qui à la place se remplit de signes. Jusque dans les années
1950, dans une ville comme Rome, qui comptait alors deux millions
d'habitants, les soirs d'été, les familles descendaient des tables
et des chaises de leurs appartements où elles se retrouvaient avec
d'autres tablées de familles du quartier. Aujourd'hui, ce serait non
seulement impossible à cause des voitures qui revendiquent le
monopole de l'utilisation des rues, mais surtout impensable : la
mentalité a changé et il semblerait inconvenant d'étaler en public
la familiarité, l'intimité de sa table et de sa cuisine, alors
qu'il est absolument normal de manger en terrasse d'un restaurant.
Il
y a une cinquantaine d'années encore, dans les grandes villes
d'Europe, les enfants jouaient dans le rues, comme les gamins des
romans français du 19e siècle : ils avaient leur organisation
en bandes, leur monde exclusif, libre de conventions adultes, et
leurs propres secrets si précieux, tandis que dans les métropoles
d'aujourd'hui – et pas seulement à cause de la voiture et de
l'angoisse sécuritaire – les enfants ne jouent jamais seuls
dehors, ils sont toujours accompagnés par de plus grands qu'eux :
pendant l'après guerre, reconquérir cette dimension de l'enfance
fut l'une des grandes ambitions qui ont poussé les Américains vers
les banlieues. Comme l'écrivait Lewis Mumford, celles-ci n'étaient
pas « seulement un environnement conçu autour de l'enfant,
mais un environnement fondé sur une vision infantile du monde. [9] »
A
partir du 19e siècle, tandis que s'animait le décor de la voie
publique urbaine, recouverte d'affiches, scandée par les enseignes
et les vitrines, la vie se déplaçait en réalité vers l'intérieur,
dans les magasins, les bureaux, les restaurants, les hôtels. Sur les
boulevards en revanche a éclos le lyrisme de la passante, comme dans
la poésie de Baudelaire [10] : l'inconnue que nous n'aimerons
jamais, les regards qui ne se croisent qu'une fois, le bonheur
entrevu et aussitôt perdu. Le boulevard est devenu le lieu de
l'intimité solitaire, où chacun suit le fil de sa propre
expérience.
La
rue ne reprend qu’exceptionnellement son caractère public :
descendre dans la rue devient une « manifestation », un
acte subversif, puisqu'au quotidien la rue n'est plus qu'un lieu de
connexion entre un lieu privé et un autre. La rue devient le domaine
des professions peu fréquentables, du vendeur ambulant sans-papier
au mendiant, du dealer à la prostituée, dont on dit justement
qu'elle « fait le trottoir ». Que l'agir social dans la
rue soit un signe du passé, c'est ce dont témoigne le grand retour
des marchés en plein air, de l'Union Square à Mouffetard, où
l'étal sur la voie publique produit un délicieux frisson
anachronique, surtout si les légumes vendus sont amish ou
biologiques.
Dans
la ville moderne, la rue, la place sont caractérisées par un vide
de l'agir social et un plein de communication par la marchandise :
les humains communiquent entre eux via des signes qui sont autant de
publicités pour un parfum, un vêtement, un bijou. La principale
activités (en dehors de la conduite automobile) est en réalité ce
qu'on appelle très justement en français le « lèche-vitrine ».
Ce
qui rend cette évacuation de la voie publique si radicale, c'est le
fait que de nombreux plaisirs humains – qui étaient auparavant des
services dont on pouvait bénéficier et qui supposaient donc une
socialisation – peuvent désormais être savourés comme des biens
de consommation, contribuant ainsi à nous isoler dans le privé :
autrefois, pour entendre de la musique, il fallait eller au square où
jouait la fanfare ou dans une salle de concert où se produisait
l'orchestre ; pour voir un spectacle, il fallait se rendre au
théâtre ou au cinéma. Et le cinéma, le square, le théâtre,
supposaient de sorte d'être dehors et donc de se frotter aux foules
humaines, de se trouver en contact, quant tout aujourd'hui nous
pousse à la solitude domestique qui ne communique qu'à travers des
choses possédées : l'ordinateur sur lequel on « navigue »,
le magnétoscope qui nous montre le film qu'on a « acheté »,
le lecteur de CD qui nous permet d'écouter un Mozart qu'on s'est
offert [12]. Pour assister à un duel de gladiateurs, les anciens
Romains devaient aller dans les arènes au Colisée ;
aujourd'hui, on peut acheter le match Tyson-Holyfield sur la
télévision à péage. Tout est fait pour que les services se
transforment en marchandises et l'usage en consommation.
Au
cours de ce processus long de deux siècles qui a vidé les rues et
dilaté à l'extrême la sphère de possession, l'homme moderne a
connu une inversion complète de son état fondamental (ground
state). Pour l'homme pré-industriel, le ground state de
la solitude était le silence : c'était l'immobilité
hiératique des paysans qui restaient sans rien dire pendant des
heures appuyés sur leur bâton ; pour l'homme moderne, en
revanche, le ground state est traversé par un bruit de fond
assourdissant, la solitude est peuplée d'un arrière plan sonore
ininterrompu, chacun de nous est perpétuellement plongé dans
plusieurs activités simultanées : écouter de la musique en
écrivant, lire son courrier électronique en parlant au téléphone,
jouer à un jeu vidéo tout en réfléchissant au titre à donner à
un article, regarder les informations en faisant la cuisine. Dans les
lieux publics, l'homme préindustriel était soumis au contact
physique, sonore, visuel, olfactif, presque bombardé d'odeurs, de
bruits, de corps, sensation que l'on peut retrouver aujourd'hui dans
les villes les plus densément peuplées de l'Inde. Au contraire,
nous traversons la sphère publique dans le silence ouatée d'une
voiture climatisée ou avec des écouteurs dans les oreilles ou en
parlant au téléphone, isolés du contexte, des bruits, des
contacts. Une phobie se diffuse ainsi peu à peu – celle qui frappe
tellement le visiteur qui se rend pour la première fois aux
Etats-Unis – phobie du contact physique involontaire, qui
caractérisait depuis des millénaires l'expérience de la ville. Un
zoning situationnel du corps s'impose : l'unique contact admis
entre deux êtres humains est le contact visuel par l'interaction
sexuelle, en dehors duquel règne un idéal d'isolement, de peur de
contagion, d'horreur des odeurs. Et ces phobies, ces dégoûts du
contact, de la matérialité de l'autre que soi, modèlent peu à peu
d'autres plaisirs trouvés dans une entre soi à l'asepsie
rassurante. Il ne faut pas sous-évaluer ces goûts acquis puisque ce
sont eux qui façonnent notre espace, donc note vivre ensemble, et
qu'ils constituent le ressort du plaisir (du paradis) qui détermine
notre choix.
Ainsi
peu à peu, toute la sphère des rapports sociaux se réduit à la
seule dimension du rapport de marché capitaliste, l'ensemble de la
sphère publique est rabattue sur le domaine de la transaction
commerciale privée. Le caractère pluridimensionnel des interactions
humaines doit être concentré dans l’unidimensionnalité de
l'échange marchand. L'un des exemples les plus significatifs de
cette tendance est la déformation du concept de liberté, qui est
perçu de moins en moins pour sa valeur politique et de plus en plus
comme la possibilité de choisir entre plusieurs marchandises :
être libre, c'est être dans un rayon de supermarché et pouvoir
décider entre plusieurs marques de boîtes de conserve ; ou
encore, c'est l'illusion de la personnalisation devant le buffet de
hors-d'oeuvre, où la conviction de sa propre singularité
non-reproductible tient au dosage au marché, le libre-arbitre se
réduit à la consommation intense avec laquelle un client regarde le
menu du restaurant.
C'est
dans cette configuration de l'univers humain et de l'univers des
marchandises que le mall effectue sa révolution et introduit
la place, la rue, mais sous une forme inversée. Si la place et la
rue étaient un espace public dans lequel venaient s'inscrire des
cadres privés comme les magasins et les étals, dans le mall,
les activités publiques comme la promenade s'exercent dans un espace
privé. Contrairement aux grands magasins et aux supermarchés
traditionnels qui ne faisianet qu'étendre et actualiser la notion de
boutique, une entité comme le mall renferme les activités
publiques dans une sphère, dans un écosystème privé. Le public
est subsumé sous le privé. De ce point de vue, le mall est
l'invention de la place privée, expression qui pourrait sembler
contradictoire dans les termes, dans la mesure où la place a
toujours été synonyme de « public » et de
« politique » : le forum, ou l'agora,
était un lieu public destiné à la fois au marché et à la
politique, le centre des échanges non seulement marchands mais aussi
humains, et le lieu ou se constituait la polis ou la res
publica.
Pour
se rendre compte du gouffre qui sépare le mall de la place
traditionnelle, il suffit de penser qu'à une certaine heure le mall
ferme, tandis que l'idée qu'une place puisse « fermer »
est absurde. Il y a un « propriétaire du mall »
tandis qu' « un propriétaire de la place » est
inconcevable : le mall est une place dotée de serrures
et de systèmes d'alarme. Domaine des rencontres complices dans le
fodd court ou des flirts dans la queue devant les caisses, le mall
est le lieu où la socialité tout entière est subsumée sous la
dimension de la marchandise.
Et
si le privé consiste à être à l'intérieur, enfermé, si ce n'est
physiquement, mentalement du moins, on comprend mieux
l'extra-ordinaire laideur de l'extérieur du MoA : ses
constructeurs ne se sont pas donné le moindre mal pour le rendre
agréable à la vue puisque personne n'est censé le regarder de
l'extérieur. Il n'y a aucune raison de se promener autour du mall.
Cette implosion de l'extérieur vers l'intérieur est d'autant plus
significative que le MoA se présente comme le lieu à visiter, une
attraction touristique. Au même titre que Disney World à Orlando,
mais là aussi inversé : tandis que Disney World est un immense
parc d'attractions avec des magasins à l'intérieur, le Mall of
America est un immense magasin abritant un parc d'attractions.
Resta
à se demander combien de temps durera ce bonheur procuré par le
mall et sa dialectique de l'inversion. Ou, autre manière de
poser la question, jusqu'à quel point une société peut elle être
réduite à un marché de consommation. Deux stratégies en apparence
alternatives au mall fermé ont été développées au début
du 21e siècle par les promoteurs : la transformation en mall
des quartiers historiques urbains et la création de centres-villes
néo-traditionnels faussement historiques. La privatisation
croissante de la vie des classes moyennes dans les banlieues a donné
lieu à une nostalgie de la légende de la ville et de l'espace
urbain. Mais avec les lifestyles centers, c'est encore une
urbanité dénaturée et des versions soigneusement conditionnées de
la foule qui s'offrent à elles.
Pour
l'essentiel, un lifestyle center est un mall en plein
air, « jalonné de fontaines et de bancs [13] »,
c'est-à-dire la reconstruction d'une rue de village, ou plutôt
d'une zone piétonne : « un espace en plein air – comme
un joli petit village. [14] » L'idée est de singer le vieux
centre-ville : « Le lifestyle center développe le
modèle du shopping mall en combinant les qualités fictives du
centre-ville commerçant avec le mécanisme de contrôle du mall.
C'est toujours un espace commercial soigneusement contrôlé, mais
avec le charme du grand air que son public visé a pu trouver sur les
lieux de vacances, comme le quartier commerçant new-yorkais de Soho,
mais sans l'Eurotrash [15]. »
Victoria
Garden à Rancho Cucamonga (Californie) à une heure de route de los
Angeles, en est un bon exemple. Sa construction a été décrite par
Karrie Jacobs [16]. L'un des adjectifs du lifestyle center,
écrit Jacobs, est « une approximation de la belle vie. Et la
belle vie réside en grande partie dans la mémoire. C'est pourquoi
[Victoria Garden] est construit sur une trame urbaine à l'ancienne,
avec ses rues étroites encombrées et ses véritables parcmètres. »
Jacobs se dit « impressionnée par le soin avec lequel ont été
reconstituées les paysages des rues », avec des fontaines, des
arbres, des lampadaires sagement modernes, quelques placettes
recouvertes de pelouse et des styles de matériaux architecturaux
variés. Les promoteurs ont étudié les centres-villes californiens,
en remontant jusqu'en 1854, et les ont photographiés pour relever
les détails qui permettraient d'accroître l'authenticité de
Victoria Gardens. Les architectes eurent pour mission de construire
les maisons dans des styles de différentes époques pour
reconstituer la stratification historique des centres-villes.
Certaines furent même un peu abîmées à dessein pour leur donner
la patine nécessaire, tandis qu'au coin des rues furent apposées
des enseignes publicitaires rappelant de vieilles marques disparues :
« Nous les appelons les murmures de l'histoire »,
expliqua un promoteur. L'objectif est ici de créer dans l'ordre du
temps ce qu'est un trompe-l'oeil dans celui de l'espace : un
faux souvenir.
Il
faut faire attention ici à ne pas s'enliser dans la diatribe sur
l'authenticité et le stéréotype heideggerien de l'Amérique comme
terre d'élection de l'inauthentique et de la Geistlosigheit qui,
selon l'expression de Rilke, transforme les objets en
« pseudo-choses ». Premièrement parce que les vieilles
cités « authentiquement » médiévale de l'Europe
continentale (Liège, Lille... la liste est très longue) ont
transformé leurs propres centres en lifestyle centers, avec
des zones piétonnières toutes identiques qui, le soir, après la
fermeture des magasins, sont aussi mortes que les quartiers
commerçants américains. Et deuxièmement parce que les faux
souvenirs peuvent être aussi douloureux et intenses que les vrais,
comme le montrent les faux souvenirs induits par l'hypnose.
Le
vrai problème des lifestyle centers, qui était déjà celui
des malls, c'est qu'ils tentent de résoudre une équation
impossible : comment avoir une ville sans ville. Les rues
piétonnes du lifestyle center se heurtent à l'expérience de
se garer le plus près possible des magasins ; l'apparence de
faux centre-ville rend impossible les indispensables parkings sans
fin. De manière plus générale, on recherche à la fois le confort
de la faible densité suburbaine et la surabondance de services de la
ville traditionnelle. Deux utopies inconciliables : « Les
habitants de Paris ont une très petit quantité d'espace qui leur
appartient et énormément
d'équipements publics. Nous avons une énorme quantité d'espace qui
nous appartient et que nous contrôlons
et très peu d'équipements publics », comme le résume un
urbaniste américain. [17]
Si
la ville est, selon la célèbre définition de Robert Park, « une
mosaïque de petits mondes qui se touchent mais ne s'interpénètrent
pas », qui « encourage l'expérience fascinante mais
dangereuse de vivre simultanément dans quantité de mondes
différents, contigus mais nettement séparés « et introduit
« un élément de hasard et d'aventure qui […] lui confère,
pour des nerfs jeunes et frais, un attrait particulier [18] »,
il est certain que ni le mall
ni le lifestyle center
ne disposent des bonnes cartes pour jouer le jeu de l'excitation et
du charme dangereux. On tombe rarement sur l'inconnu dans un espace
fermé, et les lifestyle centers n'ont
que l'apparence du plein air : leur nature privée (et fermée)
apparaît immédiatement à certains détails, comme l'interdiction
de prendre des photos dans certains d'entre eux. Il ne peut y avoir
ni excitation ni aventure quant tout est sous contrôle.
Comme
Achille poursuivant la tortue sans jamais l'atteindre, les malls
et les lifestyle centers
sont condamnés à l'échec parce qu'ils cherchent un compromis
impossible entre d'un côté, l'utopie du privé, du contrôle, de la
possession, et de l'autre, le frisson de la vie citadine. Pour
réaliser le grand rêve capitaliste, celui de faire rentrer toute la
sphère publique dans le domaine du privé, malls
et lifestyle centers
ne représentent que des demi-mesures. Dans un climat bien différent
de celui du Minnesota, une solution bien plus radicale a vu le jour
dès les années 1960.
ARIZONA : UTOPIES
SENILES
Depuis plus de quarante
ans, à 25 kilomètres au nord-ouest de Phoenix se déroule une des
expérimentations sociales les plus impressionnantes (et les moins
étudiées) de l'histoire de l'humanité. L'image aérienne montre
une sorte de tableau de Paul Klee sur le fond ocre du désert, une
planimétrie mixte, où les promoteurs ont superposés à la grille de
base une structure de rangées circulaires de pavillons identiques,
disposées autour d'espaces verts stratégiques : un softscape,
mais reproduit en série, symbole de luxe bon marché. Si on zoome
légèrement, deux petits lacs apparaissent, autre élément
indispensable du landscape upgrading, surtout dans une zone aussi
aride que l'Arizona. Nous sommes à Sun City, prototype de centaines
d'agglomérations semblables aux USA. De même que le Mall of America
est le mastodonte des centres commerciaux, Sun City est une ville
privée (ou selon le terme technique, une « planned
community ») catégorie « super lourds ». Malgré
le mur élevé qui l'entoure, avec ses 38.309 habitants (recensement
2000), ses 18 centres commerciaux, 43 banques, sept centres de
loisirs, 25 églises, trois bibliothèques et deux hôpitaux, Sun
City représente déjà quelque chose de « plus », au
delà de l'idée de gated community qui a tant frappé notre
imaginaire, des enclaves de la peur du Los Angeles de Mike Davis aux
immeubles fortifiées de São Paulo de Teresa Caldeira [19].
La peur panique de la
criminalité a été et reste aujourd'hui l'un des motifs principaux
de l'explosion du Common Interest Development (CID), dont les
planned communities constituent le secteur dont
l'expansion est la plus rapide – les deux autres formes sont les
condominiums (copropriété) et les cooperatives
(coopératives d'habitations). Pour mesurer cette expansion, il
suffit de penser qu'alors qu'en 1970 on comptait 10.000 CID aux USA,
en 1980 ils étaient 36.000, en 1990 130.000 et en 2002 230.000. Si
en 1992, 30 millions d'Américains vivaient dans 150.000 CID [20],
dix ans plus tard ils étaient 46 millions (données du Communty
Association Institute, 2002). Mais comme dans le cas des malls,
l'angoisse sécuritaire n'est que l'in des facteurs qui ont fait la
fortune des CID, et selon moi, sans doute pas le principal, puisque
les communities réellement gated ne constituent qu'un cinquième des
CID (ce qui porterait à environ 9 millions le nombre d'Américains
vivant à l'intérieur d'une enceinte. [21])
Du point de vue de la
taxinomie légale, une agglomération comme Sun City est
conceptuellement à l'opposé des Gated condiminiums comme les
gratte-ciel du complexe Morumbi à Sao Paulo, ou des enclaves
enfermées comme Rolling Hills à Los Angeles ou Landmark Village à
Chicago. Une enclave est précisèment une île fortifiée privée au
milieu de l'océan public d'une ville. La gated community urbaine ne
fait donc qu'étendre la copropriété classique. Dans les villes
européennes où l'immense majorité des habitants vit en
appartement, la copropriété est depuis un siècle la forme de
logement la plus répandue. De ce point de vue, l'enclave urbaine
n'introduit aucune nouveauté dans le paysage urbain traditionnel, se
contentant d'en exaspérer les caractéristiques privées. De même
que les copropriétés de standing ont un portier à l'entrée, les
enclaves modernes ont des barrières surveillées par des équipes de
vigiles.
Une ville privée, en
revanche, n'est pas une île privée découpée dans un univers
public, mais un environnement privé qui inclut et réglemente aussi
la dimension politique. Ce n'est pas une sécession du privé par
rapport au public, mais un véritable gouvernement privé qui encadre
les activités publiques.
Si le terme grec polis
est à l'origine de la catégorie de « politique », la
« ville privée » est la privatisation de la politique
même. Son parlement est la homeowner association (association
des propriétaires), qui correspond à l'assemblée des
copropriétaires dans une copropriété. Son corps législatif est
constitué d'un « volumineux ensemble de décrets et de
règlements – parfois appelés ''servitudes équitables'' ou
''engagements, conditions et restrictions'' (Covenants, Conditions
and Restrictions), CC&R, dans le langage courant) – augmenté
d'arrêtés sur le titre de copropriété. [22] » Son
gouvernement prélève des impôts sous forme de charges et utilise
ces revenus pour gérer les infrastructures (égouts, revêtement des
rues...) et les services « publics » :
bibliothèques, pompiers, forces de police privées (et souvent
volontaires). Comme dans la polis de la Grèce antique, et
contrairement à l'Etat public moderne qui ne prévoit pas l'exil de
ses administrés, un citoyen qui ne se plie pas aux CC&R (souvent
oppressifs) peut y être frappé d'ostracisme, et pas conséquent
obligé de vendre son logement et chassé de la planned
community.
La ville privée
constitue donc une révolution conceptuelle bien plus ambitieuse que
le mall et présente une dimension utopique qui donne à la
« Privatopia » d'Eden McKenzie un sens beaucoup plus
précis et inquiétant qu'il ne l'avait sans doute imaginé en
inventant ce terme en 1993. Une Amérique où tous les gouvernements
locaux seraient remplacés par des villes privées – représenterait
rien moins que la réalisation de la société de Nozick [23] »,
cet Etat ultra-minimal théorisé en 1974 par le partisan de
l'anti-étatisme Robert novick, dont la furie « publicoclaste »
est telle qu'il considère que la redistribution des revenus est une
« violation des droits du peuple » et que « la
taxation des revenus du travail est comparable au travail forcé
[24] ». Sun City (et toutes ses petites soeurs disséminées
sur le territoire américain), bien plus qu'une forteresse assiégée
par la criminalité et le quart-monde, se présente comme la
réalisation d'une utopie.
Comme de nombreuses
utopies, la ville privée tend vers le totalitarisme. Le contrôle
panoptique qui s'y exerce rappelle les communautés jésuites du
Paraguay au 17e siècle, dans lesquelles les rues étaient surélevées
pour que les pères puissent surveiller à travers les fenêtres la
vie privée des indiens. La liste des CC&R est aussi bizarre
qu'interminable. On peut se voir interdire de peindre ses persiennes
en bleu, de planter un drapeau devant son fronton ou d'avoir un
animal domestique. Une grand)mère de 51 ans apprit un jour qu'elle
était sous le coup d'une accusation de violation des règles de la
homeowner association parce qu'elle « avait
embrassé et fait de vilaines choses » dans sa voiture garée
sur un parking (elle reconnut seulement avoir embrassé un ami pour
lui souhaiter bonne nuit et intenta un procès à l'association). A
Leisure World (Arizona), la troupe du shérif découvrit que des
membres de la homeowner association « avaient des
rapports sexuels dans leur piscine » et les dénonça [25].
Mais
la ville privée est totalitaire pour une raison plus sérieuse :
à l'intérieur de son enceinte, les droits constitutionnels ne
s'appliquent plus. De même que la liberté de la presse n'existe pas
chez moi, puisque ne peuvent y entrer que les journaux de mon choix,
de même dans la ville privée, le premier amendement de la
Constitution américaine ne s'applique pas. Un exemple fameux est
celui du journal Leisure World News, dans la
ville privée du même nom en Arizona [26], dont le conseil
d'administration fit arrêter la parution. Ces dénis de droit et ces
vexations rendent d'autant plus incroyable l'énorme succès des
planned communities.
En
1970, la forme la plus répandue était donc la cooperative,
suivie par les planned communities et, loin derrière,
les condiminiums. Entre 1970 et 1980, la croissance la plus
forte est celle des condiminiums (multipliés par 30), tandis
que les planned communities dépassaient les
cooperatives. Entre 1980 et 1990, la croissance s'est
poursuivie pour les trois types, mais les planned communities
ont été quasiment multipliées par 10, bondissant en tête des
formes d'habitat en CID. Entre 1990 et 1998, le nombre de
cooperatives a diminué tandis que la croissance des
condiminiums ralentissait (seulement 4,8 % sur la période) et
que celle des planned communities restait forte quoique
nettement inférieure à celle de la décennie précédente (+ 177
%). On peut voir les courbes inversées des cooperatives et
des planned communities comme un témoignage
géométrique de la victoire de l'idéal privatiste sur l'idéal
socialiste.
Mais
si le contrôle social est si envahissant et intruisif, si la liberté
est réduite au point qu'on ne puisse pas repeindre ses persiennes
comme on en a envie, qu'est-ce qui provoque ce véritable exode vers
les villes privées ? Tout d'abord, quiconque achète une maison
dans une ville privée sit parfaitement à quoi s'en tenir :
selon la théorie des « choix rationnels », il fait la
part des plaisirs et des obligations et voit donc ces CC&R comme
le « prix à payer » pour son bien-être. En fait, c'est
même le caractère total du contrôle et l'absence d'individualité
qui sont peut-être les plus rassurants pour les acheteurs. Comme le
dit cet habitant d'une ville privée à propos de son ancien
quartier : « il n'y avait pas assez de contrôle […] On
ne pouvait pas maintenir l'environnement dans lequel on avait cru
emménager [28]. » C'est leur totale prévisibilité qui
constitue l'attrait irrésistible des planned communities.
Mais
les CC&R qui régissent les planned communities comportent un
aspect plus sinistre encore. Récemment, une de mes connaissances est
allée voir ses parents qui vivent dans une gated community en
Californie. En arrivant, elle a salué le jardinier mexicain, qui ne
lui a pas répondu et qui s'est même enfui lorsqu'elle a essayé
d'échanger quelques banalités avec lui. « Tu es folle !
- lui a dit sa mère – ici si un Mexicain adresse la parole à un
résident, il se fait virer. » L'idéal d'ordre semble
indissociablement lié à l'homogénéité socioéconomique et
racial : l'hétérogénéité est source de désordre et
d'anxiété. Ce n'est pas un hasard si le boom des CID a coïncidé
avec le reaganisme : de même que la Proposition 13 (la fameuse
initiative anti-taxation votée le 6 juin 1978, soit deux ans avant
l'élection de Ronald Reagan à la présidence des Etats-Unis) était
une révolte des riches contre les pauvres, de même les CID ont été
définis par Robert Reich comme la « sécession des vainqueurs
[29]. » De fait, elles se sont avérées être des expériences
de re-ségrégation extraordinairement efficaces : selon le
recensement de 2000, 195 Afro-américains vivaient à Sun City (pour
38.309 habitants) et seulement 41 dans son équivalent californien
Leisure World (16.507 habitants).
Mais
la restriction la plus stupéfiante est celle qui concerne l'âge.
Les communautés de personnes âgées ne sont pas un phénomène
récent aux USA : « Certaines remontent aux années 1920,
lorsque diverses organisations syndicales, fraternitaires ou
religieuses achetèrent des terres à bon prix en Floride dans
l'intention de créer un cadre de vie favorable pour leurs membres
retraités. Moosehaven, par exemple, fut créé en 1922 par la
fraternité « Loyal Order of Moose » […] d'autres
communautés parrainées furent créées en Florids à des fins de
bienfaisance jusqu'à ce qu'une série de catastrophes, culminant
avec le krach boursier de 1929, mette un terme à leur développement.
L'après guerre fut une nouvelle ère de croissance pour les
communautés de retraités, à l'initiative désormais des promoteurs
privés, en Florids et ailleurs, qui découvraient le potentiel
commercial granidssant que représentait le popualtion des retraités
américains [30]. » Mais personne n'avait jamais créé de
villes privées pour vieux.
Le
1er janvier 1960, lorsque le promoteur Del E. Webb inaugura Sun City
en Arizona, la première communauté privée en Amérique et dans le
monde réservée aux plus de 55 ans, il n'imaginait pas qu'il était
en train de déclencher une révolution sociale. Deux ans plus tard,
il faisait la couverture du magasine Time et d'autres promoteurs
ouvraient une autre « gated adult community », Leisure
World, à Seal Beach, en Californie (d'autres communautés
franchisées Leisure World apparurent par la suite en Arizona et dans
le Maryland. Webb lança par la suite une Sun City en Californie et
une autre en Floride, puis dans les années 1970 une Sun City West
(26.000 habitants en 2000) à quelques kilomètres de l'originale, et
à la fin des années 1980 une Sun City Grand non loin de là, pour
un total de près de 100.000 habitants de plus de 55 ans. Si l'on
inclut Leisure World, à quelques kilomètres à l'est de Phoenix,
cette région représente la lus grande concentration mondiale de
villes privées pour personnes âgées.
A
l'évidence, les facteurs climatique et économique ont joué un
grand rôle dans le succès fracassant des Sun Cities : un
climat sec et chaud, idéal contre l'artrite et les rhumatismes, du
soleil toute l'année, des terrains à bas coût et donc des maisons
abordables (en 2003 une maison coûtait 118.000 dollars en moyenne à
Sun City, un prix très raisonnable) et un régime fiscal
intéressant. Mais ces raisons ne suffisent pas à expliquer pourquoi
tant de personnes âgées ont opté pour la ségrégation volontaire.
Dans
l'histoire de l'humanité, aucune civilisation n'a jamais imaginé
que les vieux devaient être rassemblés et mis à l'écart. Quatre
ans seulement avant l'inauguration de Sun City, Lewis Mumford
écrivait : « Il n'y a pas de pire attitude à l'égard de
la vieillesse que de considérer les personnes âgées sont un groupe
à part et qu'elles doivent, à un moment de leur vie […] être
mises à l'écart de leurs responsabilités et leurs centres
d'intérêts normaux [31]. » Personne n'aurait pu imaginer
qu'en l'espace de quelques années, les personnes âgées auraient
commencé à aspirer à la ségrégation.
Pour
les européens, qui n'ont pas encore l'habitude des communautés de
retraités, l'idée que des personnes âgées souhaitent vivre entre
elles constitue toujours un choc. Et ce sont les mass-médias
européens qui continuent à visiter ces villes avec étonnement,
comme un reportage de l'influent Die Zeit ou dans un
documentaire de la chaîne franco-allemande Arte [32]. Aux
Usa, en revanche, le phénomène est tellement répandu que depuis la
fin des années 1970, elles ne constituent même plus objet un objet
de réflexion. Les livres et articles sur le sujet sont beaucoup
moins nombreux qu'on pourrait l'imaginer et surtout, la plupart sont
datés. On y fait la part des avantages et des inconvénients des
« gated retirment communities », mais le désir de
ségrégation volontaire semble presque naturel et n'est jamais mis
en question. Pour la plupart des Américains, cette aspiration va de
soi, et beaucoupd de connaissances dont les parents vivent dans les
« adult retirment communities » en vantent le confort et
la commodité. Aujourd'hui, un candidat au poste de sénateur ne
pourrait plus se permettre d'ironiser lourdement sur ces villes de
vieux au cours de sa campagne, comme l'avait fait John McCain en
1986 : lors d'un discours devant des étudiants, il « fit
de nombreuses références à ''Seizure World'' [Monde de la
Convulsion, ou de l'Attaque], en ménageant des pauses pour les rires
[…] Il plaisanta aussi sur le fait qu'à la dernière élection, 97
% des électeurs de Leisure World avaient voté : ''Les 3 %
restants étaient en soins intensifs'' ».
L'affection
des grands-parents pour leurs petits-enfants est peut-être un topos
du sentimentalisme mondial mais à Sun City, les moins de 18 ans font
partie des nuisances : ils peuvent y rester 30 jours par an, pas
plus, de préférence pendant les vacances scolaires. Et ils ne
peuvent utiliser la piscine que le dimanche entre 10 heures et midi.
La limite d'âge n'admet pas d'exception : à Leisure World
(Arizona) un médecin âge de 42 ans « fit une dépression
nerveuse et devint incapable de travailler et vivre seul, et ses
parents décidèrent de l'accueillir chez eux ». Le problème
était la limite d'âge : à 42 ans, on ne peut pas vivre à
Leisure World. « Si les parents voulaient continuer à
s'occuper de leur fils mal en point, ils devaient déménager »
et « ils allaient le faire. Ils allaient déménager. Ils
avaient compris que l'association appliquerait les règles s'il le
fallait [35]. »
Sur
les raisons qui poussent à fermer la porte aux mineurs, une première
réponse est apportée par Teresa Caldeira qui observe : « L'un
des principaux problèmes révélant la difficulté de créer et de
respecter des règles communes est le comportement des adolescents,
spécialement les garçons », et qui cite un habitant d'une
communauté sans restriction d'âge : « Ce qui nous
préoccupe le plus est la sécurité interne, nos propres enfants. Le
problème de la sécurité externe a été résolu depuis longtemps
[36].Les adolescents ont des accidents de voiture, ils font du bruit
la nuit, bref, ils sont un facteur de « désordre ».
la
seconde réponse me fut apportée par William Boone, un professeur de
sciences politiques à la Clark University d'Atlanta. Quand je lui ai
demandé pourquoi les étudiants doués qui avaient la possibilité
de s'inscrire dans une prestigieuse université de la Ivy League
choississaient délibérement la ségrégation dans une université
comme la Clark Atlanta, il m'a répondu : « Il ne faut pas
négliger la fierté d'être majoritaire, de ne plus être une petite
île de couleur dans un océan de blancs [37]. » Dans une
société ségrégative, mieux vaudrait en somme choisir la
ségrégation plutôt que la subir. On peut d'ailleurs expliquer le
choix de la ségrégation par des ressorts plus secrets, comme la
sexualité, déniée aux personnes âgées par un jeunisme triomphant
que la vision superposée d'orgasmes et de chairs flasques et ridées
horrifie. Dans les communautés réservées aux personnes âgées,
l'érotisme peut sans doute dévoiler sans pudeur, sans honte de la
déchéance de son propre corps : les journaux locaux font
souvent état de scandales provoqués par des vieux messieurs qui se
baignent nus (le journaliste de Die Zeit rapporte que
les hommes appellent la piscine de Sun City « la trempette des
veuves ») et les habitants de Sun City sont (peut-être les
seuls citoyens américains) fiers de pouvoir rebaptiser leur ville
« Sin City ».
Mais
même si l'on tient compte de ces facteurs, une zone grise demeure.
Au dernier recensement de 2000, l'âge moyen à Sun City était de 75
ans et 17,5 % des habitants avait entre 45 et 64 ans, et 79,8 % 65
ans ou plus. Ce sont bien ces 17,5 % qui posent problème : dans
cette phase d'âge, beaucoup ne sont pas encore retraités et se
rendent tous les jours à Phoenix pour travailler. Qu'est-ce qui les
pousse à rester parmi cette population plus âgée ? Qu'est-ce
qui les attire ? Peut-être justement l'absence de jeunes, le
caractère fermé et ordonné, la stratification rigide de la ville
privée. Car, et c'est le second point non transparent, les jeunes ne
sont pas absents de Sun City. Ce sont eux qui font fonctionner la
ville : ils sont employés dans les restaurants, dans les
banques et les centres commerciaux, serveurs dans les restaurants,
maître-nageurs à la piscine, jardiniers dans les parcs et caddies
sur les terrains de golf. Dans la ville sénile, les jeunes ont le
statut des travailleurs immigrés. La jeunesse est synonyme
d'infériorité sociale.
Car
les hiérarchies sont rigides : même dans le tiers supérieur
du barème des revenus, il y a les riches et les pauvres :
certaines furent pratiquement ruinées par la cris des fonds de
pension fin 2000, si bien que certains retraités durent aller
travailler comme employés dans les centres commerciaux pour arrondir
leurs fins de mois. Il y a des villes privées plus luxueuses et
d'autres plus modestes, selon les bourses, Sun City grand, par
exemple, est plus opulente que la Sun City originale, ses rues plus
larges, ses piscines plus grandes, et la cotisation annuelle – qui
permet d'entrer gratuitement dans les piscines, les salles de gym, de
bowling et de billard – y est plus élevée (675 dollars contre 180
à Sun City). Mais au sein d'une même ville, il y a aussi des
différences : les maisons coûtent plus ou moins cher, selon la
superficie et les finitions, selon qu'elles donnent sur le lac ou sur
le terrain de golf.
Parce
qu'un cité du soleil ne se conçoit pas sans son terrain de golf, à
Sun City, il y en a onze. Et le golf est un must qui se pair « en
plus ». Il est d'ailleurs souvent cité comme l'un des
principaux motifs incitant à s'installer dans une de ces villes. Le
glof comme une certaine idée du luxe, de l'oisiveté hygiénique, un
signe d'appartenance à la classe de loisir veblenienne. En plein
désert, les terrains de golf engloutissent des torrents d'eau – et
l'intensité du vert donne la mesure chromatique immédiate du rang :
plus la pelouse est pelée et jaunissante, plus la ville privée est
ordinaire. La vieillesse s'offre ici en toute innocence un ultime
gaspillage, un ultime affront à la nature : « après moi
le déluge », pourrait être la devise de ces nouveaux Louis XV
à visière filant dans leurs voiturettes. Elles étaient autrefois
électriques mais un commerçant de Sun City en propose désormais de
nouvelles qui marchent à l'essence et vont jusqu'à 60 km/h –
évidemment, le nombre d'accidents à augmenter en proportion.
Ce
sont les terrains de golf qui font que, dans la typologie des villes
privées, les villes pour personnes âgées relèvent de la catégorie
des lifestyle communities. C'est là que notre cercle se referme
puisque, comme on l'a vu, ce sont les lifestyle centers singeant les
centres-villes d'autrefois qui constituent le dernier cri en matière
de planification urbaine. Lifestyle apparaît ainsi comme l'autre nom
de la privatisation, privatisation de la place publique et
privatisation de la ville, puis de la politique tout entière. En
1990, Leisure World, en Californie, fut la première communauté
privée pour personnes âgées à décider par référendum de se
constituer en ville, sous le nom de Laguna Woods. Ce fut donc la
première structure privée pour personnes âgées à devenir sujet
politique au sens plein et constitutionnel.
En
ce sens, Sun City (comme tous ses épigones) incarne une double
utopie : utopie de la propriété de la ville privée d'un côté,
utopie de ségrégation volontaire de la ville de vieux de l'autre –
un ordre fondé sur la richesse, la race et l'âge. Une utopie des
rues propres sans le vacarme des enfants, où il nepleut pas. Nul
hasard si son nom s'inspire du titre des chefs-d'oeuvre utopiques de
la philosophie occidentale. La città del sole de Tommaso
Campanella, connu en langue anglaise sous le titre The City of
Sun, mais qui serait plus proprement The Sun City, habitée par
les solari, les « solaires ». Le prophétique
Campanella n'avait simplement pas précisé que les « solaires »
jouaient au golf.
Marco
d'Eramo
From
Minnesota to Arizona
Du
Minnesota à l'Arizona
Le
rêve americain d'une ville sans ville.
Dans l'ouvrage sous la direction de Mike davis et Daniel B. Monk :
Evil
Paradises. Dreamworlds of Neoliberalism.
The
New Press, New York, 2007
Paradis
Infernaux, les villes hallucinées du néo-capitalisme
Les
Prairies ordinaires, 2008.
NOTES
1.
Wall Street Journal, 3 octobre 2003.
2.
Donnée fournie par le ICSC.
3.
Mike Davis, City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur.
1997
4.
Sur la réintroduction de la nature dans la ville, voir la revue
Communications n°74, 2003 ; en particulier Isabelle
Auricoste.
5.
Michel Ragon, Histoire de l'architecture et de l'urbanisme
modernes, 1986.
6.
Sur la naissance de la grille urbaine et ses modifications :
Kenneth T. Jackson, Crabgrass Frontier. 1985
7.
Joël Garreau, Edge City, 1991
8.
Franco Moretti, Homo Palpitans, dans Signs taken for Wonders,
1987.
9.
Lewis Mumford, The City in History. 1964.
10.
[…] Fugitive beauté […] Ne te verrai-je plus que dans
l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici Trop tard ! Jamais
peut-être Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Charles
Baudelaire. A une passante. Les fleurs du mal. 1857
11.
Pour une analyse plus complète de la désertification des rues, voir
Marco d'Eramo, Il maiale e il grattacielo. 2004
12.
Un processus analogue à celui qui eut lieu dans l'Antiquité
tardive, lorsque la désertification des cités entraîna un déclin
du théâtre, qui était joué dans les espaces publics, et l'essor
du roman, qui pouvait être lu dans l'intimité de la sphère privée.
Voir Franck Altheim, Gesicht von Abend zum Morgen, 1955.
13.
Usa Today, 8 avril 2004.
14.
CNN/Money, 12 janvier 2005.
15.
Theboxtank (un blog collectif centré sur l'urbanisme) ;
n'existe plus.
16.
Karine Jacobs, The Mandchurian Main Street. 16 mai 2005 :
www.metropolismag,com
17.
Cité dans Garreau, op. cit.
18.
Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Roberick McKenzie, The City.
1967
19.
Mike Davis, City of Quartz, 1997.
20.
Evan McKenzie Trouble in Privatopia, The progressive, octobre
1999.
21.
Edward Blakeley et mary Gail Snyder, Fortress Amreica, 1997.
22.
McKenzie, Commom-interest in the Community of Tomorrow, Housing
Policy Debate, 2003.
23.
Ibid.
24.
Anarchy, State and Utopia. Basic Books.
25.
Amarillo Globe News, 29 juin 2001.
26.
Cité dans Garreau, op. cit.
27.
McKenzie, op. cit.
28.
Cité par Blakeley et Snyder, op. cit.
29.
Cité par McKenzie, Privatopia, op. cit.
30.
Michael E. Hunt (dir) retirment Communities, 1984.
31.
Lewis Mumford, « For older People ». architectural
record, mai 56.
32.
Emil Bloch, Ein Platz en der Sonne, Die Zeit, juin 2003.
33.
il faut également mentionner – outre Michael Hunt – Katherine
McMillan Heintz, et du point de vue de la géographie humaine et des
études urbaines la panoram d'ensemble de Hubert B. Stroud. Pour des
références bibliographiques voir aussi Raymond J. Burby et Shirley
Weiss.
34.
New York Times, 5 octobre 1986.
35.
Garreau, op. cit.
36.
Teresa Caldeira, op. cit.
37.
Entretien avec l'auteur dans Marco d'Eramo, Via dal vento.
Rome 2004.
LIENS
Del Webb Sun City Arizona
Film promotionnel SUN CITY
Années
1960
Parties
1 et 2 :






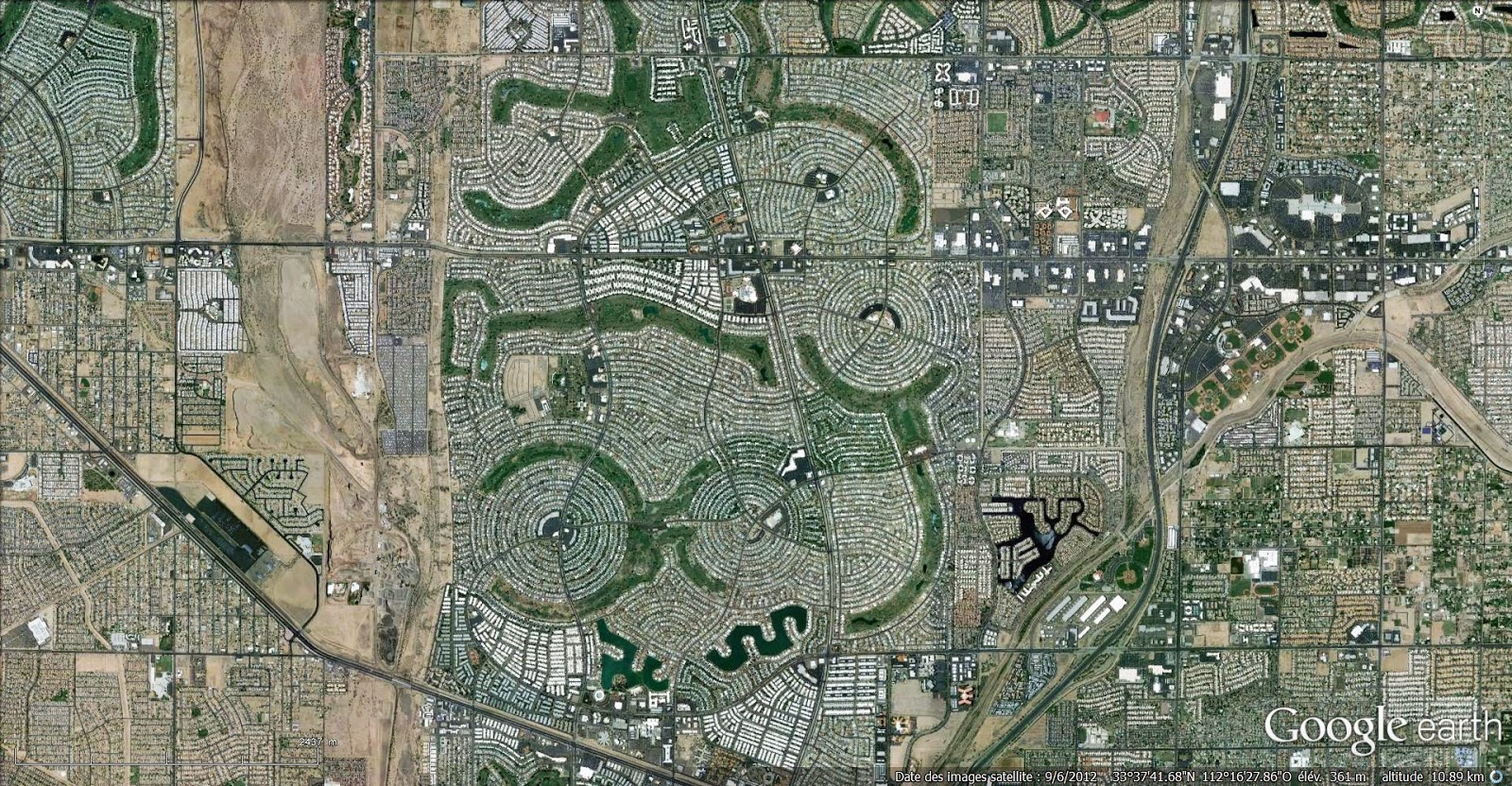




Analyse intéressante, un peu trop parsemée de terminologie socialiste a mon goût.
RépondreSupprimerSinon d’où vous viens cette haine des vieux et des riches moins cultivés que vous?