RÉGIS
DEBRAY
Trace,
forme ou message ?
Cahiers de Médiologie | 1999
Le
bipède qui enterre ses morts pose quelques cailloux sur le lieu
d’inhumation (le chimpanzé émet des signaux, instrumente
éventuellement une branche d’arbre, mais ne monumentalise rien,
pas plus qu’il n’ensevelit ses congénères). Le monument naît
de la mort, et contre elle (il en avertit les vivants, du latin
monere). Il matérialise l’absence afin de la rendre voyante
et signifiante. Il exhorte les présents à connaître ce qui n’est
plus et à se reconnaître en lui (du monumentum comme cours
d’instruction civique avant la lettre).
C’est
à la fois un support de mémoire et un moyen de partage.
L’art
premier ?
L’outil
par excellence d’une production de communauté. Si on appelle
culture la capacité d’hériter collectivement d’une expérience
individuelle que l’on n’a pas soi-même vécue, le monument, par
ceci qu’il attrape le temps dans l’espace et piège le fluide par
le dur, est l’habileté suprême du seul mammifère capable de
produire une histoire. N’importe quel étudiant en anthropologie
aurait pu formuler ces vérités premières. Comme seuil obligé de
l’histoire culturelle, le « qu’est-ce qu’un monument? » est
une question de cours. La question proprement médiologique se lève
un pas au-delà (ou en deçà) : qu’est-ce que la technique fait à
la culture ? Et en l’occurrence, qu’est-ce que l’évolution des
mnémotechniques (devenues considérablement plus légères et moins
coûteuses, plus parlantes et portatives que le bâti ou le sculpté)
a modifié quant à nos pratiques monumentales ? Il s’agirait en
somme, pour s’autoriser d’auteurs connus, de transporter le
Denkmalkultus de Riegl « à l’ère de la reproductibilité
technique » de Benjamin… Quels effets ont nos nouvelles
technologies de transmission et de stockage sur l’institution
monumentaire, et au-delà, sur notre faculté d’«éterniser des
choses mémorables» (qu’il serait aventureux de prendre pour un
invariant universel) ? Quel rapport entre l’Éternité et la
mousson, les matériaux friables comme le bois et la pierre ? Entre
l’idée de mémoire et l’humidité de l’air ? C’est derechef
du court-circuit saugrenu entre le sublime et le trivial que peut
jaillir l’étincelle médiologique.
Typologie
du monument
L’invention
du monument comme bien collectif émerge avec la conscience
d’histoire, qui met le passé à distance du présent et permet
ainsi d’objectiver en documents les créations anciennes.
L’Occident moderne est le lieu où s’est, pour la première fois,
manifesté envers les ruines un intérêt désintéressé,
c’est-à-dire non immédiatement lié à une plus-value
généalogique ou nationaliste ; où les traces des autres (cultures,
époques ou pays) ont été valorisées en quelque sorte pour
elles-mêmes. Quand l’italien Paul III, en 1534, prend les
premières mesures destinées à protéger les monuments antiques, il
le fait en romain, pour défendre sa patrie et son histoire, redorer
le blason, souligner une filiation. Le XVIIIe siècle fut chez nous
le moment de cette transmutation de l’étrangeté en valeur, et
d’un désinvestissement fonctionnel en investissement esthétique.
Significative, à cet égard, la naissance quasi simultanée de
l’histoire de l’art et de l’esthétique comme discipline (avec
Baumgarten et Winckelmann) et du monument historique comme catégorie
à part (avec l’abbé Grégoire et Alexandre Lenoir). Ce qui
s’institutionnalise à l’échelle nationale, à Paris, en 1837,
culmine à l’échelle européenne en 1931, à Athènes, avec la
première conférence internationale consacrée aux monuments
historiques. Et le « complexe de Noé » a pour ainsi dire gagné la
terre entière dans la seconde moitié de ce siècle (1972, Unesco,
Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel, avec cent douze pays signataires dès 1991). Le Sud a
d’autres pratiques de mémoire, non nécessairement liées aux
constructions en dur ni même aux oeuvres de l’homme, mais le fait
est que la planète entière s’est convertie à la religion
patrimoniale de l’Occident, quitte à élargir le champ des
protections jusqu’à un patrimoine oral et immatériel qui ne
figurait pas dans l’acception originaire du mot.
Observons
dès maintenant que le premier, sinon le plus nocif, des abus
monumentaux pourrait bien être celui du mot lui-même. Dans la nuit
de l’absolu, disait Hegel, toutes les vaches sont grises. Dans la
nuit des lois de protection, tout peut devenir monument, de la Vallée
des merveilles à la plaque de cheminée, des gorges du Tarn au
couteau de cuisine. La catégorie juridique «monument historique»
représente une conquête capitale autant qu’un gouffre sémantique.
C’est l’acte administratif du classement qui engendre ce
monument-là, lequel peut être site, objet, édifice, bien meuble ou
immeuble, bref, tout ce « dont la conservation présente au point de
vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public ». Le mot «
historique » ne doit pas non plus égarer puisque la valeur
d’ancienneté n’est plus requise – des édifices des années
1950 et 1960 pouvant être labélisés « historiques » depuis
Malraux.
L’usage
commun également noie à l’ombre d’un mot-carrefour toutes les
variétés d’« édifices remarquables » sans autre forme de
procès. Quand on regarde tel Dictionnaire des monuments de Paris,
au demeurant excellent, ne voit-on pas en couverture un photomontage
en couleur amalgamer un monument par intention et destination comme
la colonne de Juillet, un bâtiment utilitaire comme l’Opéra
Bastille qui ne deviendra sans doute pas un monument de référence,
plus Notre-Dame de Paris et la place des Vosges, qui sont, eux, bel
et bien historiques – liste à laquelle s’ajouteront, dans le
corps du texte, des bâtiments à vocation industrielle ou
commerciale, des décors de restaurants, des jardins et équipements
sportifs, des salles de spectacle et des ateliers d’artistes ?
Beaucoup de discussions ayant le monument pour thème tournent au
dialogue de sourds parce qu’on n’entend pas la même chose sous
le même mot. Si dans les cercles concentriques du patrimoine, on
franchit le grand cercle du « naturel » (paysages, parcs, sites,
jardins, territoire rural), puis le cercle mitoyen des biens
culturels (objets mobiliers et immobiliers par destination,
antiquités et objets d’art), pour en arriver au premier cercle du
patrimoine bâti, on doit encore procéder, semble-t-il, à des
distinctions capitales. Riegl s’y est essayé avec succès
(monuments intentionnels, historiques et anciens, soit «tout ce qui
a subi l’oeuvre du temps»).
Serait-il
permis de juger cette partition un peu datée et pas très claire ?
Si oui, on aimerait proposer une autre grille simplificatrice,
susceptible de rendre nos édifices les plus nobles décidables –
étant bien entendu que les indécidables ne sont pas les moins
intéressants. Car le pouvoir discriminant du Monument majuscule,
synthèse vague entre le singulier, le durable et le
public, reste faible. On nous opposera qu’il ne faut pas
faire du note à note sur une polyphonie, en débitant en tranches le
continuum patrimonial. Ce dernier est un film où le montage donne
sens et couleur à chaque plan, ce qui invalide l’arrêt sur
immeuble comme entité distincte et unité discrète. Soit. Mais
mieux vaut savoir lire une partition avant d’entrer dans
l’orchestre (le solfège n’est pas brouillé avec la symphonie).
Qu’on
nous permette alors de distinguer conceptuellement entre le
monument-trace, le monument-forme et le
monument-message. Ils ne mobilisent pas la même qualité de
respect ni d’affect : le plaisir esthétique du regardeur
n’est pas l’intérêt historique du visiteur,
lequel n’est pas la morale civique du participant.
Avant de voir en quoi ils se ressemblent ou se recoupent, il
n’est pas inutile de confronter l’un à l’autre ces trois
idéal-types.
Dans
ce schéma, l’arc du Carrousel serait un monument-message ; la
pyramide du Louvre, un monument-forme ; la passerelle du pont des
Arts, un monument-trace. Si vous arrivez place de la Bastille, venant
de la rue de Lyon, vous aurez devant vous, au centre, un
monument-message, la colonne de Juillet, à votre droite, un
monument-forme, l’Opéra Bastille, et, à l’angle opposé, la
brasserie Bofinger, un monument-trace (inscrit à l’Inventaire). Il
serait assez dommageable d’intervertir les sentiments : exhaler une
ferveur patriotique devant Bofinger ; tomber en admiration esthétique
devant la colonne de Juillet ; et écraser une larme émue devant
l’Opéra Bastille.
Le
monument-message se rapporte à un événement passé, réel
ou mythique. Il commence à la marbrerie funéraire (cippe,
obélisque, enfeu, chapelle) et culmine dans le monument commémoratif
ou votif. Vulnérable plus que les autres aux intempéries mais
surtout aux vendettas, au vandalisme ou à la destruction planifiée
(Vichy jeta Jaurès dans le Tarn), il est en général surélevé et
grillagé. Son propre n’est pas la valeur artistique (il y a des
«tomboramas» et des monuments aux morts en série) ni sa valeur
d’ancienneté. Il n’a d’usage autre que symbolique : stipuler
une cérémonie, soutenir un rituel, interpeller une postérité. Il
aime les ponts, les passages obligés comme sont places, portes et
carrefours, les champs de bataille et les cimetières. Il s’est
pensé et a été voulu comme tel. C’est une lettre sous enveloppe
dûment adressée par une époque à la suivante. C’est le monument
au sens premier, entendu comme «marque publique destinée à
transmettre à la postérité la mémoire de quelque personne
illustre ou de quelque action célèbre » (Dictionnaire de
l’Académie française, 1814). Le monument aux morts d’une
commune de France n’est pas souvent classé ni inscrit, mais c’est
pourtant ce type de construction qui noue le contrat monumental
type avec les générations futures. Un magasin, une usine, un
cinéma, une locomotive, un avion, qui peuvent recevoir le label «
monument historique », ne sont pas à lire comme des messages
envoyés à un récepteur virtuel ou futur.
Exemples
de monuments-messages
Le
Départ des volontaires de Rude, le Mur des fédérés, la
synagogue de la rue Pavée à Paris, la tombe d’Héloïse et
Abelard au Père-Lachaise, le mémorial de la guerre de 1870 à
Noisseville (Moselle), le tombeau de Rousseau à Ermenonville (île
des Peupliers), les statues de François Mauriac, de Léon Blum, de
Leclerc, de Dreyfus…
Le
monument-forme, c’est l’héritier du château et de
l’église. Ce peut être un palais de justice, une gare, une poste
centrale, bref le « monument historique » traditionnel. Soit un
fait architectural, civil ou religieux, ancien ou contemporain, qui
s’impose par ses qualités intrinsèques, d’ordre esthétique ou
décoratif, indépendamment de ses fonctions utilitaires ou de sa
valeur de témoignage. Peuvent se rattacher à cette catégorie parcs
et jardins, cours et esplanades. C’est, si l’on préfère, le
substantif de «monumental». Le Corbusier : « Nous nommons
monumental ce qui contient des formes pures assemblées suivant une
loi harmonieuse » (Une Maison – un Palais, 1928). Il peut
être hors patrimoine (l’oeuvre d’un architecte vivant n’est
pas, en principe, classable). C’est un édifice silencieux sans
credo ni message, qui se commémore lui-même. C’est le plus
souvent un bâtiment utilitaire, et contrairement au premier, qui n’a
pas d’intérieur, n’appelle pas de cérémonies particulières
sur ses devants. Son titre à l’élection réside dans son
caractère spectaculaire ; il ne renvoie pas à un signifié
extérieur, disons-le autoréférentiel (à l’intérieur d’un
code normatif de formes architecturales).
Il
ne rappelle ni n’appelle. La rupture d’échelle qui le distingue
de l’environnement suffit à le mettre hors contexte. Il
hiérarchise un espace, rompt un continuum, se place en point de
mire. Sa conservation n’étant pas nécessairement d’intérêt
public, sa valeur ou non-valeur patrimoniale ne fait pas critère.
Exemples
de monuments-formes
La
gare de Limoges, le château de La Gaude et son jardin
(Bouches-du-Rhône), la cour d’honneur du Palais-Royal, la chapelle
du Val-de-Grâce, le palais des Congrès à Tours (J. Nouvel), le
siège de France-Télévision (J.-P. Viguier), l’Institut du monde
arabe, la BNF…
Le
monument-trace est un document sans motivation éthique ou
esthétique. Inintentionnel, il n’a pas été fait pour qu’on se
souvienne de lui mais pour être utile, et ne prétend pas au statut
d’oeuvre originale ou esthétique. Contrairement au précédent,
pas de volonté d’art explicite. Ce peut être une rue, une
baraque, une tranchée, d’un intérêt architectural nul. Comme un
éboulis peut constituer un « site » à protéger. Sa valeur est
plus souvent métaphorique ou métonymique, il ne renvoie pas à une
institution mais à un milieu, un savoir-faire ou un style.
Généralement plus modeste ou prosaïque que les précédents, il
est mêlé au quotidien, au terrain, à « la vie ». Avec une forte
valeur d’évocation, d’émotion ou de restitution. Notre tableau
comparatif voudrait systématiser cette grille de lecture.
Exemples
de monuments-traces
La
fosse de mine (salle des pendus), le restaurant Chartier, la piscine
Molitor, le Grand Casino de Vichy, le 13 rue des Amiraux (Paris 18e),
la ligne Maginot, la biscuiterie Pernot, le Fouquet’s, la
fontaine-lavoir de Haute-Saône, la vieille ferme de Haute- Loire, la
maison natale de De Gaulle à Lille…
Un
bâtiment peut donc défier l’Écclésiaste de diverses façons, du
moins demander un sursis à la poussière. Et l’on dira que dans le
monu-forme, la pierre chante ; dans le monu-message, elle prie, ou
déclame ; et dans le monu-trace, elle murmure, ou souffle à
l’oreille. Si la monumentalité était un opéra, nous ferions de
la trace le récitatif, de la forme, l’aria et du message, le
choeur. Évidemment, une même oeuvre sortie des mains humaines peut
accomplir son parcours de vie en jouant sur différents registres. Le
reliquaire médiéval est une trace (les os du saint) métamorphosée
en forme (sertie et sculptée) et que nous traitons, aujourd’hui,
en message. Une croisée d’ogive fait un monument-forme ; un tympan
narratif ou un gisant, un monument-message; et le tout fait un
somptueux témoignage de l’époque gothique. Sans oublier, bien
sûr, qu’un monu-forme, de nos jours, peut servir de support à
messages – panneaux, affichages électroniques, écrans, etc. –,
tel le Centre Georges-Pompidou.
La
tour Eiffel n’est pas un monument classé (mais simplement inscrit
à l’Inventaire supplémentaire). On a pourtant failli la détruire,
dans ses premières années, tant elle eut de moqueurs et d’ennemis.
Dans quelle case la loger ? Elle les a faites toutes, successivement,
et cumule à présent les prestiges des trois. Au départ, sur plan,
ce fut un monument-forme, qui se voulait utilitaire et temporaire
(vingt ans d’exploitation prévus dans le contrat initial avec
Eiffel), prouesse d’ingénieur (le fer) et exploit d’architecture
(les nervures). Elle incarna bientôt un message politique : la
victoire de la Science et de l’Industrie sur la superstition
religieuse symbolisée par le Sacré-Coeur. C’est devenu pour le
monde entier la métonymie visuelle de Paris, et, dans une vision
patrimoniale des choses, la trace la plus parlante de la Belle
Époque, le monument historique par excellence.
Pour
passer du coq à l’âne, la façade reconstituée de Saint-Pierre
d’Échebrune, sur l’aire autoroutière de Lozay, en Charente, est
un monument par la forme, qui n’est ni trace (comme l’original)
ni message. Il ne contient aucune charge identitaire, relationnelle
ou historique. Il sert de prétexte à un arrêt dans une aire «
culturelle », pour distraire la transhumance automobile. Modulons de
même l’actif du substantif. Selon qu’on change de rubrique, le
verbe monumentaliser changera de sens. Monumentaliser au
sens patrimonial, c’est faire classer ou inscrire un objet usuel ou
un édifice fonctionnel.
L’opération
transforme un bien privé et privatif en objet de visite, en lieu
ouvert au public. On se dirige alors vers une mise sous vitrine, par
un geste toujours ambigu (l’esthétisation par entrée au musée
vaut promotion pour le chenet ou le tire-bouchon, mais dégradation
pour le ciboire ou la chaise-dieu).
Monumentaliser
au sens culturel, c’est privilégier, projeter, investir de
sens et d’affectivité un objet ou un lieu quelconque, transformé
en mémorial privé. Le fétichiste monumentalise la chaussure ou le
mouchoir, comme le nourrisson, en en faisant son « objet
transitionnel ». Il devient alors sursignifiant. Monumentaliser
au sens architectural, c’est par exemple transformer une porte
en portail ou en portique ; ou une simple chaise en prototype de
chaise. Sans enlever sa fonction à un édifice ou un objet, on
veillera à la transcender par une mise en représentation de la
chose par elle-même, qui s’autonomise ainsi de sa propre fonction.
Cette mise entre guillemets s’obtient en général par un double
isolement dans l’espace. À la verticale, on exhausse (socle,
piédestal, gradins ou pilotis à la Le Corbusier). À l’horizontal,
on dégage (esplanade, perspective, terre-plein). Le monumental,
c’est une masse mise en valeur par du vide.
La
tragédie du monument
Nés
l’un et l’autre en 1858, l’historien autrichien Riegl et le
sociologue allemand Simmel ne se sont apparemment ni lus ni
rencontrés. C’est dommage. Le premier a écrit Le Culte moderne
des monuments et le second, La Tragédie de la Culture.
Car rien de tel que ce culte-ci pour illustrer cette tragédie-là.
Simmel appelait « tragédie » la nécessité où se trouve un élan
spirituel de se réifier dans une institution pour parvenir à se
transmettre. Simmel pensait sans doute plus aux religions et aux
idéologies, qui ne se prolongeraient pas dans le temps s’ils ne se
donnaient des organisations normatives, dogmatiques et bientôt
fossilisées. «On attendait le Christ, c’est l’église qui est
venue» (Loisy). Cette immanence de la mort à la vie, ou le fait que
le vital ne puisse se perpétuer qu’en s’inversant dans du mort,
n’est-ce pas le destin du monument commémoratif ? On attendait la
mémoire, c’est le mémorial qui est venu… Et comment faire
autrement? Pour mobiliser le souvenir, on immobilise ses traces. Pour
transmettre, il faut conserver ; et conserver, c’est mettre à
part. Pour maintenir une vivante mémoire, force est de l’embaumer.
Le bizarre alors, c’est que, pour conjurer l’oubli, on va en
quelque sorte le provoquer en l’extériorisant et en le
matérialisant dans un espace public par exemple, où il va peu à
peu se fondre dans le paysage et régresser en habitude visuelle
dépourvue de tout pouvoir d’interpellation. Extérioriser un
mémorable expose au risque de ne plus avoir à en intérioriser le
souvenir. L’invisible doit prendre appui sur le visible (disons :
l’idée de patrie sur le monument aux morts), le symbolique sur le
matériel, avec le danger que le matériel en vienne à manger le
symbolique et que la médiation tourne à l’obstacle. Il sort de là
un possible alibi. En déléguant le travail du souvenir à un dépôt
inerte, je permets aux autres – et à moi-même – de s’en
délester. Ce garde-mémoire garde quelque chose, mais on ne sait
plus trop quoi… On peut même faire de cela un stratagème, et il
ne serait pas absurde d’inscrire l’érection d’un monument au
registre des stratégies sociales de l’effacement, comme une
technique de défausse parmi d’autres. Quand un gouvernement veut
enterrer un dossier, il nomme une commission. Quand un collectif veut
enterrer pour de bon un héros ou une guerre, il en fait une statue –
mémorial ou mausolée. Il sauve ainsi l’honneur – et les
meubles. C’est un peu ce que redoutait Quatremère de Quincy devant
l’essor des musées, dans ses Considérations morales sur la
destination des ouvrages de l’art (1815). « Depuis qu’on a
fait des musées pour créer des chefs-d’oeuvre, il ne s’est plus
fait de chefs-d’oeuvre pour remplir les musées » car,
ajoute-t-il, « tous les objets perdent leur effet en perdant leur
motif ». Ces pensées sont impies. Elles conduiraient un esprit
malicieux à voir dans la Direction du patrimoine une sorte
d’administration des paresses collectives, et dans la journée du
même nom, l’équivalent de la journée sans voitures à Paris. Un
jour de bicyclette et de transport en commun pour faire passer 364
jours d’asphyxie au pot d’échappement. Un jour de salut aux
lieux de mémoire pour compenser l’effacement, pardon, l’allégement
des cours d’histoire, Marignan 1515, dans le primaire et le
secondaire. Les acteurs se font voyeurs, et l’essentiel, décoratif.
Il est là aussi, l’abus monumental : dans le déploiement toujours
plus coûteux et sophistiqué du paraître culturel, qui ne laisse
plus le choix qu’entre la désaffection et le détournement. Et le
paraître menace chaque fois que la Culture veut faire l’impasse
sur l’Éducation.
On
n’en conclura pas que les services de conservation constituent un «
élevage de poussière » à la Duchamp, en l’occurrence de ruines
bien entretenues. Mais le monument moins l’enseignement, cela
s’appelle le vestige. On lève la tête devant un monument, on
baisse les yeux sur un vestige. Ou le monument désinvesti, muet,
devenu énigme, parce que plus personne n’est là pour le faire
parler (le mégalithe breton). Disons, à l’inverse, que le
monument comme mémoire vivante peut se voir comme un vestige qui se
met à parler et que l’on peut s’approprier par le lien que nous
rétablissons de loin en loin entre lui et nous. C’est la cérémonie
du souvenir – sonnerie, drapeaux, minute de silence – qui fait
vivre un monument aux morts. Le mémorial d’Ypres redeviendra une
mémoire morte le jour où le clairon cessera de sonner au
crépuscule.
Le
découragement monumental et ses motifs
Le
plus cruel paradoxe du monument est peut-être celui-ci : notre
société en sauvegarde de plus en plus, et en crée de moins en
moins. Elle aurait presque pour slogan : « le monumental, oui ; le
monument, non ». La demande sociale de monumentalité concerne en
priorité le perspect et la perception (le monument-forme), de
préférence au sens et à la remémoration (le monument-message). La
signalétique déplace la symbolique ; le tape-à-l’oeil, le lieu
de rencontre ; la mégalomanie, le cérémonial. Tour, pyramide,
gratte-ciel, colonnade, fronton – les pouvoirs de surplomb (disons
les sièges sociaux d’entreprises, les chaînes de télé et les
hôtels de région), rivalisent à qui mieux mieux pour creuser la
différence en hauteur et largeur. On peut alors se demander si le
monumental, dans la mégalopole, ne va pas tuer le monument, au sens
«message ». C’est chaque métropole qui se monumentalise en bloc.
Bureaux et logements ordinaires se mettent au gabarit de
l’extraordinaire ; le tissu bâti devient si indistinct et
l’épannelage urbain si anarchique, par juxtaposition incohérente
d’échelles disproportionnées, qu’ils ne rendent pas facile
l’exhaussement en majesté d’une métaphore d’exception ou d’un
point d’intensité. L’oeil du promeneur s’affole, faute de
pouvoir se poser ou se fixer, se disperse dans un espace
ostensiblement déhiérarchisé, et finit par déserter.
C’est
le moment où s’inversent les rapports de l’ancien ordonnancement
urbain : la rupture d’échelle qui peut polariser le regard va se
chercher par le bas, le dessous ou même le dedans (le monument
invisible ou l’anti-monument). Et dans le monument ex professo,
à l’ancienne – surdimensionné, axial, central –, l’architecte
contemporain, d’accord en cela avec l’homme de la rue, n’aperçoit
plus qu’un hybride ringard de rhétorique et de propagande,
d’académisme et d’idéologie.
Y
aurait-il un rapport entre la montée en puissance du patrimoine et
la baisse en évidence du monument? Ne pourrait-on dire : less
(monument) is more (patrimoine) ? Certains redoutent
qu’une société qui se gave d’archives perde l’envie de créer.
Alexandrie traduit, commente, conserve – mais c’est Athènes qui
invente. Les Alexandrins furent les premiers experts en matière
patrimoniale, mais la culture grecque s’est tout de même faite
ailleurs. Vaste discussion. En tout cas, la situation réservée par
l’individualisme contemporain à l’acte monumental permet de
radiographier assez bien l’air du temps. Il révèle et met
l’esprit public à nu, dans son plus simple appareillage. On
pourrait, en ce sens, distinguer quatre motifs à l’actuel
découragement monumental, dont l’addition rend pour le moins
problématique la formule de Malraux : « Il est bien de protéger
les monuments, il est encore mieux d’en créer. »
1.
Le monument se cache parce que le pouvoir se cache – le politique,
s’entend (les autres sont moins timides). Il se fait invisible,
comme tendent à le devenir les prisons et les casernes (le droit de
juger se portant mieux – à voir la visibilité des palais de
justice – que le droit de punir et d’enrégimenter). Le droit de
se souvenir, quant à lui, semble très en retard sur le « devoir de
mémoire », tarte à la crème de l’officialité. C’est la règle
historique (dont le facteur Cheval serait l’exception plaisante) :
en amont du bâti, cherchez l’institution. Le sujet institutionnel
capable de financer, de choisir et d’imposer. La famille fait la
demeure, l’Église fait l’église, l’entreprise fait l’usine
; les pouvoirs publics font le monument public, solidaire qu’il est
de l’espace public : agora, forum, place ou esplanade. Quand se
produit un recul, voire une dépression institutionnelle, le plus
ostentatoire des « appareils idéologiques d’État » qu’est le
monument public est le premier à en souffrir.
Le
geste de célébrer a toujours été un acte d’autorité et de
volonté. Le monument-message allait bien à l’État éducateur,
celui de la IIIe République. Statuomane parce que sûr de sa
légitimité, il n’hésitait pas à préempter la mémoire des
générations futures en leur jetant, si on peut dire, du mémorable
plein la vue. L’État séducteur d’aujourd’hui se replie
sur les monuments-formes, visibilités consensuelles, sans dédicaces
(inscriptions explicatives ou bas-reliefs narratifs), où le message
est gommé (on peut savoir mais comment voir que l’arche de La
Défense est officiellement dédiée à la Fraternité depuis 1989
?). L’État ne se reconnaît plus le droit d’inculquer ou même
de figurer des valeurs ou des exemples – faute sans doute de savoir
où il va, ou ce qu’il veut. Voilà qui incline à une architecture
de politesse, ou d’opinion publique. Avouons-le : la
démocratisation n’est pas propice à la décision monumentale, qui
s’accorde mieux au fait du prince qu’au référendum quotidien
(laissant la Suisse de côté). Il naît de là une certaine
frilosité des maîtres d’ouvrage, et une force d’inertie bien
connue. « Aujourd’hui, dit François Barré, on ne pourrait ni
construire ni détruire les halles de Baltard. » Coup de force
impossible. On entérine, on reconduit, on défend. Si nombreuses
sont les parties prenantes à la moindre décision : associations de
quartier, élus locaux, défenseurs du Vieux Montmartre, amis des
marronniers, journalistes, notables, et j’en passe. Jean Nouvel
observe quelque part que « les architectures publiques sont castrées
en France. Ou alors, elles viennent d’en haut, comme des monstres
qu’on parachute». Soyons francs. C’est à nous, les simples
pékins, que ces monstres ne semblent pas aimables, parce qu’en
tout symbole de pouvoir nous voyons d’abord de l’arrogance, et en
tout arbitrage une marque d’arbitraire. La victoire du monumental
sur le monument traduirait alors en termes optiques la prééminence
de la société civile sur l’État ou, si l’on préfère, de la
civilité sur la citoyenneté.
2.
Le monument est solidaire d’une temporalité longue. Ce commutateur
temporel (passé-futur), chargé de « connecter les âges oubliés
et leurs successeurs » a la durée pour principal matériau,
matérialisée en bronze, fonte, plomb ou pierre. L’abréviation
des temps – notamment des délais de construction et des cycles de
rentabilité – ainsi que l’idéal de rapidité – bâtir le plus
vite possible des édifices programmés pour ne pas durer – ne
créent pas, en apparence, l’environnement propice à l’édifice
qui a la perdurance pour raison d’être. «L’impermanence
l’emporte, tout est devenu mobile ». La communication gonfle au
détriment de la transmission. Quand la consommation est instantanée,
et le profit aussi, le gratte-ciel lui-même se fait Kleenex ; la
perdurance, qui n’est pas une valeur de marché, devient saugrenue
ou contre-productive (perdurer trente ans, pour un bâtiment moderne,
c’est bien). Après moi et mes gains, le déluge. Il est assez
significatif que la réparation et l’entretien, inhérents à la
notion même d’édifice, et sur laquelle Alberti faisait déjà
insistance dans son De re aedificatoria (1453), ne sont plus,
ou bien rarement, inclus dans les programmations budgétaires des
projets, grands ou petits. La vidéosphère a des conditions de
fonctionnement, donc des valeurs, techniquement antinomiques à
celles du monument-message, à appropriation lente. Dans sa
pesanteur, sa lourde et locale fixité, l’idée classique du
monument s’est vue prise de vitesse, comme clouée sur place, «
enfoncée » par l’accélération des flux d’information, la
virtualisation des références, la virevolte nomade. Pour surnager
dans ce flux, le monument doit
se faire flux lui-même et devenir événement (Christo). Flash,
info, scandale.
Faire
image et bruitage, monter au créneau, viser l’ubiquité par
retransmission, soutenir la concurrence. C’est que la vidéosphère
compose un espace-temps singulier où la maîtrise accrue de l’espace
se paie d’une perte de maîtrise du temps. Plus s’étendent les
réseaux de transmission, se fluidifient les transports,
s’agrandissent les échelles d’aménagement (qui passent du local
au territorial), plus se raccourcissent les délais d’attention et
d’attente, plus s’abrège l’espérance de vie des objets (qui
deviennent gadgets) et se fragilisent les matériaux (fuite dans le
toit au bout d’un an). L’électron volatilise les mémoires, et
le règne du live promeut naturellement l’animation,
l’exposition, l’émission éphémère, de préférence à la
construction en dur, morne stabilité qui ne fait pas une « actu ».
L’« image forte » du premier centenaire de la Révolution s’est
bâtie en fer, la tour Eiffel. Celle du second, probablement aussi
coûteuse, s’est défaite en pixels, le défilé Goude.
3.
Il y a du religieux dans le monument le plus civil. Au double sens de
relegere, recueillir des traces, et religare, relier
des hommes. La maintenance du lien entre générations soude
l’identité du collectif. L’individu roi et l’économie reine
ont moins besoin de ces deux rappels à l’ordre – l’ordre du
temps et l’ordre du groupe. L’affirmation d’une permanence
comme d’un domaine public en dehors et au-dessus des sphères
privées est sans doute liée à un sentiment d’obligation envers
des êtres majuscules, virtuels et transindividuels. Ils se nommaient
la Nation, l’Humanité, la République, la France, le Prolétariat,
la Race, la Révolution. La disparition de ces présences impérieuses
et invisibles, transcendances séculières, ne favorise ni l’acte
de foi ni la beauté du mort – conjugués dans le classique
monument aux morts de nos villages. Ce genre d’édifices inutiles
et non rentables postule que l’histoire ait un sens. Il replace un
événement révolu, heureux ou malheureux, sous l’horizon d’un
avenir meilleur. Loin d’être passéiste, le monument-message, qui
sublime un antécédent en précédent, ose en appeler au futur avec
un indéniable esprit de sérieux. Il transfigure une mémoire en
projet. Quand la modernité, qui était un présent futuro-centré,
cède la place au postmoderne, qui est un présent ironique et sans
projet, le monument votif devient quasiment une preuve
d’inconscience.
Rien
de moins ironique qu’un monument public, cette conduite forcée des
mémoires. Le plus humble matérialise un « gloire à » (au
condottiere, à notre vieille barbe, à nos enfants morts pour la
patrie, à nos héros, à la France éternelle, « aux martyrs, aux
vaillants, aux forts »). Cet alléluia prête à rire, ou à
ricaner. Prennent le dessus des parodies en creux, les monuments
éphémères ou évolutifs, délibérément banals, ou ludiques, ou
métaphoriques.
4.
Nous vivons l’ère des épluchures, des fragments, des lambeaux.
Des brouillons, empreintes ou ébauches. Voire des résidus et
détritus (encadrez et exposez en galerie tels quels : l’oeuvre
défraiera la chronique). Nous voulons être en prise directe. Face,
ou plutôt dans, du tout proche, du tactile, du frissonnant et de
l’enveloppant. Or le monument-message, qui se contemple de loin et
nous tient à distance (c’est la tristesse du majestueux), est un
quelque chose à déchiffrer, non à palper. « Seules les traces
font rêver », disait Char. Le monument porteur de sens (et de
lettres) n’est pas un indice (la fumée du feu ou l’empreinte du
pas), mais un symbole, soit un discours intransitif exigeant un
décodage, un apprentissage de lecture, une saisie réfléchie.
L’obélisque
symbolise le rayon du soleil, la colonne, le fût de l’arbre,
et la façade d’un édifice doit se regarder, disait Vasari, «
comme la face d’un homme». Peut-être, mais je ne le vois pas si
je ne le sais pas. Or nous, le substitut de la chose nous ennuie,
nous voulons la chose même ou un fragment de cette chose. Une photo
est plus pathétique qu’une peinture, et une relique plus encore
qu’une photo : elle fait sauter le «comme», court-circuite les
codes. Quand je pèlerine à Colombey-les-deux-Églises, ce qui
m’émeut n’est pas la monumentale croix de Lorraine en granit
élevée sur la colline mais le bureau de La Boisserie, le fauteuil,
le sous-main, les objets familiers du Général. Le Struthof : une
baraque telle quelle a plus de charge émotive que n’importe quelle
colonne votive ou artefact commémorant les camps de concentration.
Une humble trace prélevée sur le réel a pour nous plus d’aura
que le plus beau des monuments d’art. Bref, l’hégémonie
mémoriale du monument est battue en brèche par la montée en
puissance de l’ordinaire et de l’immédiat via les nouvelles
techniques d’enregistrement. Barthes n’a pas tort, en un sens, au
détour de La Chambre claire, de dresser l’acte de décès
des vieux signes de pierre : « Les anciennes sociétés
s’arrangeaient pour que le souvenir, substitut de la vie, fût
éternel et qu’au moins la chose qui disait la Mort fût elle-même
immortelle : c’était le Monument. Mais en faisant de la
Photographie, mortelle, le témoin général et comme naturel de “ce
qui a été”, la société moderne a renoncé au Monument ». Il
faudrait préciser : elle a renoncé au monument-message mais au
profit du monument-trace, qui est la photo en dur d’un « ce qui
a été » – comme le montre le fait que l’immense majorité
des monuments classés et surtout inscrits depuis trente ans relève
de la catégorie trace.
Le
monu-message, qui commence à la croix et culmine en statue (équestre
ou en pied) en passant par le buste, le bas-relief et le médaillon,
embrassait le cimetière artistique et la galerie des illustres. Il
avait pour proie préférée « le grand homme », pour finalité la
propagation de la foi et des « vraies valeurs ». Sa gratuité
délibérée exige des donateurs, souscripteurs ou commanditaires,
hors circuit économique. On comprend que l’époque ne lui soit
guère favorable : il a fallu un demi-siècle pour qu’un Churchill
de bronze, en uniforme de la Royal Air Force, s’érige dans la
capitale d’un pays qui ne lui doit pas peu.
 |
Herbert
List, Athènes, 1937, Collection Musée Ludwig Cologne.
|
Vers
une renaissance ?
Nous
assistons en résumé à une mutation, non à une disparition. La
pulsion monumentale a subi un changement de portage : reflux des
signes, gonflement des volumes. D’un côté, la
désindustrialisation incite à l’esthétisation, qui est la
Providence des friches ; et le passage d’un univers usinier à la
société de services s’accompagne d’une promotion muséale des
sites de production désertifiés. L’usine Renault de l’île
Seguin, les docks de Dunkerque, le « Lingotto » ou l’usine Fiat
de Turin, et d’autres, feront demain de fort beaux monuments, qui
seront admirés à la fois comme traces et comme formes, cibles de
visites émues et de photos épurées, quasi plasticiennes. D’un
autre côté, l’allongement de la vie, des loisirs et les fonds de
pension accroissent la demande, en offrant au pèlerinage monumental
un public captif, avide de « vaut le détour » et « vaut le voyage
». Ce sont là de bonnes nouvelles pour les Journées du patrimoine,
ici et ailleurs. Mais les bonnes nouvelles pour les traces et les
formes, anciennes ou nouvelles, en font de mauvaises pour les
messages intentionnels. La croissante vitalité du premier secteur se
monnaye d’un taux de mortalité élevé dans le second. Car les
monuments sans cérémonies sont comme des rois sans divertissements
: ils meurent. Que devient le Mur des fédérés sans les couronnes,
les drapeaux et les manifestants du 1er mai ? Des moellons gris et
classés. Qu’est devenu le mémorial à la Résistance de la Drôme,
qui surplombe le Rhône ? Un vestige funèbre et blanc, sans un chat
pour le ranimer. Enlevez les guérites, les horse guards et la relève
des bonnets à poil devant Buckingham Palace, et vous avez un musée,
tout prêt à la consommation. Il est des lieux sacrés qui vivent
comme un affront le passage du culte à la culture. Il est vrai qu’il
y a, parmi les lieux de mémoire les plus consacrés, des vivants à
éclipse ou des morts en sursis.
Le
Panthéon en fait partie. Il se réveille de loin en loin, à chaque
transfert de cendres ; à chaque retour cependant, la panthéonade
montre un peu moins d’entrain. Le temple de la République, gagné
par la froideur, deviendrat-il bientôt son Musée ?
Soyons
inquiet, mais non chagrin. L’homme sans monument, c’est la
barbarie ; le monument sans hommes, c’est la décadence. Il n’est
pas interdit de rêver pour demain un stade intermédiaire… Un
revivalisme du monument-message n’a rien d’impossible. Car
l’écrasement des longues durées par l’instant n’est sans
doute pas viable, sur le long terme. D’abord, la culture de flux
aussi a son effet jogging, qui est le besoin de stocks bien
repérables, totems voyants de continuité. La frénésie du nouveau
porte à son envers l’appétence antiquaire ; et la dictature du «
tout doit maintenant être immédiat, vécu, proche et sensible »
appelle en contrepoids du codé, de l’intransitif et du stable. Le
marbre remonte par le flux, le centripète par le centrifuge. Ce
n’est pas un hasard si l’ère des innovations techniques les plus
déstabilisantes est aussi l’ère des commémorations maniaques. La
circulation impérative et le transit généralisé suscitent des
vides de centralité, qui font appel d’air. On a observé, par
exemple, que l’image de synthèse la plus vendeuse a commencé par
nous emmener dans l’abbaye de Cluny ressuscitée. En ce sens, rien
n’était plus à contresens du futur, plus rétrograde, que le
futuriste Plan Voisin de Le Corbusier qui, en 1925, projetait de
raser le vieux Paris en ne laissant sur pied que trois ou quatre
bornes témoins.
Ensuite,
le destin du monument ne lui appartient pas en propre. Il est dans
l’aspiration à faire groupe. À conjurer la solitude. À sceller
une appartenance. À resserrer les liens. « Resémantiser »
l’espace urbain ? On ne voit pas comment cela serait possible sans
revitaliser l’espace public et le sens civique. Souvenons-nous que
le premier âge d’or des célébrations en dur, dans notre
civilisation, avant le XIXe, fut la Renaissance. La réapparition de
lieux à la romaine dans des villes médiévales jusqu’alors
labyrinthiques, morcelées en clans et familles, hérissées de tours
de défense privées, obturées de chicanes, dégagea des lieux de
centralité aérée prêts pour le bronze et le marbre honorifiques.
La bourgade médiévale était anarchie et multiplicité pure ; c’est
un peu la situation, curieusement, de nos mégalopoles. Un retour à
une civilité de bon aloi et juste taille – sur le modèle italien,
si l’on veut – serait propice à l’érection monumentale,
inséparable du propos politique, dans ce qu’ils ont, l’un et
l’autre, de plus noble.
Gardons-nous,
pour sûr, d’exalter la valeur ordonnatrice des formes. Le
monument-démiurge ne va pas résoudre les maux de la Cité. Il ne
s’agit pas, pour faire pièce à la montée des impatiences et des
ironies, d’évoquer on ne sait quel retour à l’ordre monumental,
antiquisant ou néo-classique, du type années trente. Ce serait là
faire appel, plus ou moins sournoisement, à des régimes d’autorité,
à des assignations de valeur qui n’ont rien de républicain. Un
régime d’authentique liberté, par bonheur, ne saurait se laisser
enfermer dans la triste alternative qui obligerait à choisir entre
l’oubli pur et simple de l’histoire et le retour névrotique au
passé, entre l’obsession d’ordre et le laisser-aller.
C’est
dire qu’il y a encore, non derrière mais devant nous, d’autres
monuments à inventer.
RÉGIS DEBRAY
Trace, forme ou message ?
Cahiers de Médiologie n°7 | 1999
La confusion des monuments
La confusion des monuments


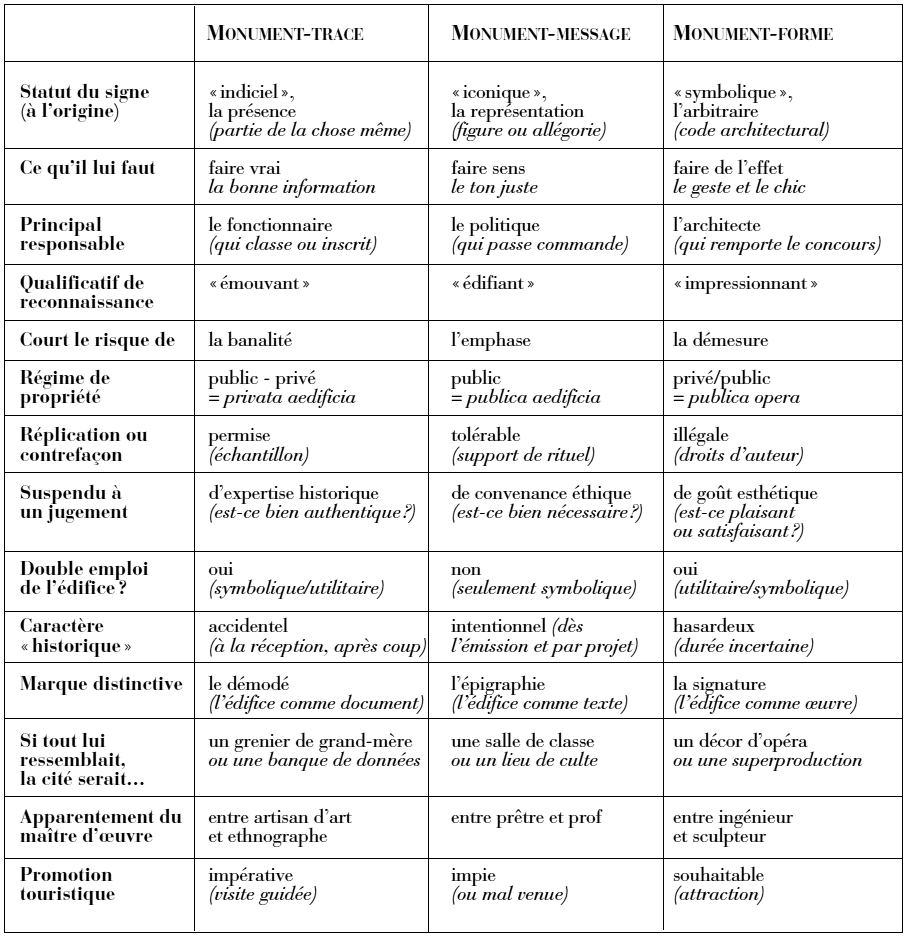
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire