Superstudio
A Journey from A to B
1972
C'est un anniversaire oublié ou passé sous silence car
il
y a 600 ans, en 1418, les premiers « Bohémiens » arrivèrent en
France [1] ;
ils campent vers Aubervilliers en 1427 [2] et ils
attirent les foules parisiennes curieuses de les découvrir : six
siècles nous séparent, mais les chroniques, la vox populi d’alors
s’accordent parfaitement, sont au diapason de celles d’aujourd’hui
: l’évêque les chasse de la capitale, au grand soulagement de la
population. Les préjugés ont la vie longue et dure...
Mais
s’agit-il véritablement d’un unique problème de race ?
L’histoire nous suggère également que c’est le vagabondage en
général qui est perçu comme une déviance sociale inquiétante, et
plus particulièrement l’errance des plus démunis sans profession,
qui concerna, en fait, une minorité Tzigane. Ainsi, pendant des
siècles, la persécution des vagabonds touchait sans distinction
raciale, Français et étrangers, Tziganes ou non, et les marchands
ambulants, les forains, patentés, et ceux dont la profession
exigeait des déplacements fréquents étaient à l’abri des
décrets royaux puis républicains liberticides (cela concerne
également les ouvriers : ainsi, le livret ouvrier instauré par
Napoléon limita la libre circulation des ouvriers sur le territoire
national français jusqu’en 1890). Et afin de mieux se fondre dans
la société, les grandes troupes de Tziganes se fractionnèrent en
familles circulant seules sur les routes de France.
Jacques Callot, Les bohémiens en marche avant-garde | 1621
Cela
étant, ils seront traités et notamment leur population la plus
humble [3], avec d’autres immigrés vivant en France, comme de
parfaits bouc-émissaires dès qu’une crise économique, une guerre
ou d’autres événements déstabilisant la société, une vague
migratoire [4] advenaient. Peta-Manso, alors président de la
Fédération Tzigane de France déclarait en décembre 1981 :
« Désirer rester nous-mêmes, vouloir conserver notre identité et nos valeurs, ne signifie en aucune façon nous mettre en marge. Simplement, c'est souhaiter tenir, au milieu de tous, une place originale et nous sentir acceptés, reconnus et respectés. Depuis des siècles, notre situation a été tout autre : le rejet, la méfiance, les persécutions et les brimades de toutes sortes ont été bien souvent notre seul lot. Et c'est parce que nous en avons souffert qu'il nous est arrivé, parfois, de nous retrancher du reste de la société. »
Les
Tziganes établis en France ont enrichis et adaptés leur propre
culture romani à leur pays d’accueil, volontairement ou de manière
forcée, leur empruntant également les traits qui permettent de
mieux se préserver des adversités ; et vice et versa ; le mode de
vie, la culture tziganes ont largement influencé et nourri, inspiré
la vie culturelle, sociale et politique de la France. Cet apport,
cette influence ne peut pas être considéré comme un « folklore »,
comme une mode - les bohèmes par exemple -, mais doit être compris
dans toute sa complexité et sa diversité. Selon un texte de l’Union
Romani Internationale intitulé Le décalogue du palais Bourbon, des
Tziganes souhaitent un statut officiel qui favoriserait :
« la promotion de notre patrimoine culturel et linguistique en tant que partie intégrante du patrimoine français », et que « la contribution de notre population, partie intégrante de la nation française depuis plusieurs siècles, et active sur les plans culturel, patrimonial, artistique, industriel, économique, sociologique, spirituel, écologique, agricole, celui du développement durable etc., soit dûment reconnue et mentionnée dans les livres scolaires.»
Joseph Koudelka | 1966
Après
l’après seconde guerre mondiale, les avant-gardes architecturales
en Europe, les plus récalcitrantes au fonctionnalisme et mariées
avec des mouvements politico-artistiques contestataires, et en
particulier la bohème Situationniste, ont elles aussi été
irradiées par le monde Tzigane ; un étrange mode de vie
anachronique, passéiste et à la fois anti-conformiste, un peuple
aux accents primitifs épris de liberté et de musique, pouvait tant
bien que mal survivre à la folie et aux carcans capitalistes, et
refuser, pour beaucoup, le travail abrutissant à l’usine.
Anti-travail, anti-conformisme, anti-propriétarisme,
anti-capitalisme même : mythes ou réalités, seront idéalisés par
les architectes anti-fonctionnalistes dont nombre d’entre eux, y
compris dans les célébrités, se réclamaient ouvertement de
l’anarchie.
Cet
attrait - politique - pour les Tziganes participe à plusieurs autres
centres d’intérêt qui surgissent pendant cette période : des
fabuleuses découvertes scientifiques et techniques ayant, notamment,
porté l’homme sur la lune ; l’amorce d’une reconsidération
spectaculaire des sociétés dites primitives par une poignée
d’ethnologues et d’anthropologues - politisés - défendant
l’idée qu’elles présentent un véritable modèle de société
sans Etat parfaitement viable, mettant à mal le syndrome d’un
capitalisme et socialisme d’Etat inéluctables. De même, les
minorités dans le monde occidental s’activent et s’organisent
politiquement : les Black Panthers aux USA, comme les tribus
amérindiennes, les Chicanos protestent ; et l’on redécouvre au
même moment, coïncidence ou non, l’architecture sans architectes,
l’architecture vernaculaire ayant fait l’objet de publications et
d’expositions ; la mobilité nouvelle dispensée par la
démocratisation de l’automobile, pour le plus grand nombre est
considérée comme une véritable révolution ayant permis aux masses
d’échapper à la tyrannie des transports publics, à la
grand’ville, et d’accèder ainsi à de nouvelles formes de
liberté et de lieux jadis réservés au plus aisés véhiculés ;
les plus audacieux, globe-trotters et hippies les emmèneront à
travers l’Asie jusqu’aux Indes, ignorant superbement les
frontières, il est vrai, alors ouvertes. Eux également, dans leurs
voyages empruntèrent aux Tziganes et Gypsies nombre de leurs vertus
; enfin, c’est aussi le temps où la ville dévore ses espaces
agricoles et verdoyant pour enfler démesurément et ce à une
vitesse jamais auparavant atteinte, d’où ce besoin de nature, d’un
Back to Land, et les projets des avant-gardes auront à traiter
d’écologie, tout en s’émancipant des grandes utopies de leurs
aînés ayant déjà balisé la voie de l’écologie urbaine (Ville
verte de Le Corbusier, la cité dispersée de Wright, Désurbanisme
soviétique, etc.), mais ayant totalement échoué, fournissant même
au capitalisme une base, un contre-modèle parfait à réaliser.
Enfin, soulignons que les guerres (d’Indochine [1946 1954],
d’Algérie [1954 1962], du Vietnam [1963 1975], et celles
socialistes de Cuba [1956 1959], etc.) seront autant d’incubateurs
nourrissant l’activisme des jeunes, peu disposés à combattre des
peuples qu’ils estiment.
Ainsi,
les avant-gardes auront à concilier ces disciplines, les avancées
scientifiques, les modèles des sociétés primitives y compris le
néo-primitivisme hippy, et leur mise en pratique politique sur les
plans urbain et architectural en considérant la mobilité et le
nomadisme comme étant des clés pour parvenir à contrer l’ancrage
au sol des massives constructions fonctionnelles et l’immobilisme
aussi bien moral qu’intellectuel des architectes. Mais, comment
concilier l’inconciliable, la statique de l’architecture et la
mobilité, et le nomadisme ? L’utopie, bien sûr, mais aussi, et
c’est nouveau, les contre-utopies seront mises à l’épreuve pour
imaginer et construire une nouvelle société, et pour les
propositions les plus radicales et généreuses, elles promettent non
pas une architecture mobile mais une liberté totale de déplacement
- et de stationnement - de l’Homme ou de tribus nomades sur de
nouveaux territoires ; à l’image du nomadisme tzigane, mais
ultra-technologisé.
L’influence Tzigane
Sabine Weiss
Porte de Vanves, Paris
1952
La
seconde guerre mondiale allait bouleverser le monde nomade, en 1940,
un décret interdit aux « nomades » de circuler sur l’ensemble du
territoire, une assignation à résidence dans la ville où il se
trouve, d’autres (environ 6000) seront internés dans des camps,
synonyme, pour beaucoup, de déportation vers les camps de
concentration nazis. En France, la vie quotidienne dans les camps
révèle des conditions de logement et d’hygiène déplorables :
les Tziganes ne souffrent pas seulement de la faim et du froid, ils y
meurent.
Aussi
incroyable que cela puisse paraître, le racisme d’État persista
bien après la fin des hostilités : le gouvernement provisoire de la
République décida de libérer les camps tziganes bien après la
Paix retrouvée, certes en améliorant leur quotidien, et prolongea
l’interdiction de quitter la commune où ils doivent demeurer,
assignés à résidence (certes, dans le chaos de l’après guerre,
cette mesure sera peu appliquée) ; en 1946 les derniers Tziganes
internés retrouvent leur liberté. Puis, comme si le génocide
n’avait jamais existé (il n'y avait pas de Rroms au procès de
Nuremberg), les mesures liberticides de l’avant-guerre,
c’est-à-dire entravant leurs droits de pouvoir circuler et de
stationner sans contrainte, seront reconduites : jusqu’en 1970, le
« livret ou carnet de circulation » se substituant alors au «
carnet anthropométrique » institué en 1912, sera toujours en
vigueur.
Cependant,
et paradoxalement, en 1949, l’État prend la mesure du problème «
tzigane » en créant une commission interministérielle d'étude des
questions intéressant les populations d'origine nomade, par le
ministre de la Santé publique et de la population et par le ministre
de l'Intérieur. Elle s’éteindra après 1968. Après son premier
rapport, les ministres concernés définissaient la nouvelle
politique :
« A la politique de répression et d'interdiction jusqu'ici admise à l'égard des populations d'origine nomade : tsigane, romanichelle, gitane, etc., doit être substituée une politique plus compréhensive tendant à la fois à permettre leur développement humain normal et à faire disparaître pour les populations au milieu desquelles elles vivent les inconvénients parfois graves inhérents à leur présence ».
Parmi
les recommandations souhaitées, citons :
« Ces mesures seront très diverses. Elles varieront essentiellement suivant les régions et suivant les habitudes des populations. Il faudra néanmoins partout :
1) assurer aux nomades, par les moyens les plus variés, des lieux de stationnement sains pour l'été et l'hiver, les stationnements d'hiver surtout devant être équipés au point de vue sanitaire ;
2) leur fournir l'aide d'assistantes sociales spécialisées relevant d'organismes publics ou privés ;
3) leur procurer un travail régulier leur permettant de vivre normalement ;
4) leur donner une instruction générale minima (tous ne savent pas lire) et une certaine formation professionnelle.»
Lucien Clergue
Draga en robe à pois, Les Saintes-Maries-de-la-Mer
1957
Jean Dieuzaide
La Gitane du Sacro Monte Grenade
1953
Robert Doisneau
Maline, gitane de Montreuil
1950
Préfets
et gendarmes, policiers et garde champêtres ne semblent avoir été
inspirés par les recommandations de leurs ministres, qui
continuèrent sans relâche à persécuter administrativement les
nomades - tziganes ou non -, sous la pression des maires, peu
sensibles, ou plutôt peu sensibilisés par les plus hautes
autorités, à leurs conditions de vie, suivant en cela la vox populi
de leurs électeurs. Mais l’on observe au sortir de cette guerre,
alors que les restrictions sont importantes, une forme de solidarité
envers ceux et celles de toutes origines ayant souffert des malheurs
de la guerre d’une manière ou d’une autre, un élan de
compassion de la bourgeoisie (des bienfaiteurs, des grands
fonctionnaires, etc.) et de la classe moyenne (en particulier les
assistant-e-s sociales, les étudiants, etc.), compassion appuyée et
peut-être emmenée par l’Église, dont les représentants, les
premiers, iront au secours des Tziganes, tout en profitant de leur
détresse pour mieux les capter, les convertir ; et pour y parvenir
catholiques et protestants - et plus particulièrement du
pentecôtisme - se livrèrent à une véritable bataille. Ainsi
peut-on lire, dans la revue protestante Vie & Lumières n° 6
datée de 1962 :
« Il est donc surprenant que les autorités catholiques qui ont les postes-clés du point de vue social aient fait si peu pour l’amélioration du sort des gitans en tant d’années écoulées. […] Il est évident que devant l’ampleur du mouvement de réveil évangélique [protestant] parmi les tziganes, il y a un effort redoublé de la part du catholicisme pour conserver dans la religion romaine les Tziganes, soit en exploitant la superstition par la multiplication de pèlerinage aux Saints et aux Saintes, tel l’exemple de l’institution du pèlerinage Tzigane à Lourdes, soit en accomplissant des efforts sur le plan social pour attirer vers les prêtres la sympathie gitane, ou encore pour avoir une meilleure emprise sur les gitans fréquentant les institutions ou groupés en des ‘camps’ ou ‘bidonvilles’. »
L’humanisme
tsiganophile se développe. C’est en 1949 qu’est créée
l’Association des Etudes Tsiganes, qui édita à partir de 1955 un
bulletin intitulé « Etudes Tsiganes », association – active
encore aujourd’hui- qui contribua grandement à :
« faire mieux connaître, dans le grand public, les questions tsiganes, éveiller l'intérêt et la curiosité autour d'elles, dissiper les préjugés injustes, nés généralement de l'ignorance, et finalement créer un courant de sympathie qui permette aux Tsiganes de prendre leur place, au grand jour et dignement, dans la communauté humaine. » (Etudes Tsiganes), avril 1955.
Lucien Clergue
Jeune gitan portant la statue de sainte Sara
Les Saintes Maries de la mer
1959
Naissent
ou se développent les associations de Tziganes eux-mêmes, laissant
dire au spécialiste de la chose, Jean-Pierre Liégeois que c’est
la naissance d'un « pouvoir tzigane » en lien avec les «Tsiganologues » qui forment un champ spécialisé dans leurs
disciplines respectives. Sociologie, ethnologie, histoire des
Tsiganes connaissent leur essor au sein de la tsiganologie. Se
multiplient les premières études sociologiques, historiques,
anthropologiques, et autres travaux et écrits relatifs au monde
tzigane [4]. A partir des années 60 sous l'impulsion d'associations
œuvrant en faveur des Gens du voyage, se développent des aides et
des formes de solidarités entre Gadjo et communautés Tziganes,
perçues comme formant une minorité ethnique qu’il convient de
dé-stigmatiser, à l’image des USA connaissant des mouvements de
solidarité avec les Noirs, les « Chicanos » et les peuplades
indiennes.
Depuis
longtemps, les artistes d’origine Tzigane portent dans le monde
leur culture, avec notamment la reconnaissance internationale du
guitariste manouche Django Reinhardt (1910 1953), suivi du guitariste
Manitas de Plata (1921 2014), etc. ; le guitariste Yul Brynner (1920
1985), dont la mère est gitane, se produira en France, et devenu
célèbre acteur, il consacra son temps à plaider pour la cause
tzigane. Mais c’est aussi la reconnaissance d’autres talents, en
exemple, des cirques de la riche famille tzigane Bouglione (dont le
cirque d’hiver à Paris acquis en 1934), et ceux plus modestes
sillonnant le pays.
Marcelle Vallet
Cirque Kostich
1960
Sans
doute, assiste-t-on, en ce début des années 1960 à une nouvelle
mode gitane, voire une gitanophilie qui atteint toutes les
disciplines de l’art. Rares sont les photographes célèbres, ou en
voie de l’être, de cette époque n’ayant pas pris dans leurs
objectifs une scène de la vie quotidienne ou une Gitane. Les films
s’enchaînent également [5]. En 1961, dans la bande dessinée Les
Bijoux de la Castafiore, Hergé met en scène une troupe de Tziganes
obligée par la police de s’installer « comme ça au milieu
d’immondices » selon Haddock, et victimes des préjugés auxquels
ne cèdent pas Tintin et le capitaine Haddock les invitent à venir
camper dans leur parc du château de Moulinsart, au grand regret de
son domestique, Nestor ("Ces bohémiens, c'est tout vauriens,
chapardeurs et compagnie !"), du chef des gendarmes ("Moi,
je vous aurai mis en garde. Il ne faudra vous en prendre qu'à
vous-même s'ils vous amènent des ennuis") et même d'un jeune
Rom ("Je les déteste, ces gadjé ! Ils font semblant de nous
aider, et dans le fond de leur coeur, ils nous méprisent"). En
1969, Astérix et Obélix rencontrent une troupe de Tziganes
accueillante et dansante, dans Asterix en Hispanie.
L’écrivain
Jean-Paul Clébert, fils de la bourgeoisie, préféra après la
guerre, une vie d’errance à Paris, en compagnie de chiffonniers,
de Gitans, d’amateurs de vin rouge et de prostituées, les
«derniers arpenteurs et flânocheurs du trottoir», vie de bohème
rapportée dans un livre (mal) intitulé Paris insolite (1952), qui
connût un véritable succès et commercial et critique. Peut-être
ses déambulations dans un Paris défoncé par la misère, cet «
immense caravansérail des désespoirs et des miracles quotidiens »
ont-elles précédées ou initiées les propres dérives urbaines des
Lettristes. En 1961, il publie Les Tziganes ; suivi d’un autre
ouvrage intitulé Tziganes et Gitans édité en 1974 (réédité en
2011) illustré par les photographies de Hans Silvester.
Jan Joors
Espagne
1971
Un
autre ouvrage, plus subtil, paraît en 1967, de l’artiste belge Yan
Yoors, intitulé Tsiganes. Sur la route avec les Rom Lovara. Un récit
autobiographique entre récit d’aventures, vie quotidienne, et
anthropologie de la culture tzigane. Le jeune Yan Yoors, fils de
bonne famille d’artistes, prend en 1934 la route des grands chemins
avec une troupe de tziganes, et pendant plusieurs années alternera
les voyages et de brefs séjours en hiver au sein de la maisonnée
familiale, à la périphérie d'Anvers. Après plusieurs voyages et
mois passés avec la troupe, il est intégré et adopté par la
communauté. L'expérience de Yoors était unique en ce sens que les
Gajo, ou les étrangers, étaient et sont très rarement assimilés
dans une communauté. A ce point intégré, alors qu’il étudie la
sculpture à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers en 1939, que
le père de sa famille adoptive décide de le marier à une jeune
tzigane. Profond témoignage d’amitié que refusera Yan Yoors,
estimant que ces liens sacrés rendaient difficile le retour probable
à sa vie de Gajo. Mais l’histoire ne se termine pas ici, car
résistant durant la guerre, Yoors, comme Jean-Paul Clébert en
France, est chargé de coordonner les efforts avec les groupes de
tziganes, prédisposés à la clandestinité, et à fournir de
discrets et redoutables officiers de renseignement (il publiera en
1992, La croisée des chemins : la guerre secrète des Tsiganes :
1940-1944). Par la suite, il s’engagera dans un travail de
photographes auprès de nombreuses communautés tziganes du monde
entier. En 1967, ainsi, Yoors - et d’autres d’ailleurs -, pose un
regard autre sur le monde tzigane, et dévoile la réalité d’une
culture cachée :
« Les Tsiganes ont préservé leur unité culturelle en plaçant entre eux et les autres peuples une série d’écrans qui les font souvent apparaître le contraire de ce qu’ils sont. »
L’épais
mystère qui les enveloppe est volontaire, pour se dissimuler et
esquiver de possibles persécutions, y compris après l’holocauste
:
«
Ils n’attendent rien d’un monde auquel ils n’appartiennent pas
et fuient sans cesse une Nuit des longs couteaux qui revient
toujours. »
Puis
:
« L’État – qui a tendance à confondre transhumance et vagabondage – ne manque jamais de déceler dans leurs agissements l’expression d’une dangereuse “pulsion libertaire” et délègue systématiquement ses gendarmes en guise d’ambassade. »
Jan Joors
Italie
Jan Joors
Italie
Jan Joors
Yougoslavie
1961
Jan Joors
Saintes-Maries France
1971
CULTURE RROM et AVANT-GARDE
Le Corbusier
L'architecture est toujours l'ultime réalisation d'une évolution mentale et artistique ; elle est la matérialisation d'un stade économique. L'architecture est le dernier point de réalisation de toute tentative artistique parce que créer une architecture signifie construire une ambiance et fixer un mode de vie. (Asger Jorn, « Une architecture de la vie »).
En
1936, le jeune peintre danois Asger Jorn (né Asger Oluf Jorgensen)
se rend à Paris pour étudier au sein de l’Atelier de l'Art
Contemporain dirigé par le célèbre peintre Fernand Léger,
rejoignant la grande communauté d’artistes et d’architectes
scandinaves établis dans la capitale. Aux écoles d'art
traditionnelles, Jorn préfère être l'apprenti du maître avec qui
il partage des affinités politiques communistes ainsi qu'une vive
attirance pour l'art dit populaire, sur son rôle social éducatif.
En 1937, Fernand Léger élabore, avec la collaboration de Jorn, une
peinture murale pour le Palais de la Découverte de Paris. Le
Corbusier les invitent à travailler sur un projet de fresque pour le
Pavillon des Temps Nouveaux de l'Exposition Universelle de Paris,
sous la direction de Charlotte Perriand (proche alors du parti
communiste qui en cours démissionnera de l'atelier de Le Corbusier).
Plusieurs artistes de générations différentes, tels qu'Henri
Laurens et Sébastian Roberto Matta Echauren, sont également conviés
à cette grande collaboration. Cet événement s'ouvre dans
l'enthousiasme et la confusion du Front Populaire, et le pacifisme
est de mise ; si dans le pavillon de Le Corbusier, une fresque
appelle à « Des canons, des munitions, non merci, des logis svp »,
dans le pavillon espagnol, le tableau Guernica de Picasso maudit la
guerre et les nazis.
Le
Pavillon des Temps Nouveaux se présentait sous la forme d'une
immense tente, ainsi décrite par Le Corbusier :
« Créer, organiser et construire un pavillon qui démontre par 1600 m² de documents (à fabriquer de toutes pièces) les possibilités de l'urbanisme moderne : "Essai de musée d'éducation populaire". Ce pavillon considérable (15.000 m²) sera en toile, simplement, murs et toiture. Une toiture de 1200 m² cousue d'une pièce et déroulée en une fois.C'est une construction téméraire, souple, en câbles et fins pylônes d’acier.» (Extrait de Le Corbusier, Oeuvre complète, volume 3).
Ce
pavillon de toiles tendues aux couleurs vives était destiné à être
nomade, démonté et transporté dans les différentes villes de
France, constituant une exposition ambulante d'éducation populaire,
intelligible à tous qui présentait les nouvelles possibilités de
l'architecture et de l'urbanisme au moyen de photo-montages, de
maquettes et de dioramas à grande échelle :
« éclairer et éduquer la population, lui faire comprendre les causes véritables de tout son mal (…) ».
Un
choix architectural qui a valu d'âpres critiques de ses confrères
et du jury de l’exposition, considérant que Le Corbusier n'avait
pas conçu un « véritable » bâtiment digne de la modernité. Au
contraire, le jeune Jorn admire l'aspect nomade et « primitif » de
cette non-architecture. Il insiste sur l'importance de la couleur et
des fresques qui, selon lui, créait une véritable synesthésie
sensorielle, une fusion empathique entre le spectateur et son
environnement ; allant jusqu'à dire de cette « oeuvre d'art totale
», cette « tente la plus grande du monde » :
« cette architecture indigne est pourtant la seule architecture authentique de nos jours ».
« Le Pavillon des Temps Nouveaux, la misère des crédits : un temple en bâche ! On pourrait tenter de lui donner la splendeur par la couleur : le pourpre du mur de fond exaltée par l'or du plafond, l'espace crée par la paroi verte et la paroi latérale. Le sol, d'un humble gravier, faisait belle plage d'ocre jaune. Le choix de ces couleurs violentes, puissantes, grossières même, représentait une certaine témérité. Résultat : un coup de massue sur le visiteur, un saisissement. (...) Dans cet orchestre, dont les cuivres, les cymbales, les timbales, les tambours menaient grand jeu, intervint la gamme des autres instruments (violons, bois et harpes) : la modulation intense des grandes peintures murales, la plastique polychrome de Laurens, le martèlement des panneaux d'écritures sur fonds de couleurs diverses, les tapis marocains des plans de villes des CIAM, les traits incisifs des épures techniques de l'urbanisme, les camaïeux somptueux des photos : un plein orchestre. » (« Ansigt til ansigt » [Face à Face]. A5. Meningsblad for unge arkitekter, janvier-février 1944).
Asger Jorn
Mais
Asger Jorn malgré son admiration pour cette réalisation, dont il
témoigne à son retour en Scandinavie dans plusieurs revues d’art
et d’architecture, s’éloignera progressivement du «
fonctionnalisme ». Il ne partagera ni les visions modernistes des
édifices de Le Corbusier, qui impliquent pour ses usagers et
habitants un mode de vie contraignant, ni même le « rôle »
assigné à la peinture, ou l’asservissement de l’art par
l’architecture :
« Les architectes se sont mépris dans leur analyse des besoins des êtres humains sur la position et la signification de l’art. […] L’art est une forme de vie […]. L’architecture est le cadre sur lequel on bâtit nos vies, mais les arts sont le cadre vivant autour de la vie elle-même ».
Asger Jorn & Pierre Wemaëre
Amitié
1938
Jorn
lors de son séjour parisien sera également en contact avec les
surréalistes grâce à son proche ami peintre Roberto Matta, qui a
participé à l’aventure du Pavillon des Temps Nouveaux, et, comme
Jorn, s’intéresse aux questions artistico-architecturales, qui se
manifeste dans sa production picturale et dans ses quelques écrits
poético-théoriques. Matta publie son premier texte surréaliste en
1938 dans la revue Minotaure intitulé « Mathématique sensible -
architecture du temps », rédigé à la demande d'André Breton, qui
propose une critique de l'austérité rationaliste de Le Corbusier et
des architectes modernistes, une approche innovatrice pour cette
revue. À l'opposé de la vision « idéaliste » de la nature et du
corps en tant que modèles pour des calculs géométriques, Matta
oppose plus qu’une architecture, l’être humain, les variations
multiples de la sensorialité et de l'émotivité humaine ; sans pour
autant refuser les prodigieuses possibilités offertes par la
technique et la science modernes afin de les mettre au service d'une
architecture « sensitive » répondant aux désirs pulsionnels de
l'homme.
Les
recherches menées par Roberto Matta constituent sans doute un apport
suffisamment novateur pour qu’aussitôt André Breton, alerté par
Dalí, associe le jeune Chilien à l’« Exposition internationale
du surréalisme » de la galerie des Beaux-Arts. « Il s’agit »,
propose Matta,
« de découvrir la manière de passer entre les rages qui se déplacent dans de tendres parallèles, des angles mous et épais ou sous des ondulations velues au travers desquelles se retiennent bien des frayeurs […]. Il nous faut des murs comme des draps mouillés qui se déforment et épousent nos peurs psychologiques ».
Jorn
aura été sans doute sensible à l'Exposition Internationale du
Surréalisme tenue à la Galerie Beaux-Arts en 1938 ; c’est en
cette même année que paraît le manifeste « Pour un art
révolutionnaire indépendant » signé par André Breton et Diego
Rivera et peut-être coécrit avec Léon Trotsky. Selon Jorn, les
surréalistes donnaient des perspectives bien différentes :
« Où les architectes disent soleil, ils disent obscurité, où ils disent place, on répond labyrinthe, impraticable, caverne. Si on dit plan, ils disent hasard. Si on parle de rentabilité, ils exigent l'inutile. (...) Nous voulons simplement souligner que c'est un domaine intéressant pour l'avenir quel qu'il soit. » Jorn, « Face à Face » (1944), dans Discours aux pingouins et autres écrits.
Au
tracé régulateur, à la froide géométrie égayés par quelques
couleurs brutales, à l’ordre donc, Jorn oppose la dissymétrie et
le chaos, dans les formes, les matières et les couleurs, comme
présentés au sein du Pavillon :
« Je trouve qu'une maison ne doit pas être une machine à habiter, mais une machine à choquer, à impressionner, une machine d'expression humaine et universelle. »
En
1948, Asger Jorn met en pratique ses idées contre-fonctionnalistes
pour une première fois lors de sa participation à la brève
aventure Cobra (1948 1951). Dès l'origine, les membres de ce groupe
informel né après la Seconde Guerre Mondiale cherchent à renouer,
en réponse au réalisme-socialiste et au néo-constructivisme, avec
les sources vives de l'imagination et de la créativité, et ce de
manière transdisciplinaire. Ce projet s'accompagne aussi du désir
d'inventer une nouvelle façon d'habiter poétiquement le monde ; et
les artistes Cobra se passionnent pour l'art et l'architecture
populaires, voir régionalistes, en vertu de sa « valeur
psychologique, sensible, mythique (qui) fut soigneusement ignorée »
selon André Tamm. (« L'art populaire allemand dans ses rapports à
l'art expérimental » Cobra, n° 6, avr. 1950).
Dans
le premier numéro de la revue Cobra paru en décembre 1948,
l'architecte Michel Colle publie « Vers une architecture symbolique
» dans lequel il offre une critique acerbe des « machines à
habiter » de Le Corbusier. Face à « l'architecture de cauchemars »
des fonctionnalistes, « aussi appauvrissante au point de vue
psychique et intellectuel que le sont au point de vue physique et
psychologique les contraintes matérielles supportées aujourd'hui »,
Colle propose d'inventer une « architecture de rêve ». Il propose
une architecture fantaisiste, qui serait la synthèse de tous les
arts afin de s'émanciper du joug fonctionnaliste de deux façons :
en créant des surfaces polychromes et en jouant avec les
potentialités stylistiques et expressives du béton armé.
L’aventure
CoBrA se termine en 1951, époque où Asger Jorn pratique au le «
nomadisme chronique » selon Laurent Gervereau (« Jorn, iconologue,
iconoclaste » dans La Planète Jorn, catalogue d'exposition, 2002).
Il voyage en Afrique du Nord et en Europe ; puis s'installe en 1954
à Albisola, un village sur la côte de la Ligurie au nord de
l'Italie, haut lieu de la céramique, qu’il pratique dans une verve
artistico-artisanale.
Il
est le co-fondateur en 1953 du Mouvement International du Bauhaus
Imaginiste (MIBI) ; là encore, et comme l’avait été le premier
et défunt Bauhaus de la République de Weimar, les artistes «
libres » s’invitent à des incursions dans divers domaines
artistiques, peinture, sculpture, céramique, architecture, etc. Il
s'agit de réconcilier l'art, la science et la technique comme
activités symboliques, un projet qu'il approfondira avec ses essais.
Grâce à son aura et à son réseau conséquent de relations et
d’amitiés, un grand nombre d’artistes, plasticiens, écrivains,
etc., de l’Europe entière rejoindra – de manière informelle -
le Mouvement, dont Roberto Matta, Pierre Alechinsky, le peintre
italien Enrico Baj, l’architecte designer italien Ettore Sottsass
Jr., Karel Appel, Corneille, Sergio Dangelo, Lucio Fontana, Emilio
Scanavino, Edouard Jaguer, Roland Giguère et Theodor Koenig, etc.
L’on
décide d'organiser une série d'actions collectives autonomes qui
débute avec l’Incontro Internazionale délia Ceramica («
Rencontres Internationales de la Céramique ») d'Albisola en 1954,
une exposition publique en plein air qui se veut un « champ
d'expérience » qui permettra de tisser des liens avec la population
et les artisans locaux et ainsi de propager la nouvelle esthétique
contre-fonctionnaliste. Exposition qui sera présentée à la
prestigieuse dixième Triennale de Milano qui se tient durant
l'automne 1954 ; sans grand succès. L’occasion pour Jorn de
l’écriture d’un pamphlet contre le fonctionnalisme (bien
représenté à Turin):
« L'aspect esthétique d'une chose, c'est son extérieur, sa communication directe ou son effet immédiat sur nos sens, sans compter avec son utilité ou sa valeur structurelle. C'est son don d'attirer notre attention, d'éveiller notre curiosité et notre intelligence, de nous choquer et de nous surprendre. » (« Contre le Fonctionnalisme » (30 oct. 1954) dans Pour la forme).
Ce
projet se prolonge avec le « Congrès des Artistes Libres d'Alba »
en 1956 et culmine avec la conférence de Coscio d'Aroscia en 1957
qui voit la fusion du M.I.B.I. à l’Internationale Lettriste et au
Comité Psychogêographique de Londres afin de former
l’Internationale Situationniste.
La bohème parisienne
Ed Van der Elsken
Paris
Love on the Left Bank
1954
A
Paris, pendant ce temps, la bohème intellectuelle s’agite ; les
membres de l’Internationale Lettriste pratiquent en simultané les
premières dérives s’intéressant à la ville, à peine touchée
encore par les grandes opérations de rénovation urbaine, et la
beuverie (selon Debord, « Chacun buvait quotidiennement plus de
verres qu’un syndicat ne dit de mensonges pendant toute la durée
d’une grève sauvage», In girum), décrite dans le livre magistral
de la lettriste Michèle Bernstein, Tous les chevaux du roi (1960).
Une nouvelle bohème intellectuelle et marginale refusant le travail
– Ne travaillez jamais est tagué sur un mur en 1953 par Guy Debord
- « à la recherche de nouveaux rapports humains » selon Bernstein.
Plus
que d’architecture, ils s’occupent d’urbanisme ; l’éphémère
lettriste Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov), peintre, écrivain et
psychogéographe, les y engage avec son Formulaire pour un urbanisme
nouveau, texte écrit en 1952-1953 et dont une version, établie par
Guy Debord, paraît en 1958 dans le premier numéro de la revue
Internationale Situationniste avec cette présentation :
« L’Internationale lettriste avait adopté en octobre 1953 ce rapport de Gilles Ivain sur l’urbanisme, qui constitua un élément décisif de la nouvelle orientation prise alors par l’avant-garde expérimentale. Le présent texte a été établi à partir de deux états successifs du manuscrit, comportant de légères différences de formulation, conservés dans les archives de l’I.L., puis devenus les pièces numéro 103 et numéro 108 des Archives Situationnistes. »
Ed Van der Elsken
Paris
Love on the Left Bank
1954
Le Congrès des Artistes Libres d'Alba
Dans
les salles souterraines d'un couvent du XVIIe siècle à Alba en
Italie du nord, y travaillait Pinot Gallizio un peintre autodidacte,
venu à la peinture à plus de cinquante ans, un ancien pharmacien,
chimiste à ses heures et conseiller municipal de la gauche. En août
1955, il rencontra à Albisola, haut lieu de la céramique en Italie
du nord, Asger Jorn, propriétaire d’une maison-jardin ainsi
décrite par Guy Debord :
« Ce qui est peint et ce qui est sculpté, les escaliers jamais égaux entre les dénivellations du sol, les arbres, les éléments rajoutés, une citerne, de la vigne, les plus diverses sortes de débris toujours bienvenus, tous jetés là dans un parfait désordre, composent un des paysages les plus compliqués que l’on puisse parcourir dans une fraction d’hectare et, finalement, l’un des mieux unifiés. Tout y trouve sa place sans peine. » (« De l'architecture sauvage », 1972, dans Jorn, Le jardin d'Albisola, Edizioni d'Arte Fratelli Pozzo, Torino, 1974. Ce texte a été écrit en septembre 1972 après le séjour en mai d’Alice et Guy Debord chez Nanna et Asger Jorn à Albisola).
Pinot
Gallizio, nouveau membre du MIBI, proposa ainsi à Asger Jorn
d’utiliser son atelier comme lieu pour un congrès prévu en 1956.
Y participent notamment les lettristes Mohamed Dahou, Gil J. Wolman
et Michèle Bernstein. Chaque membre ou invité représentant un
mouvement étaient tenus d’aborder un thème particulier sur les
relations souhaitables entre art, architecture et société. Jorn
présenta à l’auditoire quelques considérations à propos du
terme « avant-garde », qui à cette époque était encore attribué
aux fonctionnalistes, qui pour célébrer l’inauguration de
l’immeuble d’habitations de Le Corbusier, à Marseille (la Cité
Radieuse), avaient organisé un « Festival de l’avant-garde ».
Jorn, au contraire, le revendiquait comme « le seul terme pouvant
s’appliquer à notre mouvement », car,
« Il y a deux conditions pour qu’un mouvement soit appelé mouvement d’avant-garde. D’abord, il faut qu’il se trouve isolé et sans appui des forces établies, abandonné à une lutte apparemment impossible et inutile. […] Il faut ensuite que la lutte de ce groupe soit d’une importance essentielle pour les forces au nom desquelles il lutte (dans notre cas, la société humaine et l’évolution artistique) et que la position gagnée soit plus tard confirmée par une évolution générale.»
Le
discours d'Ettore Sottsass jr. abordait « l'architecture chromatique
», une alternative à l'architecture rationaliste, dont les édifices
ne sont rien d'autres que des squelettes silencieux, dont la pureté
cache la pauvreté et la limite d'une société entière. Guy Debord,
retenu à Paris par les autorités militaires, ne put s’y rendre,
mais en tant que délégué, le cinéaste, plasticien et écrivain
Gil Joseph Wolman lira sa déclaration au nom de l’Internationale
lettriste, dont voici des extraits :
« Un urbanisme unitaire — la synthèse, s’annexant arts et techniques, que nous réclamons — devra être édifié en fonction de certaines valeurs nouvelles de la vie, qu’il s’agit dès à présent de distinguer et de répandre. [...]L’urbanisme expérimental que nous devons entreprendre doit déjà se situer dans cette direction. Il faut, écrit Asger Jorn, à la fin de son essai Imagine e forma, ‘découvrir de nouvelles jungles chaotiques par des expériences inutiles ou insensées’. Et Marcel Mariën, dans le numéro 8 des Lèvres nues, annonce : ‘Au béton précontraint, l’on verra se substituer la rue tortueuse, le chemin creux, l’impasse. Le terrain vague fera l’objet d’études toutes particulières, et l’on instituera par exemple des concours destinés à la désignation des meilleurs projets’. […] Nous ne devons pas nous opposer à ce que cet urbanisme soit qualifié de baroque, au moins dans ses premiers essais, puisqu’il sera entièrement tourné vers la vie, et opposé au classicisme fonctionnaliste. Mais il ne saurait demeurer baroque. Il dominera la vieille contradiction baroque-classique. L’urbanisme unitaire doit devenir, par tous les moyens, le cadre et l’occasion de jeux passionnants. »
Le
cadre théorique et d’actions pour les futurs situationnistes est
ainsi donné : ce sera la ville. Comme l’affirmera Guy Debord :
« On sait que les situationnistes, pour commencer, voulaient au moins construire des villes, l’environnement qui conviendrait au déploiement illimité de passions nouvelles. Mais naturellement ce n’était pas facile ; de sorte que nous nous sommes trouvés obligés de faire beaucoup plus. Et tout au long de ce chemin plusieurs projets partiels ont dû être abandonnés, un bon nombre de nos excellentes capacités n’ont pas été employées, comme c’est le cas, combien plus absolument et plus tristement, pour des centaines de millions de nos contemporains. » (« De l'architecture sauvage », 1972, dans Jorn, Le jardin d'Albisola).
Ils
firent ainsi ce compte rendu :
« LA PLATE-FORME D’ALBA
[…] La résolution finale du Congrès traduisit un accord profond, sous forme d’une déclaration en six points proclamant la « nécessité d’une construction intégrale du cadre de la vie par un urbanisme unitaire qui doit utiliser l’ensemble des arts et des techniques modernes » ; le « caractère périmé d’avance de toute rénovation apportée à un art dans ses limites traditionnelles » ; la « reconnaissance d’une interdépendance essentielle entre l’urbanisme unitaire et un style de vie à venir... » qu’il faut situer « dans la perspective d’une liberté réelle plus grande et d’une plus grande domination de la nature » ; enfin l’« unité d’action entre les signataires sur ce programme... » (le sixième point énumérant en outre les diverses modalités d’un soutien réciproque). » (POTLATCH. Bulletin d’information de l’Internationale lettriste. N° 27 – 2 novembre 1956)
Parmi
les artistes invités au congrès, se distingue le peintre
néerlandais Constant Anton Nieuwenhuys, co-fondateur du mouvement
CoBrA, encore brouillé avec son ami d’antan Jorn. Ce séjour pour
Constant est un moment important à plusieurs égards, là où
s’effectue la pleine transition de la peinture sculpture vers
l'architecture puis vers l’urbanisme, la première rencontre avec
les Lettristes férus d’urbanisme unitaire, et la culture tzigane.
Car en effet, l’une des principales préoccupations sociales – et
politique - de l’hôte peintre Pinot Gallizio, était de défendre
les tziganes qui campaient aux abords de la cité ; Alba était
depuis toujours un ancien carrefour des caravanes des tziganes allant
et venant de France. Population mal acceptée par la population, le
conseil municipal prit la décision de les expulser et de leur
interdire le droit d’installation. Gallizio proposa alors de leur
offrir la possibilité d’établir leur camp sur une de ses
propriétés. Ainsi, dans cette petite ville piémontaise allaient se
côtoyer un moment, art politique de différents mouvements
artistiques et culture tzigane.
Constant Nieuwenhuys
Constant
Nieuwenhuys visita le camp tzigane avec Gallizio bien connu et
apprécié des tziganes dont il parle la langue - Guy Debord le
surnommait « il principe zingaro », le prince gitan. Constant a pu
certainement les surprendre car il jouait, sans être un virtuose, de
la guitare Flamenca. Mais c’est ici que Constant prend réellement
conscience de la culture nomade tzigane, et surtout leurs conditions
de vie. De nombreuses années plus tard, il se souvient comment cette
expérience a initié le projet New Babylon :
« Les Gitans qui s'étaient arrêtés quelque temps dans la petite ville piémontaise d'Alba avaient pris l'habitude de construire leur camp sous une halle qui abritait autrefois le marché du bétail une fois par semaine. Ici, ils allument leurs feux, attachent leurs tentes aux piliers pour se protéger et s'isoler ; abris improvisés avec des boîtes et des tables abandonnées par les commerçants. La nécessité de nettoyer le marché après tous les passages gitans avait conduit la municipalité à interdire son accès. D'un autre côté, on leur avait assigné un morceau d'herbe sur une berge du Tanaro, une petite rivière qui traverse la ville : un recoin des plus misérables. C'est là que je suis allé les voir, en compagnie du peintre Pinot Gallizio, propriétaire de cette terre rude, boueuse et désolée qui leur avait été confiée. Un espace de caravanes qui était clos avec des planches et des bidons d'essence, dont ils avaient fait une clôture, une Cité des Gitans. Ce jour-là, j'ai conçu le projet d'un campement permanent pour les Gitans d'Alba et ce projet est à l'origine de la série de maquettes de la Nouvelle-Babylone […] ; un camp nomade à l'échelle planétaire. »
Projet pour un camp de Tziganes
Le
mode de vie nomade et libre, la propriété commune des biens et le
désir de conserver intactes les valeurs humaines représentent le
point zéro de la liberté créatrice, de l'aventure et de
l'invention qu'ils défendaient. Constant a l'intention d'approfondir
le thème de l'Urbanisme Unitaire proposé par Debord qui semble
offrir un potentiel extraordinaire pour la mise en œuvre du
programme situationniste.
À
son retour d'Alba Constant, sa première création est une sculpture
intitulée Ruimtercircus (Cirque spatial, 1956-1961). Le titre évoque
l'impact que l’artiste a eu avec la culture nomade. Le cirque est
une micro-société ludique qui parcourt le territoire en occupant de
temps en temps les espaces vides des villes sédentaires. C'est une
ville mobile qui s'installe sur le terrain vague de l'urbanisme
fonctionnaliste, montrant une manière différente d'habiter le
monde. Sa première architecture-sculpture concerna le Ontwerp voor
Zigeunerkamp (Projet pour un camp de Tziganes) en 1957. Après une
première proposition abandonnée mettant en scène une rampe courbe
de béton menant à une plate-forme circulaire (faisant penser au
projet de l’architecte Berthold Lubetkin pour la piscine des
pingouins du zoo de Londres), Constant adopte un tout autre concept.
Il n’impose pas aux nomades un type d’urbanité, des choix
architecturaux bien définis ou définitifs contraignant leurs
libertés, ou leur espace, il conçoit au contraire une structure
permanente mais flexible, une sorte de support pour tente géante où
viennent dessous s’agréger les caravanes et roulottes tziganes, un
support qui offre la possibilité aux occupants de l’investir et de
modifier, de transformer son espace par des toiles et autres
parements suspendus, etc.
Il
ne s’agit pas pour Constant – qui est déjà célèbre en Europe
- de concevoir un camp d’urgence, ni même de sédentariser à tel
endroit des groupes par nature nomades, mais en premier lieu de
dénoncer les conditions de vie dramatiques subies par les tziganes
d’Italie et d’Europe : il s’agit bien d’un projet, d’une
contre-proposition établis contre l’inhumanité des lois
liberticides des gouvernements et des arrêtés expulsifs des
municipalités, pour le Droit à la ville des populations nomades, à
une époque où les tziganes sont toujours et encore sous l’emprise
d’une vox populi stigmatisante les désignant comme des brigands.
C’est également une contre-proposition architecturale s’opposant
à l’architecture fonctionnelle, elle aussi considérée inhumaine,
sévissant en Italie et, en l’occurrence, aux Pays-Bas ; deux pays
qui connaissaient alors une crise du logement sans précédent.
Peut-être,
ce projet conçu onze années après la fin de la guerre est-il une
sorte d’hommage aux tziganes victimes des camps de concentration
nazis, en considérant que Pinot Gallizio fut un partisan communiste
et anti-fasciste durant la guerre, et que le peintre Constant s’était
attaqué à ce thème avec sa toile intitulé Concentratiekamp datée
de 1951. Rappelons qu'en 1954, un arrêt de la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe avait affirmé que les Tsiganes (Zigeuner) avaient été
déportés comme « asociaux », et non pour des raisons raciales :
une idée partagée par l'écrasante majorité de l'opinion
internationale dans l'après-guerre.
NEW BABYLON
Constant
considérait l'urbanisme unitaire comme l’unique moyen de mettre en
œuvre le dépassement de l'art. C'est dans cette perspective qu'une
phase de travail fructueuse commence avec Guy Debord, dans une
profonde amitié et une influence mutuelle. Constant, après avoir
mis un terme – provisoire -à son activité de peintre – en tant
que tel - est en fait le seul situationniste qui a l'intention de se
lancer et à se consacrer pleinement dans l'expérimentation de
l'urbanisme unitaire, et dans son isolement, seul Debord le soutient.
Asger Jorn s’en désintéresse, qui pourtant avait été un des
premiers artistes peintres à se préoccuper d’architecture.
Résultat, peut-être, des rivalités entre les clans situationnistes
– Lettristes et artistes imaginistes.
Quoiqu’il
en soit, après le projet pour le campement des Gitans d'Alba,
Constant élabore les premières maquettes de sa ville, dénommée
par Debord, New Babylon ; s’élabore le concept de mégastructures
suspendues au-dessus du sol, extensibles à l’infini, représenté,
dans un premier temps, par un quartier. La maquette du secteur jaune
(1958) est présentée dans le 4e numéro de l'Internationale
Situationniste (juin 1960), Constant le décrit comme une
construction métallique dégagée du sol, soutenant des niveaux
superposés, qui
« peut-être considérée comme la base pour un aménagement d’éléments-types, meubles, interchangeables, démontables, favorisant la variation permanente du décor. »
« On peut arriver dans cette partie de la ville soit par voie aérienne, la terrasse offrant des terrains d’atterrissage ; soit au niveau du sol, en voiture ; soit, enfin, par train souterrain – selon les distances à parcourir. Le niveau du sol, coupé dans toutes les directions par des autostrades, est vide de bâtiments, à l’exception des quelques pilotis qui portent la construction, et d’un bâtiment rond, de six étages qui supporte la partie en porte-à-faux de la terrasse. […] Tout le reste est intérieurement communiquant et constitue un grand espace commun, dont il faut retrancher deux bâtiments à la périphérie de la ville qui contiennent des logis. »
Constant
Secteur jaune
1958
Constant
Secteur rouge
1958
Constant
Secteur oriental
1959
L’idée
maîtresse est celle d’une méga-structure évidée, climatisée,
d’une cité linéaire aérienne se déroulant à l’infini,
composée ponctuellement d’équipements et de services, et
sillonnée d’espaces de circulation continue faisant un réseau
labyrinthique empruntés par les New Babyloniens. Ils peuvent ainsi
et sont même invités à construire et déconstruire les espaces
libres laissés à leur disposition, pour y dresser leur campement.
Les modules d'habitation sont parfaitement autonomes de la
mégastructure, constitués de l'assemblage d'éléments mobiles
(parois, sols, escaliers, etc.) légers réutilisables, faciles à
transporter, à monter et démonter. Les multiples combinaisons
possibles des éléments standards ne limitent plus les habitations à
un type, mais à une diversité de solutions. La vie ludique de New
Babylon présuppose de fréquentes transformations de l'intérieur
des secteurs.
Nouvelles technologies
C’est
un projet tout à fait constructible mais utopique car profondément
anti-capitaliste – la propriété privée n’existe plus, la
famille également - et post-révolutionnaire, un projet rendu
possible par une nouvelle société libérée du travail grâce à
l’automatisation et la cybernétique, un nouvel ordre mondial
utilisant les nouvelles techniques et technologies non pas pour
enrichir les uns mais pour offrir au plus grand nombre du temps
libre.
« Nous sommes en train d'inventer des techniques nouvelles; nous examinons les possibilités qu'offrent les villes existantes; nous faisons des maquettes et des plans pour des villes futures. Nous sommes conscients du besoin de nous servir de toutes les inventions techniques, et nous savons que les constructions futures que nous envisageons devront être assez souples pour répondre à une conception dynamique de la vie, créant notre entourage en relation directe avec des modes de comportement en changement incessant.»
L’homme
libéré du travail n’aura plus besoin d'une adresse fixe, il
deviendra nomade, libre de circuler et d’explorer la terre, il aura
à sa disposition tout le temps, et l’espace, à consacrer à la
réalisation de ses désirs, et le labeur se transformera en une
activité créatrice ; l’Homo Faber est éliminé transformé en
Homo Ludens, en homme ludique, décrit par le hollandais Huizinga. La
recherche effrénée du profit capitaliste fera place à l’activité
créative par excellence, le jeu. La Nouvelle-Babylone sera donc une
grande œuvre collective, elle sera le fruit de la créativité des
Néo-Babyloniens, d'une nouvelle société multi-ethnique, nomade,
qui aura à construire, déconstruire et à reconstruire indéfiniment
son propre espace.
« Avant tout, cependant, la diminution du travail nécessaire pour la production, par une automation étendue, créera un besoin de loisirs, une diversité de comportements et un changement de nature de ceux-ci, qui mèneront forcément à une nouvelle conception de l'habitat collectif ayant le maximum d'espace social... » (Constant, Une autre ville pour une autre vie, in Internationale situationniste n°3, décembre 1959).
La
reproduction mécanique a aboli la rareté et délivré le temps de
toute nécessité :
« Ceux qui se méfient de la machine et ceux qui la glorifient montrent la même incapacité de l’utiliser. Le travail machiniste et la production en série offrent des possibilités de création inédites, et ceux qui sauront mettre ces possibilités au service d’une imagination audacieuse seront les créateurs de demain. Les artistes ont pour tâche d’inventer de nouvelles techniques et d’utiliser la lumière, le son, le mouvement, et en général toutes les inventions qui peuvent influencer les ambiances. Sans cela l’intégration de l’art dans la construction de l’habitat humain reste chimérique comme les propositions de Gilles Ivain. » (Constant, in Sur nos moyens et perspectives, Internationale situationniste n°2, décembre 1958).
Constant
s’empare du thème de la communication et envisage ce qui sera plus
tard Internet :
« Le monde fluctuant de secteurs requiert des moyens (un réseau de transmission et de réception) à la fois public et décentralisé. Étant donnée la participation d’un grand nombre de gens dans la transmission et dans la réception d’images et de sons, le perfectionnement des télécommunications devient un facteur important pour le comportement social ludique ».
Constant
et les Situationnistes espéraient, à cette époque encore, des
progrès techniques libérateurs (la peinture industrielle inventée
par Gallizio), sans pour autant renier une nostalgie certaine pour
les temps jadis, celle des communautés nomades précapitalistes,
dont les Gitans offraient l’image rémanente, mais également,
celle toute aussi prégnante d’un Paris, d’une Amsterdam
historiques «assassinés » par les grandes opérations de
rénovation urbaine. Romantisme révolutionnaire ? Debord affirmait
pour sa part, dans une lettre à Lefebvre :
« Si le romantisme peut se caractériser, généralement, par un refus du présent, sa non-existence traditionnelle est un mouvement vers le passé ; et sa variante révolutionnaire une impatience de l’avenir. Ces deux aspects sont en lutte dans tout l’art moderne, mais je crois que le second seul, celui qui se livre à des revendications nouvelles, représente l’importance de cette époque artistique. » Lettre de Guy Debord à Henri Lefebvre datée du 5 mai 1960.
Nomades
Après
une première série de maquettes de quartier, New Babylon prend une
autre dimension spatiale, devient une mégastructure, un ruban
continu aérien se développant sur le territoire, la planète,
parcouru par les nomades urbains, et dès ce moment, le nomadisme
ludique occupera une place plus importante pour les penseurs de
l’Urbanisme Unitaire. Comme l’exprimait Constant, les nomades
peuvent emprunter pour leur déambulation ou leurs voyages plusieurs
flux : au sol, l’automobile et le train, les espaces de circulation
à l’intérieur de la méga-structure, l’avion et l’hélicoptére
sur les vastes toitures terrasses.
« Les terrasses forment un terrain en plein air qui s'étend sur toute surface de la ville, et qui peuvent être des terrains pour les sports, les atterrissages d'avions et d'hélicoptères, et pour l'entretien d'une végétation. Elles seront accessibles partout par des escaliers et des ascenseurs. Les différents étages seront divisés en des espaces voisinants et communiquants, artificiellement conditionnés, qui offriront la possibilité de créer une variation infinie d'ambiances, facilitant la dérive des hahitants, et leurs fréquentes rencontres fortuites. Les ambiances seront régulièrement et consciemment changées, à l'aide de tous ses moyens techniques, par des équipes de créateurs spécialisés, qui seront donc situationnistes de profession.»
« Notre domaine est donc le réseau urbain, expression naturelle d'une créativité collective, capable de comprendre les forces créatrices qui se libèrent avec le déclin d'une culture basée sur l'individualisme.» (Une autre ville pour une autre vie., Internationale Situationniste n°3).
Constant
lie l’Homo Ludens à son idéal de « nomadisme planétaire »,
évoqué ainsi :
« L’urbanisme unitaire est contre la fixation des personnes à tels points d’une ville. Il est le socle d’une civilisation des loisirs et du jeu. On doit noter que dans le carcan du système économique actuel, la technique a été employée à multiplier les pseudo-jeux de la passivité et de l’émiettement social (télévision), alors que les nouvelles formes de participation ludique également rendues possibles sont réglementées par toutes les polices : ainsi, les sans-filistes amateurs, réduits à un boy-scoutisme technicien. » (L’urbanisme unitaire à la fin des années 50, International situationniste n° 3, décembre 1959).
Dans
l’Internationale situationniste n° 3, le texte intitulé Discours
sur la peinture industrielle et sur un art unitaire applicable, Pinot
Gallizio évoquait :
« Le monde sera la scène et le parterre d’une représentation continue. La planète se transformera en un Luna-Park, sans frontières, produisant des émotions et des passions neuves... »
Constant
New Babylon Nord
1958
New Babylon Nord
1958
New
Babylon est une tour de Babel horizontale, qui ne vise pas à
conquérir le ciel mais à envelopper la Terre. La dérive nomade,
anti-architectonique par excellence, se transforme ainsi en
architecture. Idéal inspiré par les flâneries de Baudelaire, les
excursions urbaines de Dada, les déambulations des Surréalistes et
les dérives urbaines des situationnistes, l'errance pour Constant
prend la forme d'une tente nomade géante irriguée par des espaces
de circulation :
« Nous réclamons l'aventure. Ne la trouvant plus sur terre, certains s'en vont la chercher sur la lune. Nous misons d'abord et toujours sur un changement sur terre. Nous nous proposons d'y créer des situations, des situations nouvelles. Nous comptons rompre les lois qui empêchent le développement d'activités affectives dans la vie et la culture. Nous nous trouvons à l'aube d'une ère nouvelle, et nous essayons d'esquisser déjà l'image d'une vie plus heureuse... »
« Contre l'idée d'une ville verte, que la plupart des architectes modernes ont adoptée, nous dressons l'image de la ville couverte, ou le plan des routes et des bâtiments séparés, a fait place à une construction spatiale continue, dégagée du sol, qui comprendra aussi bien des groupes de logements, que des espaces publics (permettant des modifications de destination selon les besoins du moment). Comme toute circulation, au sens fonctionnel, passera en dessous, ou sur les terrasses au-dessus, la rue est supprimée. Le grand nombre de différents espaces traversables dont la ville est composée, forment un espace social compliqué et vaste. Loin d'un retour à la nature, de l'idée de vivre dans un parc, comme jadis les aristocrates solitaires, nous voyons dans de telles constructions immenses la possibilité de vaincre la nature et de soumettre à notre volonté le climat, l'éclairage, les bruits, dans ces différents espaces.» (Constant, Une autre ville pour une autre vie, in Internationale situationniste n°3, décembre 1959).
Constant
New Babylon au-dessus de Séville
1965
Constant
New Babylon au-dessus de Den Haag
1965
New Babylon au-dessus de Den Haag
1965
Sans
horaires à respecter, sans foyer permanent, l'être humain connaîtra
une vie nomade dans un environnement artificiel :
« Les barrières et les frontières disparaissent aussi: la voie est ouverte au brassage des populations, qui par conséquent, en même temps, la disparition des différences raciales, la fusion des populations dans une nouvelle race, la race mondiale des Néo-Babyloniens. ) La nouvelle Babylone ne finit nulle part (étant la terre ronde), ne connaît pas de frontières (il n'y a pas d'économies nationales) ou de collectivité (étant une humanité flottante). Tout endroit est accessible à tous et à tous. La terre entière devient une maison pour ses habitants. La vie est un voyage sans fin...» (Nouvelle Babylone, Haags Gemeentemuseum, 1974)
Après
sa démission de l'IS en 1960, Constant continuera à approfondir et
développer l'urbanisme unitaire pendant une dizaine d’années. Les
modèles deviennent de plus en plus grands, les environnements de
plus en plus labyrinthiques. Une nouvelle période commence - que
Wigley appelle de l'hyperarchitecture : Constant aidé d’assistants,
multiplie les expositions et les conférences, il représente les
Pays-Bas à la Biennale de Venise en 1966 ; et deviendra bientôt
l'une des figures marquantes de l'architecture radicale ; en
Hollande, il fut considéré comme l'artiste révolutionnaire du
mouvement Provo. En 1969, il écrit la révolte du Man Ludens et
commence alors à vider son atelier des maquettes, en donnant la plus
grande partie au Gemeentemuseum de La Haye, qui organise en 1974 la
première grande rétrospective.
Constant
Fiesta Gitana
1964
Fiesta Gitana
1964
Debord
décrira en parallèle en 1959 sa propre version d'une ville nomade,
probablement influencée par la Nouvelle-Babylone. C'est la vision
d'une ville en mouvement et en perpétuelle transformation sur le
territoire comme la maison d'Ivain, mais le projet de Debord naît du
détournement de "deux grandes civilisations architecturales (au
Cambodge et au sud-est du Mexique)" qui Profitant des conditions
climatiques dans lesquelles ils s'étaient développés, ils avaient
créé, à travers un mouvement accéléré d'abandon et de
reconstruction, des « cités mobiles » dans la forêt vierge:
« Les nouveaux quartiers d'une ville semblable pourraient se construire de plus en plus vers l'Ouest, labouré, tandis que l'Orient serait également abandonné à l'invasion de la végétation tropicale, qui crée elle-même des étapes de transition progressive entre la ville moderne et la nature sauvage. Cette ville traqués par la forêt, au-delà de la zone dérive incomparable qui formerait derrière elle, et un mariage avec la nature audacieuse des tentatives de Frank Lloyd Wright, aurait l'avantage d'une mise en scène du vol de temps, dans un espace social condamné au renouveau créatif. » (IS n° 3, p.11).
Dans
un chapitre de La Société du spectacle, il évoque le nomadisme,
correspondant à :
« 127
Le temps cyclique est déjà dominant dans l'expérience des peuples nomades, parce que ce sont les mêmes conditions qui se retrouvent devant eux à tout moment de leur passage : Hegel note que ‘l'errance des nomades est seulement formelle, car elle est limitée à des espaces uniformes’. La société, qui en se fixant localement, donne à l'espace un contenu par l'aménagement de lieux individualisés, se trouve par là même enfermée à l'intérieur de cette localisation. Le retour temporel en des lieux semblables est maintenant le pur retour du temps dans un même lieu, la répétition d'une série de gestes. Le passage du nomadisme pastoral à l'agriculture sédentaire est la fin de la liberté paresseuse et sans contenu, le début du labeur. Le mode de production agraire en général, dominé par le rythme des saisons, est la base du temps cyclique pleinement constitué. L'éternité lui est intérieure : c'est ici-bas le retour du même. Le mythe est la construction unitaire de la pensée qui garantit tout l'ordre cosmique autour de l'ordre que cette société a déjà en fait réalisé dans ses frontières. » (Guy Debord, La société du spectacle, 1968).
Pour
les situationnistes, le mode de vie des Tziganes nomades représentait
bien une situation construite, une sorte de survivance dans le
présent des formes de communautés pré-capitalistes de jadis ;
comme l’avaient été les tribus amérindiennes à qui ils
empruntent d’ailleurs le mot Potlatch, qu’il donne à leur revue,
signifiant un don. Ils appréciaient de la même manière l’errance
vagabonde supposée du poète François Villon ou la forme de
nomadisme des chevaliers du moyen-âge : soient des communautés dont
l’existence est indépendante de l’Etat et de l’accumulation
capitaliste, parce qu’elles leur étaient antérieures comme les
sociétés archaïques ou la chevalerie médiévale, soient parce
qu’elles échappaient intentionnellement à leur emprise, tels les
Tziganes. Ces modes de vie des temps anciens devaient leur fournir
des modèles pour concevoir de nouvelles formes révolutionnaires de
vie, libérées du travail et désaliénées. Cette vision d’un
passé historique ou primitif n’est pas une forme de compensation
illusoire et rétrograde d’un présent aliéné, mais elle
constitue un préalable indispensable pour alimenter la critique
sociale et politique et d’envisager de nouvelles formes
d’existence.
MAI 68
La
grande révolte de 68 est l’occasion pour les architectes et les
étudiants des écoles d’architecture les plus engagés dans
l’ouvrage de démolition de la culture petite-bourgeoise, de
critiquer, certes, les massacres urbains et architecturaux mais aussi
de se confronter au réel et de descendre autant dans les rues que
dans les bidonvilles afin d’apporter une aide aux familles qui y
survivent, en majorité des travailleurs immigrés et nombre de
familles tziganes, dont des « Gitans rapatriés » du Maghreb au
sortir de la guerre d’Algérie, comme au bidonville dit « La
Campagne Fenouil » à Marseille.
Daniel
Guibert, architecte évoquait même dans un entretien:
« La vision architecturale avait été largement relativisée, au bénéfice de l'activisme de rue, au bénéfice de l'activisme d'une reconquête de l'espace généralisé de la société. Là, il n'était plus question d'architecture. L'architecture était à la limite relative, subsidiaire. C'était même un bouche-trou, on n'en avait plus rien à faire. Ce n'était pas ça le bon enjeu. L'enjeu était la reconquête de l'espace social total, sous d'autres formes, selon d'autres régimes.» (Gare à l’urbanisme).
Mais
la « fraternisation » étudiants / habitants des bidonvilles fut
très relative, rencontre impossible par l’irréductible décalage
entre les uns et les autres ; et les groupuscules d’extrême gauche
(souvent maoïstes) s’adressent en particulier aux travailleurs
immigrés, lumpenproletariat venu du Tiers Monde exploité par le
capitalisme occidental. Tout ce désordre et ce tumulte parvinrent à
obliger le gouvernement à quelques concessions : en octobre 1968, le
ministre Albin Chalandon fait paraître un décret qui oblige tous
les organismes d’HLM de la région parisienne à réserver 6,75 %
des logements nouveaux aux familles issues de bidonvilles ; et une
jurisprudence rendue en janvier 1969 fixait un nouveau cadre
juridique réglementant le stationnement des nomades:
« Il est indispensable, écrivait le législateur, que les municipalités contribuent dans toute la mesure du possible à l'installation et à l'équipement de lieux de stationnement offrant aux nomades des conditions de vie décente. »
Groupe Utopie
Urbaniser la lutte des classes
1968
Urbaniser la lutte des classes
1968
Dans
la fièvre de l’après mai 1968, partout en France, des cohortes
d’étudiants, en sociologie, en architecture, en médecine, etc.,
s’organisaient pour tenter de venir en aide aux plus démunis venus
du Tiers Monde ; sur le mode de pensée d’alors, l’autonomie, ils
s’emparaient de la question des bidonvilles, toujours reléguée
aux associations caritatives catholique, mais aussi des foyers de
travailleurs immigrés, autant sur le plan politique que pratique en
les investissant, et des aires de stationnement. La difficile
rencontre de ces deux mondes ne sera guère probante.
Ainsi
à Angoulême en 1969, des adhérents d'une maison des Jeunes et de
la Culture se mobilisaient sur le problème des nomades. Un
court-métrage « Aux portes de la ville », est réalisé présentant
le bidonville où habitent dans la boue de l'hiver et la poussière
estivale, des clochards, des nomades sédentaires et autres
voyageurs. Une association naît avec le scandale obtenu dont
l’objectif était la création d’une aire d’accueil moderne et
confortable, plutôt dédiée aux nomades pauvres ; si les autorités,
dans le cadre d’un plan d’urbanisme de la ville, étaient
conciliante et proposaient effectivement un espace dédié aux
nomades, tel ne fut pas le cas des riverains qui s’y opposèrent,
par des recours en justice et autres procédés infligeant au projet
des années d’incertitude et de retards : ce n’est qu’en 1973,
que le terrain de stationnement, ou centre de séjour des Molines est
ouvert. C’est un beau terrain de 15.000 m² en partie boisé,
proche de la ville et d’un nouveau centre commercial, et centre
social et culturel. L’esprit libertaire des militants se concrétise
par plusieurs aménagements de l’espace : le bureau d'accueil est
un préfabriqué léger, situé de telle sorte qu'il n'obstrue pas
l'entrée. Selon Bernard Provot, un membre de l’association :
« Nous voulions par ce fait, exprimer une idée simple : le contrôle d'identité n'est pas le but premier du centre. Ce contrôle est effectué après les gestes de connaissance réciproque. »
De
la même manière, les voyageurs décidaient d’eux-mêmes où
installer leurs caravanes et roulottes, selon les usages et coutumes
des familles, en cercle fermé, ou bien ouvert tout en longueur, à
l’écart du grand espace central commun ou proche. Ces différentes
configurations possibles étaient cependant adaptées lorsque, par
exemple, un afflux de voyageurs arrivait. Les principales
difficultés apparurent très tôt, de familles décidant
d’abandonner la route, pour s’établir ici de manière
définitive, s’appropriant ainsi des espaces bien délimités,
qu’ils refusaient d’abandonner aux nomades venant ici
temporairement. De même, les dégradations, l’absence de soin, les
dépôts d'ordures témoignaient de l'indifférence de certaines
familles à l'égard des lieux dans lesquels on ne fait que passer.
Bref, malgré de bons sentiments, le centre de séjour de Molines
devenu bidonville est fermé en 1984.
Camping à Vias, France
ARCHITECTURE-S MOBILE-S
L’éphémère est sans doute la vérité de l’habitat futur. Les structures mobiles, variables, rétractables, etc., s’inscrivent dans l’exigence formelle des architectes et dans l’exigence sociale et économique de la modernité. (Jean Baudrillard | Utopie, n°1, 1967).
Tandis
que les années 1960 et 1970 voient un phénomène de sédentarisation
des Tziganes, les Français eux adoptent le style de vie bohémien,
tout du moins pour ceux nombreux qui passent leurs vacances ou leurs
week-end en caravane ; de même, les plus jeunes néo-hippies se
lancent dans des aventures plus lointaines les emmenant, notamment,
en Inde, pays d’origine des Roms – nous y reviendrons.
La
mobilité est une préoccupation majeure pour les architectes de
l’avant-garde futuriste ou prospectiviste ; l’architecture
mobile, une de ses composantes mêle ainsi une vision du monde
passéiste - le retour à la nature contre la grande ville - et des
technologies « high tech », dans lesquels une large place est faite
aux équipements, en phase avec les plus récentes innovations dans
le domaine de la
domotique,
de la robotisation et de la miniaturisation ; voire même, en
préfigurant le réseau internet. Selon Eve Roy :
« La réflexion sur la potentielle mobilité de l’architecture conduit beaucoup de jeunes architectes à se regrouper sous forme de groupes de travail ou d’associations, afin de donner plus d’impact et d’ampleur au message qu’ils entendent transmettre : l’architecture de demain sera libérée de son caractère statique et inamovible, elle sera plus légère, plus flexible, en un mot, l’architecture sera mobile ou ne sera pas. Ces groupes adoptent des noms explicites, exprimant à eux seuls les programmes de recherche qui y sont menés. En France, par exemple, le Groupe d’Etude d’Architecture Mobile (GEAM) est créé par Yona Friedman dès 1958, le Groupe International d’Architecture Prospective (GIAP) naît à l’initiative du critique Michel Ragon en 1965 et l’association Habitat Évolutif voit le jour en 1971. Ces réflexions croisées sont représentatives d’un intérêt européen voire mondial pour la question de la mobilité : aux Etats-Unis, on évoque la tradition pionnière pour expliquer les expériences menées durant les années 1960 par des groupes d’architectes anticonformistes (Ant Farm) ; au Japon, c’est l’argument du manque de place qui est avancé pour commenter les projets de capsules d’habitations (Kisho Kurokawa). Mais qu’en est-il de l’Europe ? Les changements technologiques et sociaux justifient-ils ces recherches ? Croyait-on alors réellement que l’habitat futur serait – en partie ou totalement – mobile ? Et quelles sont les raisons de l’absence d’aboutissement de la grande majorité de ces projets innovants ?»
L’architecture
mobile se décline en plusieurs concepts :
. L’Habitat mobile : les caravanes tractées et autres habitacles automobiles fournissent un modèle ou un support. Cela peut être également, dans un concept plus audacieux, des capsules habitables autonomes sur le modèle de la station spatiale Apollo ;
Jean-Louis Lotiron et Pernette Perriand-Barsac
Caravane Fleur
1967-68
La structure de la caravane est gonflable par un compresseur relié à la
batterie de la voiture. Dépliée et gonflée, elle passe d’un volume de 6
m3 à 74,40 m3. (Frac Centre).
. L’Habitat transportable concerne généralement un élément unique, un module, une cellule équipée déplaçable – par camion ou hélicoptère, etc. - et repositionnable, qui ne constitue pas un habitat complet, mais qui peut être agrégé à d’autres. A ce concept s’ajoute souvent celui de la modularité ou flexibilité. C’est le cas des Cabines hôtelières mobiles inventées par l’architecte Ionel Schein en 1956, ou La Maison tout en plastiques. Ce type concerne également les structures gonflables.
Dallegret & Banham
Un-house Transportable standard-of-living package
The Environment Bubble
1965
. La Ville en mouvement : modèle utopique ou contre-utopique peu développé qui adapte la mobilité à une ville entière susceptible de s’auto-déplacer, ou de se liquéfier.
A
ces types d’architecture dite mobile, s’agrège l’Homme mobile
ou Nomade, sur le principe de la fantastique utopie
urbano-architecturale de Constant, New Babylon, qui invitée dans
plusieurs musées d’Europe, expliquée par de nombreuses
conférences du maître, deviendra un modèle pour les avant-gardes
architecturales ; comme d’ailleurs, le projet de Ville spatiale de
l’architecte Yona Friedman. L’architecture mobile prendra son
essor, mais de manière générale, les jeunes architectes la
cantonnent exclusivement aux nomades, aux êtres. L'architecture
mobile est donc l’habitat décidé par l'habitant à travers des
infrastructures non déterminées et non déterminantes. En 1958,
Friedman publie L'Architecture mobile. La mobilité n’est pas celle
du bâtiment, mais celle de l'usager auquel une liberté nouvelle est
donnée. Il définissait ainsi son concept :
« Mobilité : Les transformations sociales et celles du mode de vie quotidien sont imprévisibles pour une durée comparable à celle des bâtiments habituels. Les bâtiments et les villes nouvelles doivent être facilement ajustables suivant la volonté de la société à venir qui les utilisera : ils doivent permettre toute transformation, sans impliquer la démolition totale. C'est le principe de la mobilité, terme que j'ai choisi après beaucoup d'hésitation et faute d'avoir trouvé un qualificatif plus exact.
Architecture mobile : Systèmes de construction permettant à l'habitant de déterminer lui-même la forme, l'orientation, le style, etc., de son appartement et de pouvoir changer cette forme, chaque fois qu'il le décide. » (Extrait de L'architecture mobile, 1974).
La
Ville spatiale de Friedman est un urbanisme tridimensionnel, une
méga-super-structure hors sol, qui se déploie dans les airs,
au-dessus des villes et des campagnes, une ossature vide sur pilotis,
à l’intérieur de laquelle les habitants viennent greffer leurs
cellules habitables démontables et transportables, faites «
d’éléments bon marché, simples à monter, faciles à
transporter, et réutilisables ». En 1968, Pierre Restany établit
un parallèle entre cet urbanisme révolutionnaire et l’irréversible
mutation de la société d’après-guerre :
« Les structures aériennes de Yona Friedman à l’enjambée de l’Histoire correspondent parfaitement à la mobilité organique d’une société révolutionnaire. Ces terrains à étages, ces trames porte-maisons, réseaux d’alimentation, autoroutes suspendues figurent le profil nouveau de la nature moderne. Remplies à moitié, ces villes-ponts ignorent la saturation de l’urbanisme passé. On y branche sa maison, comme le téléphone ou la radio sur le réseau dont les vides calculés figurent les chemins de la liberté individuelle dans la solidarité collective. Dans le monde entier, la théorie de Friedman inspire la pensée prospective. Son efficience est statistique, sa vérité est humaine, son principe est révolutionnaire. L’architecture mobile implique la nécessaire abdication de l’architecte devant l’habitant dans l’intérêt général de la communauté.» (Le livre rouge de la Révolution picturale, 1968).
Pour
Constant, la mégastructure habitable de Friedman reste cependant une
ville figée de sédentaires et fonctionnaliste qui privilégie les
habitations privées sans proposer une nouvelle utilisation de
l'espace social et une nouvelle culture collective. Friedman répond
que New Babylon est la vision d'un dictateur, une société imposée
à des personnes qui devraient plutôt pouvoir choisir leur mode de
vie à la fois en matière de logement et d'espace social.
ARCHIGRAM
Les
jeunes architectes « radicaux » du groupe anglais Archigram né en
1961, ont contribué avec d’autres groupes et personnalités du
monde de l’architecture à démolir les valeurs anciennes et
académiques incrustées dans la profession, s’inspirant en
particulier de la culture Pop. Ce qui était en jeu, c'était la
défense d'un nouvel usage social de la culture, face au projet
global d'une nouvelle réinterprétation du moderne. En 1968,
Archigram définissait ainsi les idées centrales de leur travail :
« Pour les architectes, la question est de savoir si l'architecture participe à l'émancipation de l'homme ou si elle s'y oppose, en feignant un mode de vie établi par les tendances actuelles. »
Archigram
Moment Village Instant
1968
Pour
Archigram, la mobilité, le nomadisme étaient des thématiques
essentielles et traitées soit de manière utopique, ironique (l’on
songe aux Walking Cities, ou aux capsules de survie autonomes nomades
inspirées par la cabine spatiale ultra-technologique d’Appolo) et,
au contraire, en faisant preuve de réalisme, en particulier pour des
projet de structures mouvantes, démontables et transportables sur
camions ou zeppelins (dont Instant City). L’automobile est
également abordée :
« The car is useful for the game of freedom »
lit-on
dans leur revue n° 8 (Archigram, 1968). David Greene y fait la
promotion du Combi Volkswagen dans un article intitulé WE OFFER TEN
PREFABRICATED SETS, illustré par une publicité pleine page de
l'engin.
Archigram
Air Hab
1967
En
1966, Ron Herron propose pour son projet Air Hab, un nouveau type de
tente gonflable repliable, un inflatable dwelling unit designed to be
transported by car, qui forme avec d'autres, regroupés, le Moment
Village. Un module transportable fait office de cuisine et de douche.
En 1968, Peter Cook, affine The Moment Village :
« takes the hypothesis that anything beyond a wink or a nod from a person in one car to a person in another constitutes a communal act and from any point beyond this the village is created. The sequence shows the coming together of cars and support facilities which forms a casual community.»
Archigram
Moment Village Instant
1968
La
même année, Ron Herron à nouveau présente le projet Free Time
Node, Trailer Cage, un « neutral service frame of the multistory car
park ». Sans plus d’explications que :
« Speculative proposal for an expanding/contracting structure servicing trailers/caravans, designed for a society with a 2-3 day working week .»
En
1969, dans un article publié par Architectural Design, Greene expose
:
« Un environnement motorisé est une collection de points de services [...] Les forêts du monde sont votre banlieue - tant qu'il y a une pompe à essence quelque part.»
The
hedgerow village, en 1971, propose la construction tout le long de
bordures de grandes routes, de villages de nomades protégés et
dissimulés par des massifs végétaux :
« Each village would be imperceptible from the country lane. Each village would permit the implanting of a very wide range of dwelling types from 'architected' houses to wayfarers with sleeping bags and spanning through lean-tos, inflatable tents, caravans, etc, a deliberately relaxed and ramshackle combination/conglomeration. »
SUPERSTUDIO
Le
groupe italien très influent Superstudio propose dans les projets
contre-utopique Supersurface [1971] et Actes Fondametaux, une réponse
hallucinée aux interrogations de l'architecturale radicale : la mort
de l'architecture, instrument de domination et symbole du
capitalisme, en intégrant les technologies contemporaines et
futures, y compris sur les êtres humains, devenus des nomades ;
l’architecte Natalini écrivait en 1971 :
« …si le design est plutôt une incitation à consommer, alors nous devons rejeter le design ; si l’architecture sert plutôt à codifier le modèle bourgeois de société et de propriété, alors nous devons rejeter l’architecture ; si l’architecture et l’urbanisme sont plutôt la formalisation des divisions sociales injustes actuelles, alors nous devons rejeter l’urbanisation et ses villes… jusqu’à ce que tout acte de design ait pour but de rencontrer les besoins primordiaux. D’ici là, le design doit disparaître. Nous pouvons vivre sans architecture.
Contre
la concentration excessive de masses humaines, le nomadisme nous
montre la possibilité d’un urban lining sans l’émergence de
structures tri-dimensionnelles, affirmaient-ils, en faisant référence
aux grandes festivals de musique rassemblant des milliers de
personnes sans aucune trace d’architecture, sinon celle des scènes.
Mais pour y parvenir, les nouvelles et futures technologies se
doivent de modifier génétiquement l’être humain, un cyborg ou
homme amélioré doté de sens humains maximalisés, ou bien habillé
d’une fine membrane destinée à réguler la tempérrature et la
respiration (servoskin for survival in hostile (or not friendly)
environment), et en cela Superstudio préfigurent les futures
possibilités offertes par les sciences de la biologie, de la
biochimie, etc., susceptibles d’améliorer l’espèce humaine
délivrée, en fait, de l’architecture et des villes, et ils
songent aux techniques à inventer d’une climatisation de
l’environnement sans enveloppe : l’immatérialité accompagne la
dématérialisation comme son corollaire obligé. La retranscription
architecturale de leurs recherches est finalisée ainsi par une non
ou anti-architecture, par une grille bi-dimensionnelle, une surface
plane au sol, limitée par les reliefs, capable par des écrans
d’énergie et autres techniques sophistiquées de contrôler le
climat, comprenant un ensemble de réseaux et de flux enterrés
permettant de distribuer les ressources nécessaires et besoins
primaires pour la survie des cyborgs-nomades (eau, électricité,
téléphone, internet, etc.). Une grille universelle, réalisant un
village global, démocratique donc, où les nomades, génétiquement
modifiés et sous l'emprise de drogues mais libérés des contraintes
du travail, se connectent et se branchent.
Superstudio
Atti fondamentali
Vita accampamento
1971
Superstudio
Life - Supersurface - Fruits & wine
1971
Transhumances Hippies
Jack
Kerouac avec son livre On the Road, Sur la route, paru en 1957, signe
l'acte de naissance de nouvelles générations de nomades, beatniks,
puis hippies, puis Globe Trotters : des jeunes Occidentaux prennent
la route comme on entre en religion. Les auteurs français seront mis
à contribution, Baudelaire, pour ses paradis artificiels, Rimbaud
pour son vagabondage et voyage lointain, et le surréalisme peut
paraître comme un précédent important, notamment grâce à André
Breton qui rêve de rupture totale et qui termine un poème dans «
Les pas perdus » en 1922 par un appel au départ :
Lâchez
tout.
Lâchez
Dada.
Lâchez
votre femme, lâchez votre maîtresse.
Lâchez
vos espérances et vos craintes.
Semez
vos enfants au coin d’un bois.
Lâchez
la proie pour l’ombre.
Lâchez
au besoin une vie aisée, ce qu’on vous donne pour une situation
d’avenir.
Partez
sur les routes.
Graham Bourne
Magic Bus | Istanbul
1976
De
même, Henri Michaux proche du suréalisme, grand voyageur, qui
sillonnera l'Amérique du Sud, la Chine, l'Inde, et l'Afrique. Mais
il considère que la seule expérience probante est intérieure.
Explorateur de l'inconscient et du rêve, il faisait grand usage de
drogues hallucinogènes, dont la mescaline.
Non non, pas acquérir.
Voyager pour t'appauvrir, voilà ce dont tu as besoin.
(Poteaux d’angle, 1971).
Les
routards vont fuir le tourisme des 3S des 4S (Sand, Sea, Sun, hors
Sex) et font à leur façon voeu de pauvreté avec un sac à dos pour
tout bagage, et le pouce pointé comme moyen privilégié de
transport, ou/et les cars low-cost faisant la liaison Londres
Katmandou, ou comme alternative, le recyclage de véhicules de toutes
sortes en habitacle nomade pour sillonner les routes vers les Eden
préservés du modernisme, celles menant aux z'Indes pour les
européens. «_La terre est notre pays_» proclament-ils, à la
manière des Tziganes, mais si le nomadisme hippy, dans son âge
d'or, explore les pays pauvres de la planète, il ne s'agissait pas
de « coloniser », mais d'être colonisé, par le contact de
population pauvre n'ayant pas encore été atteinte et dé-naturée
par le modernisme et le consumérisme.
Eloge de l'autonomadie
Si
l'auto-stop restait le moyen privilégié de voyager, un autre
phénomène prit son essor : le voyage en groupe – en communauté -
en partageant automobile, camionnette, fourgonnette, minibus,
camions, bus, car... le plus souvent d'occasion. De nombreux
véhicules n'ont d'ailleurs jamais fait tout le chemin, et beaucoup
d'autres n'ont jamais connu de retour. Les fourgonnettes et les
minibus étaient considérés comme un moyen de locomotion permettant
tout à la fois une liberté par rapport aux transports publics et
privés mais aussi une excellente alternative aux possibilités
d'hébergement.
Bien
évidemment, l'industrie automobile s'empara du phénomène très
tôt, et de nombreuses firmes développeront des modèles leur étant
dédiés ou bien, adapteront leur stratégie publicitaire.
Un
autre phénomène apparaît en simultané : la transhumance de
plusieurs milliers de personnes allant et venant des grandes messes
musicales qu’étaient les festivals de musique. Woodstock en 1969
fut le premier – qui marque d’ailleurs la fin de l’âge d’or
hippy – suivi d’autres, dont le festival de l’île de Wight en
Angleterre. L’architecte Cristiano Toraldo Di Francia estimait :
« Des concentrations telles que celles de l'Ile de Wight ou Woodstock montrent la possibilité d'une vie urbaine, sans l'apparition de structures tridimensionnelles pour base. Le libre rassemblement et la libre distribution, le nomadisme constant, le choix des relations interpersonnelles qui dépassent toute hiérarchie préétablie sont des caractéristiques qui sont de plus en plus évidentes, dans une société libérée du travail. »
Ces
nouveaux phénomènes planétaires ne pouvaient qu'intéresser les
architectes « radicaux », qui d'une part vont imaginer des
métamorphoses ou de nouvelles fonctions pour les véhicules, et
d'autre part, rêver de structures de services les accueillant. Si
certes, l'automobile est source de pollution, elle est surtout
considérée, à cette époque, comme un instrument de liberté,
permettant d'échapper à la tyrannie des transports, et en outre,
elle s'avère être, avant 1974, un des modes de déplacement le plus
économique pour voyager, notamment en groupe ou en communauté.
L'automobile permet la démocratisation de l'espace, elle le rend
accessible et contraint le temps de ce qui jadis était réservé aux
plus aisés.
David Hurn
Festival Isle of Wight
1969
Archigram
Instant City Visits Bournemouth
1968
Effet
de mode, ou conséquence de la crise du pétrole, qui mettra un terme
à cet âge d’or qu’était l’architecture radicale, les groupes
d’architectes ayant pourtant une aura et une renommée
internationales, exposant sans relâche dans les musées, les
biennales et autres grandes expositions, disparaissent aussi vite
qu’ils étaient apparus. Le temps des utopies joyeuses et
turbulentes, comme celui des contre-utopies plus négatives et
sombres, ce moment festif à la fois populaire et culturel, tout ceci
céda la place au renouveau du plus triste réalisme, érigé comme
seul dispositif susceptible d’être opposé à la crise.
C’est
aussi le moment où le nomadisme de loisir pratiqué par les premiers
hippies et globe-trotters est rattrapé, happé progressivement par
l’industrie touristique ; le développement des charters low-cost
réduisent les temps de parcours et la multiplication des
destinations augmentent sensiblement le nombre des transhumains ;
dans le monde entier, à Bali comme à Ibiza, les communautés
hippies sont chassées des sites encore vierges et paradisiaques
qu’ils squattaient, pour que se dressent hôtels et camp de
vacances confortables pour un nombre de touristes en augmentation
permanente ; non sans rappeler, pour certains tout du moins, la
liberté hippy. En exemple, le Club Méditerranée – dont les clubs
étaient des baisodromes - a su exprimer jusqu'au paroxysme cette
envie de sexualité débridée : « Au club, on vit autrement. Au
club, on vit comme on a envie.»
« Empiriquement parlant, ceci veut dire que le néocapitalisme et le néo-impérialisme partagent l’espace dominé en régions exploitées pour et par la production (des biens de consommation) et en régions exploitées pour et par la consommation de l’espace. Tourisme, loisirs deviennent de grands secteurs d’investissement et de rentabilité, complétant la construction, la spéculation immobilière. » (Henri Lefebvre, La production de l’espace).
Si
l’industrie touristique détruit l’errance de jadis, les «
clochards célestes », l'Etat s'oppose à toute idée de nomadisme «
non contrôlé ». Cette liberté, fondée sur le mouvement, est une
menace pour l'idéologie conservatrice. Zygmunt Bauman, dans Le Coût
humain de la mondialisation, précisait :
« Un monde sans vagabonds, telle est l'utopie de la société des touristes. »
« Les vagabonds constituent le déchet d'un monde qui se consacre entièrement au service des touristes. (…) Les touristes voyagent parce qu'ils le veulent ; les vagabonds parce qu'ils n'ont pas le choix. On pourrait dire que les vagabonds sont des touristes involontaires. » (Le Coût humain de la mondialisation, 1999)
Robert Doisneau
Plan-de-Grasse
1969
Hans Silvester
Saintes-Maries-de-la-mer
1974
Les Ports Terrestres
Si
les Tziganes ont inspirés le monde culturel et intellectuel, il n’en
sera pas de même pour les politiques qui depuis l’après seconde
guerre mondiale se succèdent pour parvenir - enfin - à leur
objectif : sédentariser les nomades, tout du moins les nomades les
moins aisés, les plus rebelles, en sachant que dans leur grande
communauté, co-existaient des Tziganes aisés, en particulier dans
les familles de forains, qui habitaient l’hiver dans leur propre
demeure. Mais, d’une manière générale, la grosse cohorte des
Tziganes étaient au sortir de la seconde guerre mondiale des
nomades, même si certaines familles pouvaient volontairement
s’établir dans une ville pour de longs mois, sédentaires habitant
parfois même dans des vieux immeubles d’habitations des quartiers
dégradés.
A
Marseille, la majorité des Tziganes ayant choisi un mode de vie
sédentaire volontaire, et un revenu régulier, logeaient en ville
(chambres de bonne, hôtels, meublés) ; les nomades nouveaux venus
et plus démunis pouvaient sans grande peine trouver un lieu pour
établir leur campement, dans les zones péri-urbaines, notamment
dans les quartiers nord de la ville où s’érigeaient une
succession de campements devenant au fil des ans un vaste bidonville,
et dans la ville même, car en effet, outre les campements illégaux
sur les parcelles publiques, des propriétaires de terrains non
occupés ne refusaient pas de les leur louer. Cette pratique plus ou
moins légale, dérangea les autorités, car en majorité ces
terrains où s’installaient des familles entières n’étaient pas
équipées en eau, en sanitaires et en électricité.
De
même, à cette époque, les nombreux forains – Tziganes ou non –
plus ou moins aisés, se plaignaient de ne pas pouvoir loger avec
sûreté leurs caravanes. L’on leur accorda, plus tardivement,
l’autorisation d’occuper le vaste terrain de camping municipal «
La Mer » situé en bordure de la plage, face à l'Hippodrome. Sur ce
terrain parfaitement équipé, les redevances cumulées pouvaient
atteindre par famille, 10 Francs par jour et davantage, somme
importante.
En
attendant, il fut envisagé de résoudre le problème par la création
d’une « aire de stationnement », une des premières en France de
ce type, connue administrativement sous le nom de « Parc du
Boulevard du Capitaine-Gèze» (du nom de l’avenue située au nord
de la ville), où étaient admis exclusivement les forains patentés
et les marchands ambulants sans domicile fixe : conditions que
remplissaient la plupart des forains nomades tziganes. Décidé en
1949, et sans doute ouvert en 1952, le « parc » offrait un terrain
clos de 5000 m², proche de la ville, d’une zone industrielle, de
l’autoroute et d’un bidonville où vivaient communautés
algérienne et espagnole ; le « parc » était équipé de deux
sanitaires et de deux fontaines d’eau potable, et disposait de
poubelles, « parc » surveillé à l’entrée par un gardien chargé
outre de vérifier les papiers, d’encaisser les frais de séjour.
Les familles installées dans le parc étaient visitées par les
assistantes sociales de la Caisse d'Allocations familiales, et par le
Service social de Protection maternelle, familles aidées également
d’une manière ou d’une autre par des initiatives privées et
d'ordre religieux qui ont été essentielles pour assurer le
fonctionnement du « parc ». Toutes ses bonnes volontés au chevet
de cette opération architecturale expérimentale, en contact avec
les nomades et itinérants, purent dès lors apporter aux autorités
compétentes, les nécessaires améliorations qu’ils souhaitaient :
• Un
bâtiment regroupant un guichet administratif, détaché d'un Bureau
annexe de la Mairie, animé par un ou plusieurs agents, un guichet de
dépannage social, et des permanences médicales ;
• Un
ou plusieurs autres concernant le domaine scolaire (crèches,
maternelles, garderies, classes normales, classes d'arriérés jeunes
ou adultes, cantines) ;
• Une
« maison du nomade » pour l’hygiène corporelle (épouillage,
bains-douche, coiffeur, laverie, repassage) ; et pour « l'éducation
» des grands (bibliothèque illustrée, projection de documentaires,
etc.). Une maison également culturelle faisant office de salle
polyvalente pour la projection de film, les représentations
théâtrales, musicales et de salle des fêtes.
Evidemment,
ces programmes ne naîtront jamais ; mais Francis-J.-P. CHAMANT, le
Directeur honoraire des Services administratifs de la Ville de
Marseille, investigateur du parc espérait avec foi :
« Nous dirons que nous souhaitons que les aires de stationnement deviennent pour les nomades ce que sont, pour les bâtiments maritimes, les ports d'attache : un centre d'intérêt, avec des antennes réceptives et émettrices dans toutes les directions, administratives, sociales, professionnelles et autres, un point sur une carte géographique, un nom dans une nomenclature d'atlas ou d'annuaire, certes, mais avec tout ce que comporte de vivant et de réconfortant un pavillon qui flotte joyeusement sur un point de ralliement, un foyer d'où rayonnent les flammes brillantes et chaudes de la charité, et où viennent, en parfaite communion, se réanimer les frères enfin retrouvés. » (Etudes Tsiganes, 15 juillet 1955).
Terrain de stationnement à Bordeaux
1972
Etudes Tsiganes n° 1
Les bidonvilles municipaux
Les
premiers camps municipaux dédiés spécifiquement aux nomades, et en
théorie comportant des équipements techniques (eau, électricité
et poubelles), apparaissent à cette époque, mais d’une manière
totalement inégale autant dans le temps et l’espace que dans le
degré d’habitabilité ou de confort, selon la bonne volonté d’un
maire, d’un curé insistant, ou la réticence d’un conseil
municipal, de les accueillir ou non. Dans leur immense majorité, ces
premiers camps deviendront très rapidement des bidonvilles,
d’ailleurs nombreux sont ceux ayant été implantés à proximité
immédiate d’une décharge.
Bernard
PROVOT, dans un article paru dans la revue Etudes Tsiganes (1979-04),
critiquait les aires de stationnement réservées aux Tziganes, même
s’il reconnaissait qu’elles étaient en partie habitées ou
fréquentées par des tranches de populations qui ne sont pas parmi
les plus dynamiques ni parmi les plus itinérantes ; mais qui
représentent une masse non négligeable de nomades. En premier, il
déplore l’enfermement, l’espace clos des aires, surveillées par
un gardien chargé, en théorie, d’y faire régner l’ordre. Loin
d’être un espace de sociabilité, l’aire est plutôt un
amplificateur des tensions entre ses occupants, un espace clos et
restreint favorisant les rivalités entre clans et familles, la
jalousie entre démunis et plus aisés :
«l'amplification des phénomènes, l'exaspération des attitudes et des sentiments, ajoutent à la vie propre du terrain une animosité jamais éteinte que la moindre étincelle déclenchera, et d'autant plus facilement que le peuple tsigane, uni pour les besoins littéraires et culturels, est sapé à la base par des déchirures claniques et tribales, sinon familiales. [...] Terrain d'apprentissage à la vie sédentaire, pour les pouvoirs publics ; terrain «obligé », pour les nomades ; terrain de liberté, pour les animateurs, il n'est rien de cela en totalité. Mais une fermentation s'y produit, qui conduira certains vers plus d'exclusion encore, et d'autres vers une intégration plus prononcée.»
Narbonne
Etudes Tsiganes
N° 2-3 | 1972
Avignon
Etudes Tsiganes n° 3 | 1977
Marseille
Etudes Tsiganes | 1971
Etudes Tsiganes | 1971
Avignon : une première cité gitane
Le
premier obstacle à la sédentarisation qu'ils rencontraient était
d'ordre financier. Ils trouvaient difficilement les crédits
nécessaires pour acquérir la petite maison avec terrain dont ils
pouvaient rêver ; et le logement en H.L.M. présentait des
difficultés : bien souvent, ils n'avaient pas le minimum de revenus
susceptibles de les faire agréer. Pour ces raisons, fut tenté en
Avignon une expérience originale.
Car
ici, à proximité immédiate du Palais des Papes, jusqu’à la fin
des années 1950, les Tziganes habitaient les taudis du quartier de
la Balance. Lorsqu'en 1946, la loi Marthe Richard supprime les
maisons de prostitution, certaines maisons de ce quartier deviennent
vacantes ; elles offrent alors de nouvelles possibilités
d'installation à une population misérable comprenant des familles
gitanes. La vétusté, le délabrement de ce quartier ont entraîné
le départ d'habitants remplacé à mesure par des familles de plus
en plus pauvres.
La
municipalité décida de rénover ce quartier de misère et
d’insécurité qui gênait la sensibilité et la promenade des
touristes, et des premiers spectateurs du festival, devant promouvoir
l'image d'Avignon, ville d'art et de culture. L’opération urbaine
d’envergure de tabula rasa puis de reconstruction était destinée
au relogement de cette population pauvre, incompatible avec le
festival : en 1959, familles paupérisées et familles gitanes sont
relogées pour ces dernières à la cité provisoire de Malpeigné,
en attendant le relogement dans une cité pérenne « gitane » en
périphérie de la ville.
C’est
dans un sens également une démarche expérimentale dans le
traitement politico-administratif des bohémiens, nomades, gens du
voyage, qui peut se résumer, comme d’ailleurs pour les populations
immigrées à faible revenu, à une logique dont les étapes
successives distinctes vont de l’exclusion à la réclusion, puis à
l’inclusion et à l’assimilation, et en particulier, par
l’habitat avec ce programme idéologique de la « construction
adaptée » selon les types de population et celui de scolarisation
des enfants.
Le
célèbre Georges Candilis fut l’architecte désigné en 1961 pour
la conception et la construction de la Cité du Soleil, achevée en
1964 pour sa première tranche. Cet ensemble de 131 logements «
économiques », une des premières « cité pour gitans »
construite en France, opération financée par la Société centrale
immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), était
constituée de logements mitoyens individuels en duplex, disposés en
trois anneaux, nommés respectivement « Esmeralda, Sarah et Carmen »
; en leur centre était consacré à un espace commun convivial,
suggérant, sans doute pour le concepteur, les roulottes de jadis
encerclant le feu du campement. Est créée une association ayant
pour but « de prendre en charge le monde gitan et d'aider à sa
promotion sociale et à son intégration économique ».
L’association, composée exclusivement de Gitans, presque tous
habitants de la « Cité du Soleil » se fixait comme premier
objectif la surveillance de la propreté, le contrôle des chiens
errants et le nettoyage des ordures ménagères.
Cependant,
cette opération expérimentale suscitera de très nombreuses
critiques et sera finalement détruite. Car en effet, la priorité
accordée à l’économie montra ses limites, de graves
inconvénients de cités construites avec des matériaux de mauvaise
qualité et à la conception douteuse ; ainsi, l’absence
d’isolation : le remplissage de l'ossature en béton armé était
réalisé en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur, restés bruts à
l'intérieur ; la toiture, constituée par des panneaux de 20 mm
d'épaisseur en fibre de bois agglomérés, n'a pas résisté à la
première pluie ; la montée d'escaliers débouchant sur trois
petites chambres à peu près remplies par l'indispensable lit, ne
comportait même pas une rampe ; et l'absence de portes gênait
l’intimité ; les normes de sécurité incendie prévues par la loi
n’étaient pas respectées. En outre les associations venant en
aide aux Voyageurs critiquaient vivement le fait que sa conception
avait été faite sans concertation avec les principaux concernés :
les habitants ; qui protestaient :
• Un
seul type de logement, trop petit pour les familles nombreuses. Or la
majorité des familles tziganes sont très nombreuses.
• La
disposition des logements en anneau, une conception folklorique plus
qu’un urbanisme soucieux des modes de vie et manières d'habiter de
la population tzigane, ainsi soumise à une sorte de panoptique
architecturale.
• L'impossibilité
de chauffer convenablement les logements, notamment quand le mistral
soufflait. La mauvaise étanchéité des portes laissant pénétrer
l’air froid et la pluie en hiver, les poussières en été.
• L'escalier
sans rampe a provoqué la colère des parents dès le premier
accident.
Pierre Joly | Véra Cardot
Cité du soleil
1964
Un
article intitulé La cité du soleil par René Bernard de la revue
Etudes Tsiganes paru en 1971 déplorait ainsi :
« En résumé, les Gitans ont compris une fois encore combien ils étaient relégués. La construction en cercle pour des Gitans sédentarisés depuis deux générations ou semi-sédentarisés a abouti à entasser des personnes et des familles les unes sur les autres, chacun vivant avec la désagréable impression d'être soumis à la surveillance des autres. Cette cité est le signe malheureusement évident d'un jugement porté sur le peuple gitan, d'une mentalité que nous connaissons trop. Cette cité manifeste l'ignorance des services administratifs qui se dispensent d'une analyse sérieuse de la réalité locale. Certes la municipalité a essayé par la suite et sous la pression de l'Association de créer une équipe sociale. Mais celle-ci, malgré son dévouement et sa compétence s'est trouvée isolée, les services ne soutenant pas son action. La démission de l'assistante sociale, connue de tous pour son courage et son savoir-faire, a déclenché une crise et mis les autorités au pied du mur. Allait-on accepter les Gitans comme ils sont, avec leur mentalité originale, allait-on dépasser les réactions sentimentales pour analyser sérieusement le fait gitan et tirer de là des projets d'action dûment réfléchis ? Allait-on mettre le prix pour que les Gitans acquièrent cette liberté dont le manque de culture, l'abandon les ont privés ? Actuellement et depuis deux ans, la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale a relayé l'équipe sociale de la Mairie. L'analyse globale du fait gitan en Avignon se réalise d'une manière permanente. La Cité est condamnée ».
Jean-Marie
Liger signait un article paru dans Etudes Tsiganes en 1990 (n°4) :
« Mal implantée, mal conçue, fragile, cette cité va rapidement se dégrader ; ses alentours deviennent un lieu de stationnement non organisé ; la fuite des familles vers d'autres lieux d'habitation s'amorce très tôt. En 1969, cinq ans après sa conception, le constat de dégradation est fait... L'adjonction à cette cité de logements pour les harkis n'arrangera rien ! En 1974, c'est le constat de bidonvilisation totale qui sera établi ! [...] A l'époque de la construction de la Cité du Soleil, l'exclusion sociale se traduisait par un rejet d'une minorité vers l'extérieur de la ville ; l'entité « cité » était porteuse de problèmes ; l'on pouvait parler de « cité ghetto » et l'aborder comme phénomène à analyser et traiter.»
Peut-être
cette opération expérimentale a-t-elle fait emploi de contre-modèle
à éviter à tout prix pour les décideurs et aménageurs : rares
seront ce type de « cité adaptée » construite après celle-ci ;
en Avignon, la Sonacotra préféra attribuer aux nomades désirant se
sédentariser, des appartements des cités HLM les plus vétustes et
éloignées du centre, parfois en leur accordant le rez-de-chaussée
qu’ils souhaitent, ou exceptionnellement en les autorisant à
laisser stationner leurs caravanes sur les parkings, et des taudis
des cités de transit ou d’urgence en périphérie. Là se
constitueront, de manière intentionnelle, des ghettos regroupant
familles d’origine nord-africaines et tziganes parmi les plus
modestes.
NOMADOLOGIE
Loin
de s’épuiser, l’usage métaphorique des sociétés nomades
connaît à la fin du 20e siècle un nouvel essor dans les sciences
sociales et la philosophie ; qui se conjugue avec l'errance, le
vagabondage, l'exil volontaire ou forcée, la pensée ou la raison
nomade, et qui sait s’adapter aux nouvelles formes de mobilité
immatérielle, et d’hyper-mobilité mais aussi aux nouvelles
conditions politiques inscrites dans ce qu’ils nommaient le
post-capitalisme libertaire. La référence aux cultures rroms n’est
pas anecdotique, mais elle n’occupe plus l’espace central que
leur accordaient les penseurs d’hier ; espace d’ailleurs occupé
par les tsignanologues.
Jean
Duvignaud, Paul Virilio et Georges Pérec dissertent dans la revue
Cause Commune consacrée au thème des Nomades et Vagabonds (1975) ;
Duvignaud y écrit :
« Vivre, c'est pouvoir vivre au-delà des limites et des bornages établis par la cité ou la civilisation. L'homme des civilisations n'est point adéquat à son essence - et il le sait. Vivre jusqu'au bout, c'est dépasser les frontières, pénétrer dans le voyage comme dans une matrice. »
« La ville capitalise les instances immobiles de l’homme, son besoin de se coucher tout du long dans une durée construite avec le vide du passé et le vide de l’avenir. Le nomade, lui, s’étale dans l’horizontal épanouissement de l’homme à la surface de la terre : il faut détruire la ville.»
« Le nomadisme reste toujours un recours. Dans son principe même, c’est-à-dire cette vocation qui lui donne à la fois la possibilité de circuler par la ruse dans un cosmos hostile, dans une civilisation figée et la capacité de résoudre le consensus sur lequel repose le système politique pour le remplacer par le droit social, c’est-à-dire par l’invention de formes sociales nouvelles qui ne se cristalliseraient pas en institutions. Que cette effervescence créatrice soit indiscutablement liée au nomadisme, c’est ce que montrent tout aussi bien les fêtes où se concentre dans une brève et périssable portion de la durée, une intense expérience de la création commune et cette sorte de reprise de l’homme par lui-même qui découvre que son existence lui a été ravie par les institutions figées et en fin de compte par l’histoire (au sens hégélien de ce mot). Le nomadisme est la genèse utopique de l’homme à venir. » (Esquisse pour le nomade).
Parus
en 1975, ses propos n’auront guère de consistance auprès des
nouvelles avant-gardes architecturales. Les avant-gardes
architecturales radicales, décapitées dès après la crise
économique de 1973, n’auront pas donné naissance à une
progéniture poursuivant leurs critiques et recherches et tout au
contraire, les nouvelles élites de l’architecture abandonnent le
monde du futur, des technologies et de la liberté pour se retrancher
et dans une discipline cloisonnée, étanche, et dans un monde passé
susceptible de redonner un sens à l’urbanité mise à mal par les
conséquences d’une crise économique majeure : l’architecture
dite urbaine, le projet urbain deviennent alors hégémonique ; dans
le cadre de cette nouvelle doxa, plutôt qu’une révolte, les
théoriciens avancent l’idéal d’une mixité sociale à
ré-inventer ; une société urbaine - traditionnelle - où les
différentes classes sociales, les minorités vivraient en parfaite
harmonie. Telle est, pourrait-on résumer, leur nouvelle utopie car
incompatible avec la réalité : les cités des banlieues, en
France, s’enflamment, et arrive après la chute du mur de Berlin et
l’éffondrement du bloc soviétique, une nouvelle vague de Rroms,
ravivant un racisme en sommeil.
Mais,
comme il se doit, d’autres courants de l’architecture s’abreuvent
de cette triste réalité, et en prenant comme modèle les films de
la nouvelle vague réaliste emmenée par le réalisateur Wim Wenders,
s’esquintent-ils à exacerber les prodigues du capitalisme : les
terrains vagues, les friches industrielles, etc., bref, le chaos
urbain, la ville déglinguée, sont sources d’inspiration. Il ne
s’agit plus de réparer la ville mais de l’appréhender par ses
zones les plus sombres, celles éloignées de la démocratie et de la
justice sociale. Il ne s’agit plus d’apporter aux personnes y
vivant une quelconque attention, un projet, mais plutôt de magnifier
leur paysage, leur laideur même. Ce courant peut s’appuyer ou
s’inspirer du - plutôt obscur - concept de déconstruction
développé par le philosophe Jacques Derrida ; ou des
interprétations des thèses de philosophes français Félix Guattari
et plus particulièrement de Gilles Deleuze, et affronter les
idéologies purement régressives passéistes (mise en valeur du
passé urbain, muséification des centres-villes, modèles
d’architecture hérités, etc.) inefficaces et dangereuses pour
répondre aux défis contemporains. Le nomadisme tzigane est éliminé,
ou conjugué à toutes les sauces, ou virtuel [dé]matérialisé par
le réseau Internet.
Gilles
Deleuze et Félix Guattari, sont les pères du concept de la
nomadologie, expliqué au chapitre intitulé « Traité de
Nomadologie : la machine de guerre », de leur ouvrage majeur Mille
Plateaux qui paraît en 1980. A propos des hordes barbares nomades
venues d’Asie des siècles plus tôt, dont le combat pour
l’occupation des territoires oppose les machines de guerre des
sociétés nomades aux appareils de capture des formations impériales
de l’État archaïque, ils soulignent :
« C'est vrai que les nomades n'ont pas d'histoire, ils n'ont qu'une géographie. Et la défaite des nomades a été telle, tellement complète, que l'histoire n'a fait qu'un avec le triomphe des Etats. On a assisté alors à une critique généralisée qui destituait les nomades de toute innovation, technologique ou métallurgique, politique, métaphysique. Bourgeois ou soviétiques (Grousset ou Vladimirtsov), les historiens considèrent les nomades comme une pauvre humanité qui ne comprend rien, ni les techniques auxquelles elle resterait indifférente, ni l'agriculture, ni les villes et les Etats qu'elle détruit ou conquiert. On voit mal cependant comment les nomades auraient triomphé dans la guerre s'ils n'avaient pas eu une forte métallurgie : l'idée que le nomade reçoit ses armes techniques, et ses conseils politiques, de transfuges d'un Etat impérial, est quand même invraisemblable. »
Et
:
« Une des tâches fondamentales de l'Etat, c’est de strier l’espace sur lequel il règne, ou de se servir des espaces lisses comme d'un moyen de communication au service d'un espace strié. Non seulement vaincre le nomadisme, mais contrôler les migrations, et plus généralement faire valoir une zone de droits sur tout un “extérieur”, sur l'ensemble des flux qui traversent l’oecumene, c'est une affaire vitale pour chaque Etat. L'Etat en effet ne se sépare pas, partout où il le peut, d'un procès de capture sur des flux de toutes sortes, de populations, de marchandises ou de commerce, d'argent ou de capitaux, etc. Encore faut-il des trajets fixes, aux directions bien déterminées, qui limitent la vitesse, qui règlent les circulations, qui relativisent le mouvement, qui mesurent dans leurs détails les mouvements relatifs des sujets et des objets. D'où l'importance de la thèse de Paul Virilio, quand il montre que “le pouvoir politique de l’État est polis, police, c'est-à-dire voirie”, et que “‘les portes de la cité ses octrois et ses douanes sont des barrages, des filtres a la fluidité des masses à la puissance de pénétration des meutes migratrices”, personnes, bêtes et gens. »
EPILOGUE DEBORDIEN
La
culture tzigane intéressait Debord, depuis le campement de Constant
jusqu’à l’amitié du cinéaste Tony Gatlif, né en 1948 dans un
bidonville de la banlieue d’Alger, de père Kabyle et de mère
gitane. Guy Debord rencontra le réalisateur par l’intermédiaire
de son éditeur Gérard Lebovici, le fondateur d’Artmédia, qui
finança en partie son film intitulé Les Princes en 1983. Lebovici
est subjugué, comme Guy Debord qui avait visionné ce long métrage
noir dans la description des siens, de leurs habitudes, de leurs
moeurs, de leurs traditions et de leur légendaire orgueil. Debord
rédigera lui-même les slogans publicitaires de l’affiche :
« les princes ne vont pas à l’école, les princes n’habitent pas les HLM, les princes ne votent pas socialiste. »
Si
les évocations des Tziganes n’apparaissent guère dans l’oeuvre
écrite de Debord, le monde Rrom est central pour sa seconde épouse,
Alice Becker-Ho, traductrice en français du roman de Federico García
Lorca, El Romancero gitano. Le grand poète comme dans ses lettres ou
ses conférences, faisait l'éloge des Gitans et présentait ainsi
son oeuvre :
« Le recueil porte comme titre Gitan mais en fait c'est le poème de l'Andalousie. Je le qualifie de gitan parce que le Gitan est ce qu'il y a de plus sublime, de plus profond, de plus aristocratique dans mon pays, de plus représentatif de sa y a de plus sublime, de plus profond, de plus aristocratique dans mon pays, de plus représentatif de sa manière d'être, ce qui garde la braise, le sang et l'alphabet de la vérité andalouse et universelle ».
Alice
Becker-Ho cite son époux comme un passionné des Gitans et donne ce
résumé correspondant point par point à l’aventure situationniste
:
« Il n’y a pas de héros légendaires chez les Tziganes, pas d’histoire concernant l’origine, pas de justification de la vie errante. »
Formule
que l’on peut rapprocher de celle d’Emil-Michel Cioran:
« Peuple authentiquement élu, les Tziganes ne portent la responsabilité d'aucun événement ni d'aucune institution. Ils ont triomphé de la terre par leur souci de n'y rien fonder.» (Syllogismes de l'amertume, 1987).
Dans
son court essai consacré aux Princes du Jargon (1990) avec comme
sous-titre, « un facteur négligé aux origines de l’argot des
classes dangereuses », Alice Becker-Ho s’est attachée à établir
une corrélation entre l’apparition des Gitans en France et la
naissance d’ « un jargon spécifique, ou langage secret, devenu
depuis l’argot ». Ce langage-là – celui des « classes
dangereuses » et des « affranchis » – s’est constitué,
dit-elle, « à des fins purement opérationnelles, d’un
vocabulaire fait d’emprunts ». Dans un entretien, elle expliquait
:
« Il y a eu un déclic à propos du mot ‘prince’, dont l'origine est romani : j'ai voulu comprendre. Au XVe siècle, l'arrivée des Gitans en Europe et en France correspond à l'émergence d'un argot des malfaiteurs. On a souvent prétendu que l'argot était issu des patois. Cela aurait été totalement inefficace à une époque où la langue nationale est encore mal définie, où les patois cohabitent et sont compréhensibles par un grand nombre de locuteurs. Pour les hors-la-loi, l'argot est une barrière guerrière, un langage travesti, compris par eux mais qui doit rester totalement inintelligible pour la police et les victimes potentielles. Ce langage a abondamment puisé dans la langue parlée des Gitans, qui étaient l' “élément étranger” par excellence et pour qui les mots ont toujours été une arme défensive. Prenez, par exemple, bêcher - avoir une attitude méprisante - qui a donné bêcheur, il vient du romani besh qui signifie “être assis, installé, trôner”. Chicaner qui donne ensuite se chiquer vient du romani tchingar - la bagarre. »
Et
Guy Debord d’ajouter dans Panégyrique (1989) :
« Les Gitans jugent avec raison que l’on n’a jamais à dire la vérité ailleurs que dans sa langue ; dans celle de l’ennemi, le mensonge doit régner. »
« Je crois qu’Alice a commencé par un coup de maître, ouvrant une voie directe vers le centre même où se lient la question des classes dangereuses et celle des langages secrets ; et ces deux réalités vont probablement retrouver une grande actualité bientôt. Tu remarqueras aussi sa discrétion, digne de son sujet.» (Guy Debord, lettre à Jean-François Martos, 26 décembre 1990).
Le
philosophe Giorgio Agamben sera admiratif :
« En tout cas il est clair que l’enjeu n’est pas seulement linguistique ou littéraire, mais, avant tout, politique et philosophique. Le livre d’Alice Becker-Ho n’est pas un essai de sociolinguistique, mais un manifeste politique. » Paru dans le premier numéro de Luogo comune, novembre 1990. [6]
En
2000, Alice Becker-Ho récidive en publiant Paroles de Gitans, qui
propose un choix de textes où l’on savoure ces mots de Pedro Amaya
:
« Parce que je suis né gitan, de la tête aux pieds, le monde est ma maison, le ciel est mon toit, la terre est mon sol ; parce que je suis né gitan, j'ai de quoi parler. »
Des
paroles d’hommes dont « la seule profession est de vivre», selon
le poéte espagnol Antonio Machado y Alvarez.
NOTES
[1] La date peut être contestée, car ne s’appuyant sur aucun document écrit de l’époque. Cependant, 1418 est confirmée par Henriette Asséo, historienne française étudiant l'histoire du peuple tzigane en Europe (Les premiers groupes pénètrent en France par le Nord et l'Est en 1418. Ils parviennent à Paris en 1427), ainsi que par l’historien Christian Paultre, auteur de « De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l’ancien régime » (1975) : « Ils firent leur apparition en France en 1418. »
Dans les Chroniques strasbourgeoises (fragments des
anciennes chroniques d'Alsace, dans Bulletin de la Société pour la
conservation des monuments historiques d'Alsace, 1892), en cette
année 1418 :
«
En cette année arrivèrent à Strasbourg et dans tout le pays les
premiers Tsiganes. Ils étaient environ 14.000 et dispersés çà et
là. Ils disaient devoir vagabonder sept ans et faire pénitence. Ils
venaient d'Epire, l'homme de la rue dit de Petite Egypte. Ils avaient
de l'argent en abondance, payaient tout, ne firent de mal à
personne, parcoururent tout le pays. Ces sept ans écoulés, on ne
les revit plus pendant cinquante ans, mais depuis lors il y a des
chenapans qui ont prétendu être dans le même cas que ces Tsiganes,
mais s'est pure tromperie ».
Leur
nombre est certainement exagéré. Les
historiens s’accordent de leur présence dans l’actuelle
Allemagne en 1417, attesté notamment par le témoignage de Hermann
Corner, moine de l'ordre des frères prêcheurs de Saint-Dominique,
contemporain des faits, et en Suisse en 1418, sans doute pour se
rendre à Rome auprès du Pape. Le premier document officiel
mentionnant les Bohémiens en France date d’août 1419 à
Chatillon-sur-Chalaronne, un second atteste leur venue à
Saint-Laurent, face à Mâcon. Le registre des délibérations
atteste leur venue à Sisteron, le 1er octobre 1419. Qui confirment
l’hypothèse de la route des Bohémiens vers Rome, car le 18
juillet 1422, on vit arriver à Bologne en Italie une troupe de
Bohémiens.
[2] En 1427, une troupe de tziganes arrive pour la première fois à Paris et campe à la porte de la Chapelle ; ils étaient au nombre de cent trente-deux y compris les femmes et les enfants. Sauval citant un passage du « Journal d’un bourgeois de Paris » les décrit ainsi :
«
Ils avoient le visage bazané, les cheveux tout frizés, les oreilles
percées et un ou deux anneaux d’argent à chacune. Le visage des
femmes était tout découvert et encore plus bazané que celui de
leurs maris, leurs cheveux étaient noirs et faits comme la queue
d’un cheval, elles portoient un méchant roqueton ou une mauvaise
chemise avec un vieux drap tissu de cordes et lié sur l’épaule;
c’étoit en un mot les plus noirs et les plus vilaines femmes qu'on
ait vu en France.»
Ils
excitèrent ainsi un sentiment de vive curiosité et une foule
nombreuse vint les voir et chacun voulait se faire dire la bonne
aventure ; l’affluence était d’autant plus considérable qu’il
y avait à Saint- Denis le « Landit ». Le Journal d’un Bourgeois
de Paris rapporte qu’il y :
«
avoit sorcières qui regardoient les mains des gens et disoient ce
que advenu leur sloit ou à advenir, et mirent contans en plusieurs
mariages, car elles disoient au mari : ta femme t’a fait coux ; ou
à la femme, ton mary t’a fait coulpe. Et qui pis estoit, en
parlant aux créatures par art magicque ou autrement ou par l’ennemy
d’enfer, ou par entregent d’abilité faisoient vuydcr les bources
aux gens elle meltoient en leur bource, comme on disoit ».
«
Et vrayment je y fu III ou IV fois pour parler à eulx, mais on eques
ne m’apcrceu d’un denier de perte, ne ne les vy regarder en main
».
Ces
rumeurs parvinrent jusqu’aux oreilles de l’évêque qui se rendit
auprès des Bohémiens accompagné d’un frère mineur, surnommé «
le Petit Jacobin » ; celui-ci fît un sermon et excommunia tous ceux
qui avaient cru dans le pouvoir magique des Bohémiens et qui leur
avaient donné leurs mains à examiner. Sur les instances de l’évêque
ils furent contraints de partir et ils quittèrent la Chapelle le
jour de la Bonne-Dame de septembre et se dirigèrent sur Pontoise.
Un
siècle est passé, leur mauvaise réputation précède leur arrivée
en ville. Henri Corneille Agrippa les dépeint comme « des gens
étranges, d’une laideur repoussante », qui causaient une frayeur
superstitieuse aux paysans, qu’on accusait d’empoisonner les
puits et les fontaines, de donner la peste : « Souvent les puits et
fontaines sont empoisonnez, les fruits infectez, les pastes envenimez
et la peste mise entre les peuples avec grande mortalité. » De
cette marque sont ceux que l’on appelle Cingres ou Égyptiens
lesquels,
«
meinent une vie vagabonde par toute la terre, se campent hors des
villes, aux champs, es carrefours et là dressant leurs loges et
tentes font estât de brigander, desrober, tromper, troquer, amuser
le monde en disant la bonne adventure faignant de deviner par art
chiromancique et par telles impostures mendient leur vie ». De
incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium (1525, 1re
éd.1530).
[3]
Bien entendu, le racisme est aussi social : sont mis au ban, les
populations tziganes les plus humbles ; et ce racisme social
s’applique également entre Tziganes.
[4]
L’on distingue cinq vagues migratoires qui pourraient être à
l’origine d’un racisme exacerbé à leur encontre :
La
première migration date du 14e siècle, qui correspond aux temps de
la conquête des Balkans par l'empire Ottoman, les Roms jouent de
part et d'autre, du coté austro-hongrois comme ottoman, le rôle de
supplétifs militaires appréciés notamment pour leur maîtrise des
chevaux. Au fur et à mesure de l'avancée des Ottomans, des Roms
chrétiens glissent vers l'Europe de l'ouest.
La
deuxième migration débute au milieu du XIXe siècle au moment où
leur esclavage, qui durait depuis près de 5 siècles, prend fin en
Roumanie. Jusqu'au début du XXe siècle des familles de Roms
roumains s’installèrent en Europe occidentale ce que feront
également des familles bosniaques à peu près à la même époque.
Si certaines familles s’implantent en France, d’autres la
traversent seulement pour s’embarquer vers le continent américain.
Enfin, la montée du nazisme engendra un exil massif de populations
considérées indésirables en France qui concernent autant les Juifs
que les Tziganes, les communistes et socialistes, et nombre
d’intellectuels.
La
troisième vague migratoire débute au milieu des années 1960 avec
l'arrivée de travailleurs yougoslaves en France parmi lesquels des
Roms de Serbie ou de Bosnie.
La
quatrième vague naît au début des années 1990 ; deux phénomènes
y contribuèrent : la fin des régimes communistes qui se traduit
pour de nombreux Roms par une paupérisation accentuée et les
guerres d'éclatement de la Yougoslavie.
La
cinquième concerne l'adhésion en 2007 de la Roumanie et de la
Bulgarie à l'Union Européenne qui fut un facteur déclenchant,
malgré les restrictions imposées, d'un flux migratoire en
provenance de ces pays parmi lequel les Roms ne représentaient
qu'une minorité proportionnelle à leur implantation dans le pays
d'origine.
[5]
Dont notamment :
BLOCH,
1953, Les Tsiganes.
SCIZE,
1953, La Tribu prophétique.
FEVRE,
1954, Les fils du Vent.
DE
VILLE, 1956, Tziganes, témoins des temps.
CHATARD,
1959, Zanko, chef tribal.
VAUX
DE FOLETIER, 1961, Les Tsiganes dans l'ancienne France.
COLINON,
1961, Notre Dame des roulottes.
FÉAUDIÉRRE,
(dit SERGE), 1963, La grande histoire des Bohémiens.
HEUSCH,
1966, A la découverte des Tsiganes.
L'HUILLIER,
1967, T'es manouche mon frère ?
DUBREUIL,
1968, Manouches.
COLINON,
1968, Les Gitans : des inconnus parmi nous.
YOORS,
1968, J'ai vécu chez les Tsiganes.
VAUX
DE FOLETIER, 1970, Mille ans d'histoire des Tsiganes.
BOTEY
Francese, 1971, Le Peuple gitan (Tr. de l’espagnol).
LIÉGEOIS,
1971, Les Tsiganes.
FALQUE,
1971, Voyage et tradition. Approche sociologique d'un sous-groupe
tsigane, les Manouches.
DERLORI,
1971, Ainsi vivait le Tsigane.
MÉNÉTRIER,
1972, Origines de L'occident: nomades et sédentaires.
ASSÉO,
1974, Le traitement administratif des bohémiens.
[6]
Dont notamment pour cette période :
Gina
Lollobrigida en fausse diseuse de bonne aventure et son prétendant
Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe de Christian-Jaque en 1952 ;
La
Belle de Cadix avec Luis Mariano en 1953 ;
Goubiah,
mon amour, avec Jean Marais en 1955 ;
Notre
Dame de Paris de Jean Delannoy en 1956, avec Lollobrigida et Anthony
Quinn ;
suivi
la même année de L’ardente Gitane de Nicholas Rey ;
Mon
pote le gitan en 1959, avec tout l’humour de Louis de Funès ;
Kriss
Romani de Jean Schmidt en 1962 : la participation de nombreux
Tziganes dans la distribution du film, le choix de filmer hors
studios mais dans les campements de caravanes, entre les no man’s
land d’une banlieue en formation, avec des caméras légères, le
place dans la catégorie du néo-réalisme ;
Cartouche
de Philippe de Broca (1962) avec Belmondo ;
Bons
baisers de Russie, en 1963 où Jams Bond est accueilli puis défendu
par des Tziganes d’un campement.
J'ai
même rencontré des tziganes heureux (Skupljači perja), film
yougoslave réalisé par Aleksandar Petrović, sorti en 1967 est le
premier film dans lequel les tziganes parlent leur langue, et la plus
grande partie des rôles est interprétée par des tziganes de
Voïvodine de la Yougoslavie : il obtient le grand prix du festival
de Cannes et l’Oscar 67 du meilleur film étranger, qui lui valent
une réputation flatteuse et la reconnaissance internationale.
Le
Gitan en 1975, avec Alain Delon en fière vedette gitane.
[7]
Il poursuit :
«
Quoique Alice Becker-Ho se tienne discrètement dans les limites de
sa thèse, il est probable qu’elle soit parfaitement consciente
d’avoir déposé dans un nœud de notre théorie politique une mine
qu’il s’agit tout simplement de faire éclater. Nous n’avons,
en effet, aucune idée de ce qu’est un peuple ou une langue (on
sait très bien que les linguistes ne peuvent construire une
grammaire, c’est-à-dire cet ensemble unitaire doté de propriétés
descriptibles qu’on appelle langue, qu’en prenant pour acquis le
factum loquendi, c’est-à-dire le simple fait que les hommes
parlent et s’entendent entre eux, ce qui reste tout à fait hors de
portée pour la science), et, pourtant, toute notre culture politique
est fondée sur la mise en relation de ces deux notions. L’idéologie
romantique, qui a opéré sciemment cet attelage et, de cette
manière, a largement influencé la linguistique moderne et la
théorie politique encore dominante, a cherché à éclaircir quelque
chose d’obscur (le concept depeuple) avec quelque chose d’encore
plus obscur (le concept de langue). À travers cette correspondance
biunivoque ainsi établie, deux entités culturelles contingentes aux
contours indéfinis se transforment en des organismes quasi naturels,
doués de caractères et de lois propres et nécessaires. Car, si la
théorie politique doit présupposer sans pouvoir l’expliquer le
factum pluralitatis (nous appelons ainsi, avec un terme
étymologiquement lié à celui depopulus, le fait que les hommes
forment une communauté) et si la linguistique doit présupposer sans
l’interroger le factum loquendi, la correspondance simple entre ces
deux faits fonde le discours politique moderne. La relation
gitans-argot questionne radicalement cette correspondance au moment
où elle la reprend parodiquement. Les tsiganes sont au peuple ce que
l’argot est à la langue ; mais cette analogie d’un instant
illumine en un éclair la vérité que la correspondance
langue-peuple était censée cacher : tous les peuples sont des
bandes et des coquilles, toutes les langues sont des jargons et des
argots. Il ne s’agit pas d’évaluer ici l’exactitude
scientifique de cette thèse, mais de ne pas laisser s’enfuir sa
puissance libératrice. »

















































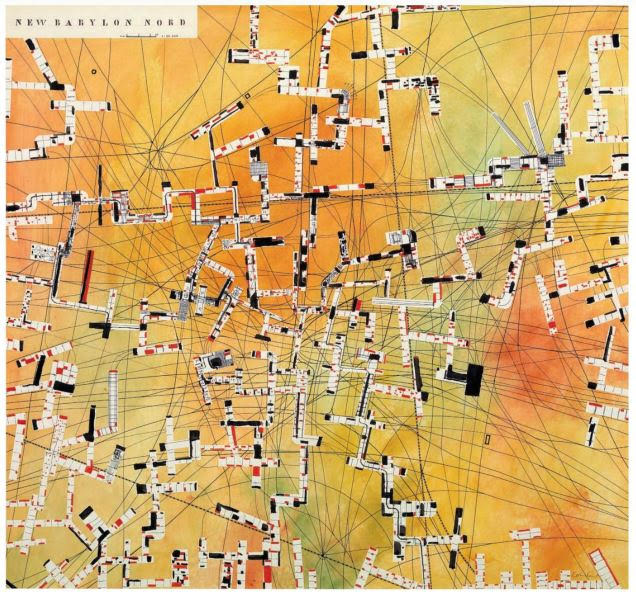













































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire